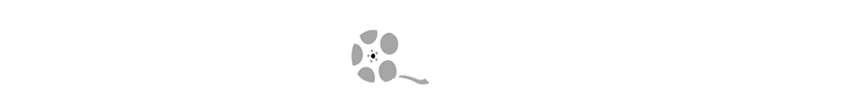Alejandro est sur la cuvette quand l’homme arrive. La porte s’ouvre et on le traine dans le salon, une salle carrée, exigüe. Le gros militaire fait les cent pas en hurlant. Fébrile, Alé passe discrètement sa main dans sa poche, sent entre ses doigts son enregistreur. Il tâtonne, cherche le bouton play la sueur au front. L’autre rejette un magma de paroles dont il comprend qu’il a été choisi pour une mission. Il doit se rendre à Barcelone le jour même pour assassiner deux personnes qu’on lui a désigné. Il cherche, appuie successivement sur différents boutons. Puis finit par renoncer. Il sera très bien payé. Il ira à Barcelone. Nouveaux disparus.
Géraldine erre dans les rues. Un visage aveugle la suit. Elle marche de plus en plus vite. Enfin elle retrouve sa mère et lui parle, mais il est encore là. Les yeux bleus blancs, mer de sel, mirage. Aufrédy. C’est Aufrédy répète-elle. Notre personnage.
Je contourne l’église dans la nuit noire. Rentre par une petite porte. A l’intérieur, les morts attendent les pieds rampants, visages déchirés. J’essaye de m’enfuir mais ils me poursuivent, les tués du scorbut. Ils attendent les marins dans la petite chapelle. Sans issue.
On se réveille quatre fois par jour. Toutes les six heures. C’est un rythme insupportable et envoutant. Qui nous coupe du temps réel. Les journées s‘étirent et sont minuscules. On ne les compte plus qu’à cause du livre de bord et des plantes. Un petit calendrier pour ne pas trop les arroser.
Les rêves sont agités, gîtent avec Tortuga. Debout dans la nuit, couvert d’un poncho de laine, Alejandro me raconte un temps de la dictature, son enfance auprès d’un père membre de la junte militaire. Il saura plus tard. El General et tous les morts. Il avait huit ans et un navire ravive l’angoisse étrange comme il fait naitre chez nous de fausses inquiétudes.
Géraldine se remet au montage ; je mange une orange.
Fixation de l’ordinateur de montage à la table à carte
31 mai 2017, Ars-en-Ré
9h45 Nous larguons les amarres !
12h45 L’iridium est activé, et on envoie le pépin !
15h35 Le vent est monté
22h37 Champagne, et cigares
00H00 Vio part au dodo, nous avons vu l’iss
1h30 Andres lurn how to fill this log
La communication devient stratégique, quand on ne fait parfois que se croiser. On s’écrit des post-it. La ligne « Evènement » du livre de bord se fait poème. On y laisse notre trace mieux que dans le sillage. Nos deux hispanophones mettent du temps à oser écrire dans ce cahier officiel. Puis ils dessinent.
1er juin 2017, Rochebonne
6h05 L’aube est là, changement de quart
7h40 Bientôt la marche océanique !
9h On a sorti le spi
10h40 Gé veut faire du pain
15h Ballet de thons. Pique de vitesse à 2,6 nœuds
18h Pointe à 3 nœuds !
19h30 DAUPHINS !!
On finira par ne plus les dire. Andrès et Alé les montrent sautant tout du long de leur ligne, sur le livre de bord. Ils sont arrivés peu de temps après notre départ pour le Gascogne, et nous ont suivi plusieurs jours. La première fois, nous sommes tous montés sur le pont en criant et les avons filmé sous toutes les coutures. Puis on crie « dolphins ! », ou « delfines ! », et parfois quelqu’un vient encore voir. Ils sont devenus l’eau. On s’en émerveille mais ne les regarde plus que de temps en temps.
La nuit leur présence est inquiétante.
Bruit de bouchon qui pop, et petit aileron.
3 juin 2017, Gascogne
3h15 Gé après 1h30 de transe lâche la barre à Cha
6h19 Nuit agitée. Pas vue de bateau malgré alarme
13h20 Le chat a perdu la farine
15h09 … mais a fait un très bon gratin
16h30 Terre en vue !!
20h20 Pétole. La risée Béta Marine démarre (moteur)
Nous nous sommes arrêtés trois jours à La Corogne, ville de la pointe espagnole. C’est un temps à terre qui nous éclate. Un premier soir à boire ensemble, danser, flâner, puis une après-midi de guerre où tout le monde se sépare. Grande respiration, un gouffre. Les tensions implosent puis se dissolvent dans les retrouvailles. Une nuit entière cloisonnés pour chanter et rire dans la carapace.
Dessin de Andrès, fait en mer
7 juin 2017, Espagne
00h19 Perte de manille sur palan de grand’voile
1h40 Il est 1h30 et tout va bien
3h Changement de quart
6h23 On passe enfin le cap Finisterre !
7h34 Vio chante Surfing des Beach Boys
9h19 Tangon sur la voile avant
10h50 On rallume le moteur
19h40 Empannage sous spi
Nous avons largué les amarres sans savoir si nous allions faire à nouveau escale au Portugal. On regarde distraitement la terre s’éloigner, heureux de s’en défaire et sûrs de la retrouver bientôt. Nous ne savourons ni le pain ni la bière, nous avons ce qu’il faut à bord. On parle de Lisbonne et des danses de fuego. Il y a une rivière à remonter, large, trop longue.
On passe sans s’arrêter.
8 juin 2017, Portugal
00h20 On croise des péchoux
1h30 Chalut’ Kimberly en vue
3h On croise un chalutier
4h35 Dauphins
6h Pareil
9h Je comprends rien aux heures…
12h21 Dauphins et petite cocote de spi
13h50 Eole nous quitte, Béta revient
15h05 Les poires sont bonnes
19h16 Sous spi à nouveau
21h On slalome entre les casiers !
22h35 Déchirure du spi sur 5 mètres
00h00 Luna llena ahouu !
Notre voile préférée se fend sous la force du vent. Orange, blanche et verte, irlandaise pour certains et indienne pour moi, le spi est la bulle légère qui fait voler Tortuga. Notre toile la plus rapide, la plus compliquée. On la ramène dans le cockpit roulée en boule et étrangement, ce deuil commun achève de souder l’équipage. A partir de là, il n’y aura plus de pentes. On avance ensemble.
10 juin 2017, Portugal
00h00 Andrès chante sur le pont
1h45 Tortuga se faufile dans le trafic
3h Luna se ve hermosa desde el mar
5h20 Chalut’ Lucia de Jesus, enculé !
9h06 La mer, le soleil et ses porte-conteneurs
10h40 Party all the night
12h Soleado perdiendo de vista tierra
15h32 Concours de vitesse, 8,5 nœuds par Violaine !
19h50 On affale la grand’voile
23h35 Andrès et le théâtre
Je vois la silhouette de Violaine se découper sur le feu de la côte. Tortuga pique à angle droit, grand largue, océan, et laisse le reste des hommes rougeoyer dans le brasier nocturne. Les lumières de la baie de Lisbonne, dernier regard avant la plus longue traversée effectuée par une équipe du Bato A Film jusqu’à maintenant. Dix jours vont passer. Les rêves commencent.
12 juin 2017, Maroc
1h09 Empannage tranquille, la mer un peu calmée
2h39 Tout est humide. Afrique à bâbord !
6h04 Le loup-garou s’éveille
7h40 Changement de quart, le Chili reprend la barre
10h48 Entre Rabat et Casablanca
12h05 Pluie de poulpes sur le pont !
15h Taboulé, tous dehors !
17h40 Lavage du cockpit
19h23 Le retour de la grand’voile
21h01 Croisement avec Véronica B
Les ruelles. Le thé à la menthe et la folie du souk. La poussière, le bruit, les odeurs, le sucre, la terre rouge. Ce vert de l’Atlas qui fond dans un blanc neige. Oujda.
Tout manque.
On n’a pas idée de voyager en mer quand la terre existe.
Bleu insupportable. Gris insupportable.
Voyage aveugle.
Prostrée dans le triangle qui me sert de lit, je reste confinée deux jours dans une humeur grave. Atteinte toujours par le mal de mer, je suis inutile au montage du film, inutile en cuisine. J’attrape mon ordinateur et tente d’écrire. Sur le ventre, la tête en bas. Sur le dos, les pieds en l’air, scotchés au plafond. Sur le côté, une main tapant touche par touche. N’importe quoi qui puisse faire supporter à mon estomac le ressac continue de cette coque d’acier, cette falaise. Qui n’a pas passé un temps seul sur le pont d’un navire voguant au large ne sait pas encore sa solitude.
Mais le huis clos est paradis. La couleur, c’est les autres. Géraldine nous apaise à la guitare sous une nuit blanche. Violaine me réveille avec des amandes grillées et du chocolat. Andrès, incapable de dormir, danse en mimant un strip-tease autour du mât, éteint sa lumière rouge et s’allonge malgré tout sur sa bannette. Alé m’appelle chat sauvage et sourit, poils hérissés. Thibault trinque chaque soir comme si c’était le premier.
Je lui ai rendu sa couchette, au chef mécano, et suis maintenant dans la pointe avant, un lit double où Violaine me rejoint après son quart. Au-dessus de nous, un hublot permet de suivre le mouvement des voiles d’avant, des étoiles. Entre nos deux lits-triangles, je change d’hypoténuse pour suivre les virements de bord. Que le ciel reste visible de l’autre côté de la trinquette ou du génois. La bulle du spi, éclate.
Bureau occasionnel, ordi sur les genoux et dauphins pour collègues.
Par Violaine
13 juin 2017, Maroc
00h01 Thib prend la barre
1h45 Andrès a la timone
3h02 El plancton magico
7h40 Le jour commence à se lever, c’est l’heure ?
10h50 Cafe con leche
14h37 A la douche !!
17h08 Salsa y vino
21h02 Changement de quart
23h06 On dépasse Essaouira
01h37 Plancton, musique et étoiles. Vent doux
Le sel et les cordages nous ont fait perdre la peau du bout des doigts et de certaines phalanges. Nous nous lavons à tour de rôle sur le pont, à l’eau de mer. Ça fait plusieurs jours que nous n’avons pas pu ouvrir les hublots pour aérer la tortue à cause de l’agitation de la mer. Parfois une vague recouvre tout un pan du pont, nous avec, et laisse derrière elle de petits poulpes violacés qui se dessèchent en quelques secondes. Alé a voulu en utiliser un pour pêcher, mais de toute la traversée nous n’avons rien eu. Nos couchettes sentent la sueur et l’humidité.
Au large de l’Afrique.
Par Géraldine
14 juin 2017, Maroc
6h Barco grande, no esta en el GPS
8h52 Un thé renversé sur le pont
10h33 Le vent chute. Agadir
12h54 Topo moteur avec Thib
15h Sin Maria y sin cerveza Andrès pierde la cabeza
19h25 ça dort sévère sur ce bateau !
Lâcher prise.
Accepter ce temps du voyage c’est ouvrir un monde. Lenteur. Contre-temps. L’espace de la mer bat à rebours des montres. Une vague, un pas. Un souffle sur une, deux, trois voiles. Trinquette et foc, yankee. La toile du temps est choisie selon les nuages, les embruns. On se repère à la lune. Elle se couche d’un côté quand l’autre s’embrase en miroir, et rougie de cette rencontre. Nos repères changent. Intérieurs, sont d’abord les caps.
Encore quelques heures.
Isla Graciosa, face à Lanzarote.
15 juin 2017, Iles des Canaries
00h00 Vent instable, bateau instable
1h50 El plancton esta mas lindo que nunca
3h30 Empannage. Enroulement du génois
4h40 Andres de mauvais poil, boit une bière
6h10 Thib à la barre
8h Terre.
Désert.