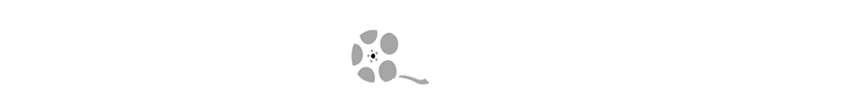Lorsque Tortuga est entrée dans les eaux équatoriennes, au large de la côte, une tortue marine est apparue près du navire. Géraldine et son équipage ont coupé le moteur, se sont laissés approcher par l’animal. Alors que Julia reste sur le pont pour assurer la veille, Sophie, Vianney et leur capitaine sautent par-dessus bord. Ils nagent avec elle. Un corps lent, calme, qui passe sous la coque et vient saluer le safran, suivi de toute une famille de petits poissons qui la suivent comme si elle était leur mère. Sûrement se nourrissent-ils des coquillages qui ont élu domicile sur sa carapace. Vianney frôle sa patte d’une main tendre, révérencieuse. La tortue, notre avatar, tourne la tête vers lui et le regarde d’une façon si intense qu’on perçoit son âme, sa douceur. Le Pérou s’efface; notre temps en Equateur commence. De cet instant à celui où on touchera les côtes du Panama, il restera sous le signe de cette rencontre : un miracle.
Notre résidence se déroule dans un nuage. Tortuga a retrouvé le ventre fermé d’un Yacht Club, sur ponton, à quelques mètres d’une piscine et de chaises longues. Nous la quittons sans inquiétude chaque matin pour rejoindre la mer et nos aquarelles. Tout a été organisé en amont et nous avons le sentiment rare de suivre le mouvement, de nous laisser porter par la bande d’artistes rencontrée ici. Felipe Travez, ancien colocataire de Géraldine à Santiago du Chili, a tout pris en main. Accompagné par une collègue de son cabinet de graphisme, il est venu de Quito jusqu’à Salinas, en huit heures de voyage. Sur la route, il embarque avec lui plusieurs artistes, amis ou personnalités connues du pays, de la montagne ou de la côte. Ils sont tous volontaires pour donner une semaine de leur temps à trois minutes de film. Des fous, dirait-on, qui font soudain contraste avec les participants de Lima et leurs réticences à subir une heure de bus le matin.
Lorsque l’atelier débute le premier jour, Géraldine se présente devant douze artistes professionnels, souriants, attentifs. Sound designer et dessinateurs de la capitale, graffeurs et peintres de Guayaquil, écrivain installé à Salinas : d’où qu’ils viennent, ils ont en commun d’aimer profondément la mer. Ils nous remercient de leur donner la possibilité d’exprimer cet amour à travers un film, sans comprendre que nous soyons nous-mêmes si reconnaissants de leur présence.
Une symbiose simple s’installe. Nous vivons entre Tortuga et cette terrasse où l’on se retrouve chaque jour. Daniel Adum, acteur de cinéma, auteur de street art ayant publié deux livres de fresques murales, nous prête l’espace de sa villa en bord de mer pour mener nos séances. Une partie des artistes emménagent dans les quatre chambres qu’il loue, Felipe et sa collègue Giro viennent habiter la Tortue. On se retrouve à six sous la carapace. Sophie repartie en France, un bonhomme du nom de Paul-Antoine Salvetti, Polo, monte à bord. Informaticien de métier, cinéaste de coeur, il fait des films entre deux lignes de code et met soudain la barre très haut dans la maîtrise du logiciel d’effets spéciaux After Effects, donnant au court métrage de Lima une pâte que n’avait jamais eu nos productions. Géraldine collabore avec un monteur d’un autre style, et cet échange leur permet de perfectionner chacun leurs techniques. Le court de Lima devient le film le plus abouti graphiquement du Bato A Film, ce qui laisse espérer beaucoup du travail de Salinas. Allongés dans des hamacs, assis sur le sable, sur les bancs du jardin ou dans un des grands canapés du salon, notre petite troupe dessine, peint, enregistre des dialogues et des sons.
Le bruit de la mer, partout, nous envahi. Un saut dans l’océan entre deux peintures, deux montages de plan.
Je continue à mener des interviews et découvre grâce à Felipe l’importance que l’Équateur donne à son front maritime. En particulier à cet archipel qui sonne comme une légende, les Galapagos. La loi internationale veut que chaque nation possède les deux cents miles nautiques qui bordent sa côte; l’Equateur dispose d’une dérogation qui lui donne tout l’espace qui sépare le continent de ces îles. D’un bout à l’autre des rives, l’océan est ici une zone protégée où vivent une faune et une flore exceptionnelles, endémiques. C’est le rêve de Polo et des autres membres d’équipage de traverser cette mer pour visiter les Galapagos et découvrir tout ce qui y habite. Felipe et sa compagne Dani, qui connaissent bien l’archipel, sont inscrits à la navigation mais depuis que nous nous sommes retrouvés, il semble que notre ami hésite. Leur voeux était de pouvoir débarquer aux Galapagos et de ne pas continuer jusqu’au Panama, qui est à plus de deux semaines de voyage en mer. Mais l’administration de cette réserve naturelle refuse qu’un équipage se sépare sur place, ceux qui arrivent en voilier doivent repartir ensemble par le même moyen.
Doucement, Felipe et Dani renoncent à ce périple. Ils parlent pourtant des îles comme d’un véritable paradis, un lieu qui ne ressemble à aucun autre. C’est le temps qui leur manque, et l’envie de voyager ensuite du Panama jusqu’à Quito. A noiveau, nous perdons nos équipiers sud-américains.
On se met à chercher des volontaires, que Géraldine et son équipage ne se retrouvent pas à quatre pour une navigation si longue. Vianney Houette, un ami de Vianney Roche qui nous avait aidé à contrer les vices administratifs de Lima, occupe déjà le poste de Second. C’est un grand gaillard tout brun, grand et mince, militaire. Son humour et sa légèreté contrastent avec la rigueur et la fermeté que trahissent parfois ses gestes, ses décisions. Malgré toute la bonne volonté qu’on y met, nous commencerons par avoir du mal à s’accorder. Ce décalage me fait réaliser que notre cadre, le pays de la Tortue, est devenue une contrée réglée, qui a ses codes et ses habitudes. On n’y rentre pas si facilement. Il y a tout un tas de règles à suivre ici si on ne veut pas que les verres cassent, que le papier se mouille, que le moteur flanche, que le bois craque, que la rouille prenne. On tente d’expliquer ça petit à petit mais l’ensemble demande du temps et de la patience à intégrer. ça viendra, et nous finirons la traversée avec complicité. Il nous prouve à plusieurs occasions quel bon marin il est et nous apprendrons beaucoup de lui.
Je demande autour de moi si une cinquième personne désire embarquer, vantant notre bateau et notre destination. Jérémy est en route depuis le Pérou pour me rejoindre, et je ne réfléchis pas à naviguer. Puis un après-midi, alors qu’on dessine, alors qu’il est là, ça me vient. Ce ne sont pas les Galapagos qui me décident, ni même l’amitié de Julia et Polo, mais le passage de la ligne de l’équateur dans l’autre sens. Commencer à rentrer sans ça, ça serait comme tomber sans avoir fait le grand saut. Je garderai toujours en mémoire le moment où nous avons changé d’hémisphère la première fois, en Atlantique, avec Julie, Gilou et Thibault déguisé en Neptune. Ma capitaine en Amphitrite. Polo, Vianney et Julia sont novices, je veux partager ce moment avec eux et débuter ainsi le chemin du retour.
Je dis au revoir à Jérémy sous une pluie fine sur le parking du Yacht Club. Je m’apprête à retrouver la mer après deux mois à terre, et lui va découvrir l’Amazonie. Nous sommes chacun un peu envieux de l’autre, un peu tristes de nos décisions, il aurait pu venir, j’aurais pu rester. Mais nos choix font sens et on se réconcilie avec ces avenirs riches qui nous attendent. Avec ces séparations répétées, qui parsèment le voyage de petits nids de souffrance, quelques fois. Bientôt nous serons rentrés. Géraldine et moi n’en parlons pas. On se refuse à compter, non plus les mois, mais les semaines. La résidence de Cuba s’achèvera fin mai. Nous sommes fin mars.
Le déluge.
Equipage Salinas (Equateur) - Panama City (Panama)
Julia, Charlotte, Géraldine, Polo et Vianney Houette
Notre première navigation est courte : les Galapagos ne sont qu’à six jours du continent. On passe les deux premiers à pister les filets de pêcheurs clandestins, tirés sur plusieurs centaines de mètres entre des bouées difficilement visibles. Julia, qui est partie malade, reste deux nuits hors quart. Lorsqu’elle se remet enfin, c’est à mon tour d’être alitée vingt-quatre heures, de nouveau vaincue par le mal de mer. C’est la troisième fois depuis que nous avons quitté la Bretagne que je subis l’affront de devoir renoncer à un quart, et je m’oblige à manger et à sortir pour m’amariner le plus vite possible. Polo me tient à l’oeil: il surveille ce que j’avale et me poursuit avec un jeu de cartes pour me distraire, tuer cette angoisse de la nausée qui est une de ses principales origines. Son soutien me soigne mieux que l’air frais et bientôt je parviens à reprendre la barre.
Il fait beau. La chaleur nous terrasse à certaines heures, mais Toto le pilote auto nous sauve. Il tient le coup jusqu’à trois noeuds, après quoi il n’est plus possible de le laisser barrer, au risque de faire chauffer les circuits. On dépasse rarement cette vitesse, le vent restant faible. On avait craint de devoir avancer au moteur et d’être obligé de remplir notre cuve au prix cher du gasoil de l’archipel, mais l’allure se maintient. On avance lentement mais sûrement et le plein de Salinas suffira jusqu’à atteindre le Panama, épargnant une partie du budget.
Tortuga se transforme à nouveau en caravane, le pont en terrain de camping. On emploie la même technique pour se protéger du soleil que lorsque nous traversions l’Atlantique à cette latitude : des morceaux de tissus suspendus entre nos panneaux solaires et nos filières, nos winchs, nos voiles. J’y retrouve petit à petit le bonheur d’être en mer. Les fantômes, qui restent assis au pied du mât lorsque je barre la nuit. Des dauphins passent au loin, qui ne viennent pas nous voir. On leur prêtera la réputation d’être plus snobs que ceux d’Atlantique. L’horizon reste calme, étiré et plane comme le temps : une seule ligne droite, sans accoup, sans repère autre que ceux qu’on veut bien s’inventer.
Les repas sont nos principaux souvenirs. On mange d’ailleurs très bien à bord : ce bateau est un vrai restaurant gastronomique, avec menu composé d’hamburgers de quinoa, bruschettas au pesto, tartelettes à la tomate, crêpes bretonnes… On savoure et joue aux cartes. On travaille sur nos films, Polo, Julia et Géraldine sur le court de Salinas, Vianney et moi sur le clip de voyage des canaux de Patagonie. Je n’avais pas eu la patience de dérusher tous les moments captés lors de cette traversée; Vianney m’aide en préparant une sélection des plans qu’il juge les meilleurs. Grâce à lui j’arrive à me mettre au montage, et replonge totalement dans cette ambiance extraordinaire des eaux entourées de montagnes, le Sud du monde. Des canaux comme des lacs. Les forêts pures, vertes et grises, où je m’enfonçais avec Stéphane durant des heures, jusqu’à ce qu’on se perde. Lointain, le mât lointain de Tortuga devenait notre dernier repère, les branches et la mousse, notre univers.
Je pensais avoir vécu ce que ce voyage avait de plus beau à m’offrir. Puis un matin, sont apparues les îles.
On arrive avec un jour d’avance. Les démarches administratives, déjà très onéreuses, coûtent le double le dimanche. On passe une journée au large, en dérive contrôlée, avant de rentrer dans la réserve le lundi matin. Le port de San Cristobal est une baie où se mêlent voiliers au long cours et navires de tourisme. Plus de moteurs que de voiles, mais de l’eau claire. Une raie manta vient saluer la Tortue alors qu’elle passe les premières bouées. C’est un voile blanc et noir, immergée, trahie seulement par la pointe d’une de ses nageoires qui perce délicatement la surface lorsqu’elle amorce un demi-tour. Une aile, plus légère qu’une plume. La vie marine se meut en apesanteur, à croire qu’on vole mieux sous l’eau que dans l’espace. Comme si la matière de ce revers du ciel était plus lisse, plus fluide. Même la chute y semble impossible.
Amarrés à une bouée entre deux navettes, on attend la venue des autorités pour inspection du navire. Au bout d’une heure, l’agent en charge de notre venue, un homme à l’air paisible du nom de Bolivar Pesantes, vient se présenter et jette un coup d’oeil à l’intérieur du bateau.
“La plante que vous avez là, vous comptez la garder ?”
Notre compagne, accrochée au-dessus de l’évier depuis qu’Andrès et Alejandro nous l’ont offerte en Espagne, est peut-être la chose à laquelle nous tenons le plus à bord. Ce végétal a navigué plus que moi. A tour de rôle, nous en prenons soin, coupant ses feuilles grillées par l’eau salée lorsqu’une vague se faufile à travers le hublot, lui donnant à boire par un petit entonnoir de fortune, planté dans sa terre.
Géraldine pâlit.
“Vous pourriez l’envelopper dans une serviette… et la mettre au fond de votre cale moteur. Vous voyez ce que je veux dire ?”
Méfiance. Comment savoir ? On tente quand même notre chance et détache notre amie de ses fils, désenroule ses branches. Bercée dans une fine couverture rouge, elle est déposée délicatement au fond du ventre de notre engin, accessible seulement en soulevant le coffre situé sous la couchette du Second et en retirant les vestes, le chauffage électrique et les morceaux de bois empilés là. Alors que je la place, Géraldine vérifie à la lampe de poche qu’elle est invisible lorsqu’on regarde le moteur sans faire de contorsion. On décide de prendre le risque et, lorsque les agents sanitaires viendront, j’observerai ma capitaine mentir aux autorités malgré l’amende qui lui tomberait dessus si nous étions découvertes. Un regard en coin, et un sourire. Autant se rire du danger quand on le peut. Pourtant perdre cette plante nous peinerait plus que ce qu’on peut dire. En voyage, en mer, loin de chez soi, on s’attache parfois à des choses imbéciles. L’amour aussi est dans les détails.
Bolivar ne dit rien. Le navire va être vermifugé de fond en comble, mais sans ouvrir la cale moteur. Notre plante est sauvée mais l’hypocrisie ambiante ne nous rassure pas. La femme qui vérifie nos fruits, une raie manta en pendentif et de petits requins aux oreilles, demande à Géraldine si nous avons une cuve à eaux sales. Elle répond non distinctement avant d’être reprise par Bolivar qui corrige : “Oui, de 80 litres”. La femme se penche sur sa feuille et note la contenance. Alors tout le monde est de mèche et c’est pour nous que se joue le spectacle. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle, on attend encore de le savoir.
Alors que les papiers semblent sur le point d’être remplis, une plongeuse est envoyée sous la coque pour vérifier sa propreté. Elle ressort le visage fermé, et annonce que Tortuga est dans un trop sale état pour rester dans la réserve naturelle et que nous devons ressortir de la zone protégée le jour même. En plus de nous vexer au plus haut point, cette perspective ne nous arrange pas : nous avions fait nettoyer la carapace avant de quitter Salinas et passé nous-même quelques heures à frotter à l’éponge les algues accrochées sur les côtés et l’arrière. On ne voit pas comment faire mieux.
Géraldine attend que les agents sanitaires repartent et, alors que nous allons à terre avec Bolivar, elle lui fait part de ses inquiétudes. Celui-ci trouve rapidement une solution simple: la nuit venue un plongeur, qui nous apprendrons n’être autre que son fils, ira nettoyer la coque à la lampe torche discrètement. Ensuite nous n’aurons plus qu’à faire mine de sortir de la réserve, couper notre AIS lorsque nous aurons dépassé la côte et revenir sur notre trace. Nous serons de nouveau amarrés le lendemain matin, malgré le fait que tout le monde sache qu’il n’est pas possible d’effectuer cet aller-retour en seulement une nuit, ni de frotter une coque sans équipement.
L’administration fermera les yeux, et nous aurons enfin le droit de pénétrer au paradis.
Ici, nous faisons connaissance avec ce qui peut habiter l’eau. Dès notre premier jour, nous nageons avec des tortues marines, petites et grandes. Vianney, qui vit en Martinique, est habitué à leur compagnie mais ne semble jamais blasé par leur présence. Nous autres, nous sommes comme des gosses, émerveillés et fous de joie. Malgré les courants froids, nous restons des heures à les suivre, les frôler. Elles semblent insensibles à nos regards, c’est à peine si elles changent de route lorsqu’on s’approche d’elles. Elles paraissent imperturbables et près d’elles, à quelques mètres sous l’eau, on se sent définitivement étrangers. On visite un monde nouveau, qui nous porte depuis des mois mais qui était finalement resté parfaitement inatteignable. Les Galapagos sont peut-être un des seuls lieux où il est possible d’approcher ce qui respire sous les flots. On en profite intensément. Les lions de mer qui envahissent les pontons du port et nous obligent à slalomer sur la pointe des pieds jusqu’à attendre le bateau-taxi qui nous attend. Les requins, les raies dorées qui se côtoient, s’ignorent. On les voit depuis la jetée. Une volée de capes jaunes, percée par ces formes obscures, inquiétantes. Ils dorment au fond de l’eau, posés sur le sable, quand elles traversent l’espace.
Alors que Julia, Polo et Vianney ont quitté le bateau pour visiter l’île volcanique d’Isabela, Géraldine et moi choisissons de passer une après-midi sur celle de Pinson, plutôt un rocher cerné d’eau claire qu’une terre habitable. Là-bas nous avons la chance de rencontrer des pingouins : ces volatiles nagent en battant des ailes, comme s’ils volaient, les pattes immobiles et les yeux vifs. L’un d’eux passe près de Géraldine, se tourne vers elle et lui lance un de ces regards, comme s’il lui faisait la nique. Je me mets à rire sous l’eau; ça s’entend quand même. Un booby, cet oiseau aux pattes bleu cyan extraordinaire, est endormi sur une branche sèche. A ses pieds, des iguanes marins, surnommés “lutins des ténèbres” par Darwin à cause de leur peau noire, récupèrent au soleil.
On croirait que tous, ils se sont donnés rendez-vous entre ces quelques îles pour jouir de ce qu’il peut y avoir encore de bon au large, loin des hommes, loin du grand rien. Des terres maritimes, qui n’appartiennent ni au continent ni à l’océan mais sont à mi-chemin des possibles. Un vrai éden, fragile, imparfait. Précieux comme un rêve.
Nous restons là une semaine. Lorsque le dernier soir arrive, on se retrouve à bord et larguons les amarres dans la foulée, sans regarder en arrière. Bolivar nous a offert un régime entier de bananes qui ne tient que sous la barre, au fond du cockpit. Des requins nous suivent, une tortue nous précède : nous partons à nouveau sous de bons augures.
Je trace avec Julia une esquisse de route sur nos cartes numériques. Plein Nord et cap à l’Est. On parie sur pas moins de deux semaines de navigation : une des traversées les plus longues du périple. Nous aurons le temps d’oublier les heures, les dates. On retrouve bientôt cette torpeur magistrale qu’offre la vie en mer, lorsqu’on y reste. Le sentiment que j’avais eu en Transatlantique que plus rien n’existe que nos voiles, nos voix, le bruit du vent. Le monde coule dans une parenthèse, quand le nôtre s’ouvre.
Nous quittons les Galapagos le 1er avril et le lendemain, nous traversons l’équateur. La ligne n’est qu’à quelques miles de la côte. Julia l’attrape à la gaffe juste avant qu’elle ne se prenne dans le safran, la fait passer au-dessus du mât, des haubans, des panneaux solaires et la laisse retomber derrière le bateau. ça y est, nous sommes revenus dans notre premier hémisphère. Le compte à rebours est lancé mais sur l’instant je ne pense à rien d’autre que mon équipage. Réunis dans le cockpit, là où moi-même j’avais tenu la gaffe de l’autre côté du continent, là où tant de choses ont été vécues et restent encore à vivre; dans les contours de ce petit espace, on se prend dans les bras et remercie Neptune et Amphitrite de nous porter bons vents et de protéger nos voyages. La Grande Ours ne cessera plus de briller en haut du ciel. Elle indique le Nord, fait face à la Croix du Sud. L’une devant et l’autre irrémédiablement derrière. Un fil traverse et nous tire en avant, nous tire en arrière. Tout retour est un nouveau commencement. Je balance I Walk the line de Johnny Cash et danse à l’étrave.
Puis le ciel, la mer ternissent. Moins de cinq jours après notre départ, Tortuga entre dans une des zones de gyre du Pacifique sud. Les courants marins, bordéliques à cet endroit, nous ralentissent drastiquement, notre GPS affichant parfois jusqu’à deux noeuds de moins que notre speedo. Et un matin, alors que la lumière naît à l’horizon, on découvre que notre navire est cerné de détritus. On remarque surtout les tronçons liés par des cordages, que ce soit des filets de pêcheurs pendant à leurs bouées ou des branches prises dans de vieilles amarres. Les oiseaux du large s’en servent comme reposoires, et on essaye de sourire. Le principal danger pour nous, ce sont les troncs d’arbres. Vianney posté à l’avant, Julia à la barre, on entame un slalom improbable. Des bouteilles, des carcasses de fer, des planches, des sacs plastiques flottent en tout sens. Des crabes s’y tiennent, rouge pétant sur gris sale. J’arrive à trouver ça fascinant, jusqu’à ce qu’on se mette à croiser des tortues agonisantes. Ni les vagues ni le bruit de notre moteur ne les font fuir. Elles restent inertes, portées entre deux eaux, la tête immergée. On ne pourra pas dire si certaines sont encore vives ou si elles ont toutes péri en ingérant du plastique.
On cherche à sortir du vortex le plus vite possible, mais celui-ci s’étend sur des dizaines de miles. Malgré le risque de se prendre un bout dans l’hélice, on décide de mettre le moteur pendant plusieurs heures, quitte à veiller à la torche lorsque le soir tombe. On attend d’être dans des zones propres pour pouvoir continuer à se baigner et se laver à l’eau de mer mais toujours, des ordures nous rattrapent. L’océan se compare soudain à une autoroute, avec aires de repos pour les volatiles, poubelles odorantes dans les coins et quelques rares espaces tranquilles. On ne comprend plus rien. Les arbres continuent de défiler à l’étrave, longent le bateau et tapent parfois, avec un bruit de cartoon qui stoppe net le sang et nous arrache un mauvais rire.
Même en plein soleil, les eaux sont devenues grises. Comme si l’océan avait pressenti l’humeur du ciel. Deux jours plus tard, alors que nous parvenons enfin à nous extirper du tourbillon marin, s’abat sur nous un orage. Géraldine tient la barre d’une main, l’écoute de génois de l’autre, et un seau entre les jambes pour récupérer la pluie. Julia blague en disant que c’est le moment ou jamais de prendre une douche. On se regarde et en moins d’une minute, nous sommes tous les cinq sur le pont, avec savon et brosse à cheveux. On profite de la fraîcheur de l’air, nous qui avons si chauds depuis notre arrivée en Equateur.
Puis, en un instant, avec cette puissance que seul connait le large, le temps change et la pluie devient torrent, le jour se déguise en nuit, et le son assourdissant du tonnerre nous fait rentrer la tête entre les épaules. On se met à compter. La foudre éclaire un pan de l’horizon sans zébrer les nuages. On range les vêtements laissés sur le pont, les bouts mal lovés et se prépare à ce que le vent monte. Puis une autre basse tonne, plein son, plus proche. On compte à nouveau; l’éclair perce les nues et frappe l’océan en un trait vif et net. Sublime, et terrifiant.
Géraldine, qui continue son quart à l’extérieur alors que nous sommes rentrés nous sécher, crie d’éteindre tous les appareils électroniques du bateau et de ne pas toucher ni le mât ni la coque. On coupe l’AIS, l’ordinateur de bord, nos portables. Seul Toto le pilote auto est mis à la barre pour permettre à notre capitaine d’échapper au déluge et de nous rejoindre dans l’habitacle.
Une petite heure passe. Nous attendons que la tempête s’apaise en surveillant tant bien que mal les environs à travers les hublots embués. Nous venons d’entrer dans une nouvelle zone, en grand fracas : ici les vents convergent et ameutent les orages. Nous n’aurons plus une nuit sans éclats, tous nos quarts nocturnes se déroulent entre bruits de tonnerre et grandes percées de lumière. “Johnny au stade de France!” écrit Géraldine dans le livre de bord. Les descriptions de l’horizon y deviennent monnaie courante, en plus de tous les jeux de mot, les chansons, les blagues qu’on s’y laisse, à demi-mot, un peu caché, un peu bravade.
L’équipage est moitié amusé, moitié apeuré par cette ambiance étrange. Je me lève plusieurs fois par nuit pour vérifier l’état du ciel et surprend mes compagnons qui dansent, qui chantent, des écouteurs dans les oreilles et le regard suspendu aux étoiles qui parviennent à poindre sur le toit noir qui s’est installé. Chacun son style de musique, chacun son pas : Polo avec de grands gestes de chef d’orchestre, Julia les poings serrés, le son jusqu’au bout des ongles. Vianney et Géraldine écoutent des livres audio, elle des cours d’histoire, lui un roman rocambolesque. Ils ont l’air concentrés ou alors distraits. Les mots sont comme les vagues, parfois on suit, parfois on se laisse porté.
Moi je traverse une zone de silence, entre tous ces changements de terrain, la mer de plastique, le ciel blanc foudre. J’ai l’impression de perdre pied dans ces éléments que je croyais commencer à connaître. Alors que j’essaye de me ressaisir, l’océan me convainc que je ne sais rien, que je ne saurai jamais rien. Vianney prépare des crêpes en cuisine quand je sors un instant sur le pont avec Polo. On découvre alors qu’un spectacle extraordinaire se joue à l’extérieur, sans un bruit : les vagues provoquées par Tortuga sont devenues fluorescentes. On en perçoit le contour et les remous avec une précision indescriptible. Le plancton est si vif que lorsqu’un poisson nage sous l’eau, on devine sa forme à la trace lumineuse qu’il crée en surface. La mer semble soudain très habitée, tous ses habitants proches devenus visibles. On se croit au bout de nos surprises, déjà la mâchoire pendue et l’oeil éberlué, quand soudain une horde de poissons volants surgissent des flots et provoquent un véritable feu d’artifice au-dessus des vagues. Vianney a l’idée de plonger un seau et de ramener quelques litres de paillettes à bord. On y met la main et crée comme ça des champs d’étoiles qui collent aux doigts. On oublie le ciel et ses éclairs, le nez pendu à ce nouveau composant qui porte notre bateau, plus beau et lumineux qu’une voie lactée. Je suis prête à croire à tout quand Géraldine, lors de notre changement de quart, m’appelle à l’avant. A quelques mètres se trouve une marée de boules blanches. Je ne comprends pas ce qu’on regarde, avant qu’elle me dise que c’est l’écume des vagues qui brille au large. Une risée de vent soulève devant nous des moutons d’étoiles. “C’est impossible…” je m’entends murmurer. Ma capitaine me regarde, un sourire fin.
L’impossible n’est pas marin.
Encore quelques jours. On traverse le pendant du sinistre “pot aux noirs” de l’Atlantique. Ici on l’appelle plus joliment ICTZ, soit zone de convergence intertropicale pour les intimes. L’absence de vent contraste avec le rendez-vous que ce sont donnés les orages. La chaleur en journée, avant que ça n’explose, est insupportable. On se baigne presque quotidiennement, malgré la peur qui nous tient de croiser requin, raie ou méduse après les avoir admirer de près aux Galapagos. Ce qu’on vit sur la côte ne se compare pas au ressenti que provoque la pleine mer. A quatre dans l’eau, l’un de nous reste toujours sur le pont pour une veille attentive. On se persuade qu’il est possible de voir venir les ailerons, les jets d’eau. On nage un oeil par-dessus l’épaule, les doigts de pied repliés.
A chaque fois qu’on saute, j’ai l’occasion d’admirer la progression des pousse-pieds sur la coque de Tortuga. Ces petits molusques, qui ont vraiment une forme de jambe, ou plutôt de chausson de Noël, ont planté racine sur notre acier et se sont mis à faire des grappes, des bouquets d’orteils. On les adopterait presque s’ils ne nous ralentissaient pas autant et s’ils ne faisaient pas rougir notre Tortue, qu’on tente de garder coquette. La peinture de sa coque a pris quelques gnons, quelques coulées couleur rouille. Je me rappelle lorsque nous étions au chantier de Paimpol et que Géraldine m’avait confié la tache de repeindre nettement sa belle ligne blanche. Elle a bien changé depuis.
Les notre aussi, d’ailleurs. Ma capitaine a les jambes plus dodues qu’à notre départ, la plantant toute fine de la taille, et bien musclée des bras, sur des pattes de marin qui ne marchent pas souvent mais sont capables de monter au mât, de donner la force d’hisser une voile d’un tour de hanche. Des rides de soleil sont apparues à la naissance de mon cou, en bordure de mon décolleté. Elles font concurrences aux vergitures qui me strient le haut des cuisses comme si j’y avais dessiné les branches d’un arbre. Voilà ce que c’est de mincir toujours en mer, reprendre un terre, tomber malade au large, se réconforter une fois à table… Le voyage nous change physiquement. On l’a dans la peau, sans exagérer. J’ai commencé à avoir des cheveux blancs en Asie; peut-être reviendrai-je vieille de ces traversées. Comme je l’écrivai alors, je finirai poivre et sel, et c’est mieux qu’insipe.
On arrive. Bientôt va apparaître le halos diffus des lueurs de Panama City. Avant de changer d’océan, nous allons quitter l’Amérique du Sud pour rencontrer l’Amérique Centrale. A croire qu’une métamorphose ne se vit jamais seule. Et pour cause : notre capitaine va fêter ses trente ans à bord, en mer, entre deux continents, deux océans, alors que son rêve commence à finir et que de nouveaux se mettent à naître. Ce sera une journée mémorable, qui se finit par une dernière baignade avant de rentrer dans le canal et de jouer à cache-cache avec des porte-containers et des voituriers plus hauts que des immeubles. Les copains ont organisé toute une chasse au trésor dans le bateau, “Tortuga n’a jamais paru aussi grande !” s’exclame sa propriétaire. Après plusieurs énigmes et jeux de piste, notre capitaine s’engouffre dans le placard à voile et en ressort une énorme bouée flamant rose. On la gonfle sur le pont et la jette à l’eau, attachée par un bout. Cinq gamins dans le golfe de Panama, à la dérive. Le soleil se couche lorsqu’on ressort, nous offrant un magnifique crépuscule. C’est le dernier que nous vivrons dans le Pacifique. Une baleine, soudain, nous accompagne. Le son du jet, et dos noir.
Julia vibre.
Terre. La bulle éclate.
Mes fantômes, les orages, mon équipage. Plus une seule banane.
Ce sentiment indicible de perte, découvert après le convoyage, après la Transatlantique. Polo et Julia se le prennent en pleine poire. Je les observe observer le délitement de ce qui était soudé. Le tonnerre tonne encore, parfois jusqu’à faire trembler les vitres, mais ce n’est plus qu’un souvenir. Ce qui est vécu en mer reste en mer.
Lui appartient.
Jardin de la villa de Daniel Adum, assis de face à droite, en compagnie de trois artistes lors de la résidence de Salinas