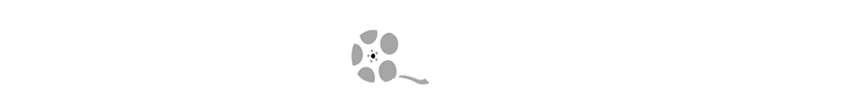Nous avons quitté Puerto Williams après cinq jours d’une grande tranquillité. La petite ville australe sert de base militaire et les maisons blanches s’y enchainent, dortoir coquet qui accueille des hommes en uniforme, sévères et pourtant tout sourire, imposant et doux dans leurs manières. Ils semblent là en vacances. On s’adresse à eux d’un geste de la main et toujours, ils nous demandent si on a besoin de rien. On est au bout du monde un peu comme chez nous et l’envie de partir ne se fait pas sentir.
Gilou, Stéphane et Géraldine travaillent sur le bateau pendant que j’écris à la terrasse du musée ethnologique de la ville. C’est une grande bâtisse qui possède un mirador. Les vitres ouvrent sur le canal de Beagle et les plaines. Alors que j’ai les yeux dans le vague, concentrée sur les mots, des chevaux se mettent à galoper dans le jardin qui encadre le bâtiment et font tout un fatras que personne ne remarque. Il y a en arrière plan continuel de tout ce qu’on regarde ces montagnes, et le canal.
Le musée est parfaitement silencieux, rares sont les touristes. Je rencontre le directeur pour évoquer avec lui la possibilité d’une projection de nos films et il m’ouvre sa salle de projection, pour le soir même ou le lendemain. Simplement, me dit-il, il n’y aura pas de public. Personne ne va au cinéma ici. A moins que les œuvres concernent directement leur ville, précise-t-il tout de même. Je lui demande le pourquoi d’un tel désintérêt, dans un village où l’absence d’événement nous avait fait croire que nous ferions un tabac. Il me répond que c’est comme ça que sont les gens ici et qu’il n’y a rien à chercher. Très bien. Nous ne ferons pas de projection car nous n’avons pas le temps de faire du porte à porte pour faire connaître notre projet, mais j’aurais aimé diffuser Bandera Preta et O Beijo ici. Une autre fois.
Dans une des salles, des pancartes expliquent la signification des peintures faciales des indigènes. Des lignes pour la puberté, d’autres pour le mariage, le passage à l’âge adulte, la chasse, la pêche. Les récits sont basés pour la majorité sur le témoignage d’une femme nommée Cristina Calderon, dernière représentante d’une des ethnies locales. C’est une vieille dame dont on croise souvent le visage. On croirait que ses histoires datent d’un millénaire; elle est née en 1928 et vit toujours. L’espace-temps de cette région est insaisissable. Nous qui sommes de passage, nous ne pouvons que tendre la main vers cette histoire sans la toucher, sans la sentir. Un souvenir qui nous échappe.

Photographie de deux hommes Selk’nam, une ethnie proche des Yaghans, vivant également en Sud Patagonie et Terre de Feu
Aujourd’hui Puerto Williams sert avant tout de point de départ aux grandes aventures marines. Les navigateurs qui empruntent les canaux de la Terre de Feu cherchent à rejoindre le Cap Horn et l’Antarctique. Nous en avons rencontré au Micalvi, le bateau échoué qui sert de capitainerie à Puerto Williams. Un équipage de huit Polonais qui échangent des chansons de beuverie contre les mélodies douces de Géraldine. La soirée continue à bord de leur navire, et on leur fait manquer leur départ matinal à coup de rhum et d’anecdotes. Comme tous ceux qui s’aventurent dans ces eaux-là, ce ne sont pas des marins de pacotille. Tous, ils sont Cap-horniers, et connaissent les reliefs du Pôle. Parmi leur équipage il y a une femme, Eva, qui semble plus forte et volontaire que tous les autres gars réunis. C’est sûrement ce que ça demande, pour être équipière dans un équipage d’hommes sur un brise-glace. Elle me raconte que, si atteindre l’Antarctique est difficile, rien n’est plus dur que les navigations à l’extrême Nord. Cela fait huit ans qu’elle et son capitaine, un grand bonhomme à barbe du nom de Majeck, vont d’un bout à l’autre du monde à la recherche de la glace. C’est ça qui leur plait, le pilotage entre les icebergs, les quarts de nuit par des températures impossibles, tout en défi, tout en bravade. A côté d’eux, on ne fait pas grosse mine, et notre petit bateau en acier semble fragile. On échange nos numéros de téléphone satellite, qu’on n’hésite pas à les joindre en cas de pépin, et peut-être rendez-vous à Panama dans quelques mois.
Ainsi le Cap Horn garde-t-il son statut de mythe, malgré le fait qu’existent à présent des ferrys pouvant transformer des centaines de touristes en Cap-horniers en un aller-retour, coup de magie à 2 000 euros qui coûte plus à la légende marine qu’aux gros porte-feuilles.
Une dernière fois avant de larguer les amarres, on réfléchira à tenter tout de même ce grand Cap, quitte à renoncer à huit jours de navigation de canaux en canaux, criques en criques. Ça nous fait rire et nous partons dans les eaux calmes de Beagle, sans un regard en arrière.
La beauté de ce qui s’ouvre devant nous est paisible, et silencieuse.

Le canal de Beagle devant Puerto Williams
Assise sur le rivage, je regarde Tortuga. Gilou, à côté de moi, allume une cigarette qui flambe un instant dans la pénombre du soir. Notre navire est posé sur une mer transparente et immobile. Amarré avec deux bouts à l’arrière et l’ancre à l’avant, la tortue joue à l’araignée de mer, et ne bouge pas d’un pouce. On se dit, le marin et moi, que ce bateau a enfin atteint le milieu pour lequel il est fait. Le grand Sud, blanc et vert comme ses lignes. C’est la première fois qu’il descend aussi bas, et nous aussi.
Pourtant, tout nous donne l’impression d’être tout, vraiment tout en haut. Le sommet des montagnes, à la lisière de l’eau. Un vague espace de terre en cascade, la pointe accrochée aux nuages et la base immergée, submergée par les marées, les vagues du mauvais temps. Le monde se mire dans une mer traversée de glace. La neige à la cime, et les arbres penchés par le vent sur les flancs. Ces montagnes sont les dernières, après on ne parlera plus que de glaciers et d’étendues blanches. On y plonge, chaque soir, après l’amarrage, en forêts vierges, forêts humides et froides, pourtant si vertes, si vives.
C’est un coussin plus qu’un sol. Tout y est mou. Les arbres tombés se transforment en mousse ; la terre est marécage. Ce qui est dur reste près du visage, les pieds flottent de matelas en matelas. Parfois on s’enfonce jusqu’aux genoux. Nos bottes, qu’on n’enlève plus. Les mains qui cherchent à tenir, et étreignent. Une forêt comme un câlin qui pourrait nous engloutir. Pourquoi partir ? Je n’ai jamais été aussi bien. On navigue au moteur et j’écris, monte nos films de voyage, lis toujours Coloane.
Celui-ci raconte dans une des nouvelles du recueil Tierra de Fuego que les phoques vont au Cap Horn accoucher de leurs petits. Je pars de là. Il faut écrire le scénario du prochain film. Je ne sais pas par où commencer et c’est Gilou, ce soir-là, qui me donne la clé. Nous sommes au sommet. Question de carte. Renversons la et cette géographie prend sens. Qui a dit que le Sud était en-dessous du Nord ? Les pays de l’Europe bien posés sur ceux d’Afrique. Ce hasard.
On joue à l’histoire inverse et prend pour personnages la tribu des Yaghans, aussi appelés Yamanas. Je les retourne en Anamays et raconte les femmes qui pêchent les moules, les hommes couverts d’or. Ils naviguent d’île en île dans des canots où brûle un feu tenu par des pierres. Leurs habits s’arrêtent à la taille, une peau enroulée sur les hanches et à peine un pan de fourrure sur les épaules. Les Européens les nomment « nomades en canot ». Comme si on pouvait naviguer et être fixe. Je ne sais plus quoi penser de ces regards, ce continent donne trop l’impression de ne pas être ce qu’il devrait. A peine né, il semble vieux déjà. On vit ici dans le souvenir d’un temps qui a définitivement disparu, une jeunesse qu’aucun de nous n’a vécu. Ce qui a été construit est beau et valable, mais qu’y avait-il d’autre ? Si les Européens avaient bien lu leurs cartes, touché les Indes. Que ce monde-ci reste intact.

A terre
On se raconte des histoires, Gilou et moi, assis sur un tas de mousse les fesses humides, les mains froides. Une musique douce s’élève du ventre de Tortuga. Géraldine, Stéphane et Thibault ont mis du Chopin et cet instant est irréel. Je le grave en moi. Y reste.
Demain dès l’aube, nous repartirons voguer dans les vallées inondées, entre les arbres. On voit la terre en permanence, et l’horizon. A l’ouest se profile petit à petit l’océan Pacifique, on y débouche parfois et son impétuosité contraste avec le calme de Beagle, nous rappelant que nous sommes toujours en mer malgré la sensation de lac, de rivière. Passent les jours au son du moteur, le pilote automatique branché presque en permanence, les voiles en grève. On ne tire pas de bord entre les falaises. Le vent vient de face et nous n’avons pas le temps de manœuvrer au près. On avance, vitesse constante, et je dois admettre trouver mon bonheur dans cette allure bruyante mais stable. Je peux enfin poser ma caméra sur le pont et laisser tourner. Ce qui défile dehors, tout est à garder.
Plus que les canaux, je me repais des forêts, de tous ces verts gris, rouges bleus, qui ornent la terre et la font disparaître sous un dégradé improbable de nuances saveur mousse. Chaque soir, nous entrons dans une crique protégée du vent et amarrons Tortuga aux arbres. Troncs morts ou vifs, nos nœuds marins se mêlent aux branchages, s’ajoutent au labyrinthe. Debout dans l’annexe, l’un de nous emporte la fin d’un bout de cent mètres et le mène jusqu’au rivage, ondoyant dans l’eau avant d’être tendu à bloc. On attache et tire, ramène la tortue le plus près du sol, au loin des vagues.
Ensuite mes compagnons descendent, rejoignent la rive. Je les regarde et dans ces moments-là, me sens loin d’eux. Ces marins perdus en terre ferme. Ils sont beaux dans leurs vestes de quart, leurs habits de mer. Bottes de caoutchouc gris, capuches jaune pétant. Découvrant la plaine, ils me donnent la sensation d’évoluer là malgré eux, comme s’ils s’étaient trompés de voyage et qu’ils arrivaient tout équipé pour l’océan dans un bain de vert pur. Habitués au grand large, ils écartent des doigts les feuilles de leur visage. L’horizon ici est en millimètre. Gilou s’agenouille et photographie le monde qu’il y a sous nos pieds, dans les toisons.

Un marin en forêt
Le toucher est pleine surprise: parterre duveteux et mer rigide, des morceaux de glace qui bruissent en explosant à l’étrave. Un éclat comme une mélodie. On dira qu’on est en terre hostile; on dira que dormir ici n’a jamais été aussi doux. Ce sentiment d’être entourés de ce qu’on est venus chercher. Occuper la beauté et l’inconnu comme une demeure, porte fermée, fenêtre sur tout. Notre périple vient de prendre un nouveau tournant, et pour la première fois je touche du doigt un absolu rêve d’aventure. Enfin, c’est Le Nouveau monde de Conan Doyle. Nous traçons les sentiers à la force de nos pas. Montons par où nous plait. Descendons par où on peut, accrochés aux arbres, pliés sous les branches et les épines.
A part les pêcheurs qui viennent chercher oursins et araignées de mer, presque personne ne s’arrête ici. Ceux qui le font sont de passage, ils laissent des pancartes avec le nom de leur navire et une date. Certains se sont même amusés à faire des mannequins en tissus et à les habiller de cirés. On les voit de loin, oranges ou jaunes sur le gris pâle des fins de journée, et je me rappelle les ombres qui nous accompagnaient parfois au large, lorsque nous longions la Patagonie argentine.

Forêt, Stéphane et Gilou
Stéphane m’accompagne. Alors que Géraldine, Thibault et Gilou restent près du rivage ou sur Tortuga, je m’enfonce avec mon ancien second au plus profond de ce que permet la forêt. Passage autorisé, forcé entre les pierres et la terre meuble, des branches comme des prises, des poignets de porte vers un monde que j’espérais et qui me bouleverse. Chaque mètre gagné est une victoire contre la vie commune. Je tiens l’aventure dans ma main et serre, serre pour que pas une seconde ne s’échappe. Je voudrais crier à Stéphane que je l’aime d’être là, et que ce monde nous appartient.
On crie ensemble. Parle pendant des heures de tout ce qui nous anime, ce qui nous touche, ce qui “nous enlève un peu de plaisir” comme dirait la Laurence du film de Dolan que nous avons découvert ensemble. En somme, nous parlons d’amour. Puisque c’est là tout ce qui dirige nos vies. Nous frôlons aussi la politique, l’économie, nos croyances terre à terre en un optimisme résolu. Il voudrait que j’admette que le capitalisme pourrait être pensé différemment, et devenir plus juste, plus fraternel. J’essaye de le convaincre que la pauvreté et l’exploitation sont des conséquences directes de ce système et nous tournons en rond jusqu’à nous perdre, descendant les falaises en s’aggripant aux feuillages humides, le ton qui monte, les joues chaudes, l’amitié en combat et toujours victorieuse. Ses amours sont libres, les miennes tortueuses. On voudrait vivre vieux. On voudrait pouvoir embrasser n’importe qui et qu’on nous laisse en paix. S’allonger sous les arbres. Il croise une cascade et se jette dessous, tout habillé, les bras au ciel – toute existence, toute reconnaissance, nous sommes au sommet du monde et jamais ne redescendrons.
Un temps comme la préhistoire. Une semaine. Thibault debout sur le pont, Gilou à l’étrave. Géraldine, une reine qui nous offre le dernier royaume. Fidélité à toute épreuve. L’équipage est entré dans la mémoire comme une aiguille dans la peau. Ineffaçable.
On lève l’ancre.

Stéphane, lors de nos balades