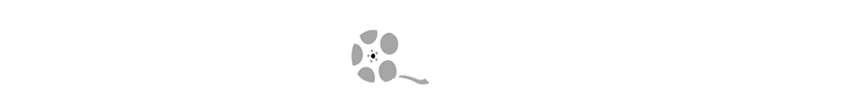A la sortie du Canal se trouve une marina isolée, nichée dans la mangrove. Elle est à plusieurs kilomètres de Colon, la ville la plus proche, mais souffre avec elle d’une réputation néfaste. L’une est une cité connue pour sa criminalité et sa pauvreté, l’argent ramassé par le Canal ne passant jamais ses portes bien qu’elle soit le pendant de Panama Ciudad sur la côte atlantique; l’autre est un des Yacht Club les plus chers du pays, une ancienne base américaine qui n’a préservé de son ancien luxe qu’une piscine et un restaurant, murs blancs, cernés d’arbres. Deux versants d’un même extrême, dont aucun nous rassure. On se rend malgré tout à cette marina pour débarquer Polo, dont le voyage à nos côtés s’achève, et effectuer les démarches de sortie du pays.
Je crois que je me souviendrai longtemps de notre entrée dans ce lieu. On navigue d’abord une heure vers le Nord, puis commence notre approche de la côte. Alors qu’on se dirige vers le Yacht Club, nommé Shelter Bay, apparaissent autour de nous des épaves de tankers. Certains sont retournés et on ne voit affleurer que la ligne épaisse de leur ventre immense, pan de rouille flottant au-dessus des eaux près de la rive. D’autres sont penchés sur le côté, comme endormis sur une épaule invisible, et continuent d’être submergés par les marées, les mouvements de lune. La berge est une forêt sans interstice, sans air. L’étroit chenal qui mène jusqu’au Yacht Club y tranche comme un tunnel. On s’y engouffre, Géraldine les yeux braqués sur le profondimètre, Paul à l’étrave pour guetter le fond. En quelques secondes, on passe de 10 à 5, 3, 2 mètres. Marche arrière. On appelle à la radio et l’agent de la capitainerie nous assure que ça passe. On recommence, lentement.
Entre les arbres, posées sur la mangrove ou la pelouse du port, des épaves de voiliers s’acharnent également à mourir. Géraldine ne s’en préoccupe pas; j’en suis troublée. Leurs voiles pendent, lambeaux d’anciens porte-vents, drapeaux de voyage définitivement terminés. Les coques trouées semblent grincer en silence, pour toujours immobiles. Et tout autour, la forêt tropicale, plus luxuriante que l’Amazonie, plus étouffante et comme plus jeune, plus verte. Une végétation qui se nourrit directement de la mer, des orages.
Ce port donne la sensation d’être ancré sur un cimetière où règne une vie nouvelle et sauvage. Même les catways bien alignés à l’européenne ne gagnent pas contre cette atmosphère mystique et mortuaire. Une piscine, un restaurant-hôtel de deux étages, perdus là, moins réels qu’un mirage. Bâti sur un passé irrémédiablement révolu, le luxe se pare d’une pellicule grave et sinistre indémodable. Malgré ceux qui les habitent encore, ces bâtiments ne parviennent pas même à contraster avec ceux, innombrables, qui les entourent en silence. Anciennes casernes militaires, vieux hôtels aux portes encore grandes ouvertes, une église où trainent quelques pages arrachées du Nouveau Testament : la nature reconquière, au gré du temps, ces territoires. On se balade sur les routes comme sur des sentiers, entre deux écrans d’arbres. Le hurlement des singes, malgré le béton, me glace.
Géraldine et Paul s’échappent quelques heures, les pieds dans la boue, les cheveux inondés d’une pluie qui, plusieurs fois par jour, habille le ciel et la terre d’un torrent uniforme. Je reste à travailler dans le cocon du lounge américain, Jérémy et Polo dans l’eau d’une piscine froide, Edgar jamais loin. Ce lieu m’hypnotise; on tente de le fuir mais il nous retient prisonniers trois jours entiers dans son écrin gris vert. Nous avions été étonnés à la capitainerie de Balboa que les démarches d’entrée soient si rapides et faciles; on comprend maintenant pourquoi : nous avons été considérés comme en transit et non en séjour. Il nous manque plusieurs papiers de la douane et de l’administration portuaire, si bien que nous nous retrouvons involontairement dans une situation illégale, qui nous cloue à terre.
Géraldine oeuvre seule à rétablir ces erreurs, elle discute avec plusieurs employés du Club jusqu’à rencontrer un agent qui lui dira bien vouloir l’aider “pour ses beaux yeux”. Avoir une femme pour capitaine peut être un inconvénient, Lima nous l’a prouvé, mais aussi un avantage. En fonction du cliché, du désir qui règne. Cet homme, un Panaméen aux longues rastas noires, nous demande une certaine somme pour accélérer la procédure et nous permettre de partir sous quarante-huit heures. On va fouiller nos fonds de sac, n’ayant pas accès à une banque, et lui amène un petit tas de billets, deux cent dollars, qu’il empoche avant de partir régler notre affaire.
Il nous prévient de la magouille : puisque nous sommes en transit, nous n’avons passé que quelques jours au Panama, et seulement à Shelter Bay. Officiellement, nous ne sommes jamais allés à la marina de Balboa, ni à Panama Ciudad. Autrement dit : Tortuga n’a jamais traversé, ni même approché le Canal. Notre voyage en Pacifique et les écluses, passés sous silence. Le navire est partie d’Equateur et pouf, est apparu de l’autre côté…
Sans aucun doute, cette marina est magique.
Avant de recevoir enfin le coup de tampon qui nous rendra libres, sonnant à nos oreilles tel le marteau d’un juge, Géraldine terrifiée d’avoir eu à mentir à une agent des douanes en face à face et nous soulagés qu’elle y soit parvenue, nous nous asseyons un instant au bout d’un de ces cateways qui nous manquaient tant. A côté de nous, un navire nommé “Inch’allah”. On le prend comme fond de toile à cet instant, ma capitaine et moi, et nous nous demandons ce qui peut bien se passer, à Carthagène ou au large, pour que le hasard veuille à ce point retarder notre départ. La Colombie est pourtant un des pays que nous attendions le plus et chaque jour ici est un jour en moins là bas. On s’inquiète du temps que nous allons avoir pour faire à nouveau des courses, de l’eau et du gasoil pour la traversée suivante. On doit en plus sortir le bateau avant la Transatlantique pour refaire l’antifouling, ce qui implique de trouver un chantier pouvant prendre en charge Tortuga de façon sûre et efficace. Sans bien sûr parler de notre atelier, dont la possibilité d’existence est chaque jour un peu plus remise en cause.
Pour finir nous apprenons que notre contact à Carthagène, un homme du nom d’Alvaro rencontré au Salon Nautique par l’intermédiaire de Paul, est en fait en voyage aux Canaries et que rien n’est organisé pour notre venue hormis une place dans la marina El Manzanillo, gérée par sa famille. Andrès et Alejandro, arrivés depuis quelques semaines en Colombie, ont retrouvé Julia à Carthagène et ont subi comme nous cette mauvaise nouvelle. On leur envoie le pré-scénario rédigé et tous les contacts culturels que Géraldine et Paul ont pu réunir. Hors de question de renoncer à notre atelier colombien alors que celui de Panama a été annulé : à eux trois, ils prennent les choses en main malgré le manque cruel de temps et se mettent en recherche d’une salle de travail, de participants et d’un lieu de projection. Nous serons obligés de larguer les amarres sans savoir si leurs missions vont aboutir ou non, et sans plus pouvoir les aider. Je suis malgré tout assez enthousiaste de la situation : Andrès a été nommé réalisateur de ce film et j’ai hâte de suivre sa méthode de travail, lui qui nous a transmis ses techniques pour élaborer un storyboard en collectif et établir une atmosphère de groupe à la fois agréable et productive. Car quoi qu’il arrive, film il y aura, même si ça doit être un nouvel Arica en prises de vue réelle, un timelaps de photos accompagné d’une voix-off, une série de micro-trottoirs ou un nouvelle forme que nous ne connaissons pas encore : Carthagène des Indes sera dans la boîte, coûte que coûte.
Aussi part-on malgré tout le coeur tranquille. Le délai imposé par les méandres de l’administration a laissé place à une fenêtre météo inespérée : le vent a chuté, nous allons pouvoir rejoindre la Colombie en douceur plutôt qu’au près dans des rafales, des prévisions très rares pour cette zone. Edgar et Géraldine ont du mal à y croire, et pourtant notre navigation, cinq jours à peine, se déroule effectivement comme annoncée : le temps, un peu fort les premières heures, le pauvre Jérémy vite vaincu par le mal de mer, s’apaise dès la première journée. J’arrive à maintenir les nausées à distance en chantant le thème de Pirates des Caraïbes, debout à la barre, accompagnée à la guitare par Edgar.
Paul, qui attendait désespérément de pouvoir partir en mer après l’attente à Balboa et Shelter Bay, est comme un poisson dans l’eau. Il me rappelle l’aisance décontractée de notre chef mécano Thibault, toujours en short et souvent la clope au bec, maniant le gouvernail comme s’il avait fait ça toute sa vie. Il apprend vite à tenir le livre de bord et à comprendre les allures, et au bout d’un ou deux jours devient parfaitement autonome. Edgar et lui seront presque déçus du calme de cette navigation, attendant plus de la mer et des orages, alors que Géraldine et moi profitons d’un repos qui ne sera certainement plus rare en Transatlantique.
Nous arrivons finalement à Carthagène des Indes un mardi matin, avec départ prévu le samedi suivant. La première journée est consacrée à Tortuga et sur ce point nous sommes accueillis avec une excellente surprise : la marina où on s’amarre possède un chantier où se trouve tout le matériel nécessaire pour sortir le bateau de l’eau, refaire l’antifouling, changer les anodes, vérifier les haubans et réparer le génois qui a fini la traversée avec un morceau de scotch sur une partie de sa base, déchirée sur plusieurs centimètres. Géraldine discute avec le propriétaire, un marin sympathique nommé Maurice, et celui-ci se met immédiatement en mouvement pour nous aider et nous permettre de tenir nos délais impossibles. A peine quelques heures après notre arrivée, Tortuga est déjà la coque à l’air, le safran et la quille soudain à nues. Je ne l’avais pas vu comme ça depuis le chantier de Paimpol, il y a plus d’un an. On passe en-dessous et touche de la main cette partie intime de notre navire, d’habitude invisible et inaccessible. La carapace a bien rouillé depuis notre départ, certains pans de peinture se détachent d’une pression d’ongle. Ces reflets cuivrés ont d’ailleurs commencé à saupoudrer nos vêtements; nous avons tenté de les faire disparaitre en frottant et râlant fort, puis on a accepté de se vêtir à l’unisson avec notre espace, quitte à faire quelques sacrifices. Ces tissus, comme le temps qui les marque, sont irrécupérables : ce seront des souvenirs.
Les anodes, sorte de pierres de métal qui empêchent la coque d’être mangée par l’électrolyse, sont inspectées et remplacées. On enlève une partie des haubans, le pataras et le bas étai, ce que je croyais impossible, et le mât se retrouve comme en équilibre, piquet fragile planté au milieu du pont, démuni sans sa toile de fils et de cordages. Géraldine suit ces changements dans son territoire depuis le sol, les yeux levés et inquiets, puis saisit une échelle, la cale sur la jupe de la Tortue, et remonte à bord.
Alors que le soleil décline, nous prenons chacun un petit sac d’affaires et, pour la première fois depuis le départ, l’équipage entier quitte le navire, confié à d’autres mains, pour résider à terre. Nous prenons un taxi pour le centre ville de Carthagène des Indes. A peine arrivés dans une de ses rues principales, nous croisons à quelques minutes d’intervalle Andrès, Alejandro, Julia et une jeune femme du nom de Valérie, qui nous avait déjà aidé en France à chercher des sponsors et à préparer le projet. Alors soudain, par la présence des nôtres plus que par le sol sous nous pieds, nous nous sentons vraiment arrivés, et accueillis.
Panama se termine et la Colombie commence. On répartit nos sacs sur les lits disponibles d’une auberge, et ressort immédiatement découvrir cette nouvelle capitale, notre petit groupe devenu une sacrée bande. Cette rencontre débute de nuit; elle se renouvellera toute la petite semaine que notre aventure nous permettra de passer ici. On vit au coeur de Carthagène, entre ses murailles ou en bordure, et profite de la frénésie des nuits pour voir parfois naitre les premières lueurs du jour au son de salsas ou de champetas, musique locale aux rythmes afros. Ce centre ville semble tiré d’un livre; non pas tel que les écrit Gabriel Garcia Marquez - “Gabo” pour ses compatriotes -, subtils et tout en filigrane, en touches de mystère et de magie, mais plutôt dans le style d’un conte féérique moderne, rose et parfumé et pourtant décalé, en déséquilibre. Chaque ruelle est une peinture. Une maison pour une couleur, teinte pastel ou aplat vif, et toujours, découpés dans un mur, ces balcons aux barreaux de bois sculptés qui ont fait la célébrité de la ville, son plus grand charme. Des arbres sont plantés au pied des façades, ils longent la pierre pour finalement exploser au bord des fenêtres, des fleurs plus grosses qu’un poing ponctuant le décor de généreux bouquets rouges, jaunes ou violets. L’air semble ainsi échapper à la pollution ambiante, moins grâce au parfum qu’à l’amplitude de ces fleurs. Elles y prennent tout l’espace.
Les femmes se baladent dans cette boite à bijoux comme une série de perles, toutes plus éclatantes les unes que les autres. Les Colombiennes mettent la barre très haut; les touristes tentent de suivre. Les premières jouent le règne de la peau nue, les secondes se parent de tissus nobles, signés d’un bracelet ou d’une paire de boucles d’oreilles. Baskets et casquettes ne semblent pas autorisées à passer ces murailles, imprégnées d’un aura qui les dépasse. Sur la place centrale, de l’autre côté des portes, des calèches attendent. On y voit des Blancs, mais aussi toute une population glamour venue du continent.
Jamais une cité sud-américaine ne m’a autant rappelé l’Europe et sa collection de “centres historiques”. Comme certains des nôtres, ce centre ville est vendu aux touristes avec une violence toute particulière. D’abord ghetto dépourvu de la nouveauté des tours et des constructions modernes, ses magnifiques demeures en ruines ou décrépies, cette ville dans la ville a pris petit à petit un essor porté par l’argument de l’héritage culturel et architecturale. C’est une mise en valeur du patrimoine qui a souvent pour conséquence de mettre sur le banc de touche les résidents actuels, les privant d’infrastructures utilitaires pour développer boutiques, hôtels et cafés dont les prix les excluent de fait. Ils s’adressent en priorité aux étrangers, répondant à une certaine catégorie de leurs désirs et de leur imaginaire et, évidemment, aux possibles de leurs portes- feuilles.
Dans le même esprit, certaines princesses déambulant dans les rues s’arrêtent sur la place à une certaine heure. Elles se mettent en ligne, presque distraitement, et attendent, seules ou en groupe. Des hommes passent, s’approchent, en enlèvent une dans un mauvais carrosse ou reculent, recommencent. Un autre bal, qui rappelle dans l’ombre les anciennes files qui se tenaient sur cette même place, il y a plus d’un siècle. La Colombie, irriguée par l’Afrique, a aujourd’hui deux coeurs, deux teintes, dans un même dégradé. Alors que ce mélange est né dans l’horreur et la honte, il continue dans la joie et la musique. Alors que la complexité de l’Amérique Latine reste insaisissable, s’ajoute encore l’épaisseur des Caraïbes. En un an ici, nous n’aurons pas pu cerner tous les visages, toutes les humeurs d’un continent irrémédiablement disparate. Il y a pourtant un son, boléro ou salsa, qui résonne dans tout ce territoire. L’oreille, toujours attentive, perçoit maintenant des notes de zumba.
Assis ensemble à la terrasse d’un bar lors de cette première nuit de retrouvailles, Géraldine et moi écoutons Andrès et Julia nous faire un récapitulatif des avancées qui ont pu être faites concernant la résidence. Celle-ci a finalement commencé le jour même, soit avec quarante-huit heures de retard. Ça ne semble pas grand-chose, mais quand le temps de production est limité à cinq jours, c’est presque déjà le début de la fin. A écouter nos compagnons, rien n’a été facile, et beaucoup reste à faire. Julia a suivi la piste d’Alvaro pour rencontrer sa soeur Diana, qui préside une association oeuvrant pour le nettoyage des côtes de Carthagène et d’une île qui se situe juste en face de la capitale, Tierra Bomba. N’étant pas au courant du projet, elle a sauté en marche dans notre train et a mis immédiatement Julia en contact avec une enseignante de l’Ecole des Beaux Arts, située dans la rue principale du centre ville. Andrès, Alejandro et Julia ont rencontré ce professeur, Maria, et ont pu présenter le projet à une partie de ses élèves. Un pré-scénario a été établi avec eux en une journée, et l’idée est de les retrouver le lendemain pour faire le storyboard, la liste des oeuvres à produire et commencer le travail.
En parallèle, Diana a proposé à l’équipe d’organiser une visite à Tierra Bomba, de sorte à ce que les participants et les touristes que nous sommes puissent découvrir une autre réalité de Carthagène, et la retranscrire dans notre histoire. Celle-ci met en scène un poisson qui se fait attraper d’abord par un filet de pêcheurs espagnols, puis afro-latino-américains, pour finalement être libérés par des mains de couleurs de peau différentes. Andrès et Ale ont proposé ce récit après avoir consulté Maria et Diana sur ce qu’elles aimeraient raconter de leur région, et nous l’acceptons, reléguant au placard nos deux pré-scénarios. Malgré tout, je me permets de suggérer d’orienter la production d’images vers la prise de vue réelle pour palier au manque de temps et d’artistes. Julia nous apprend alors qu’un jeune groupe de Rap, les Familia Delta 9, ont suivi la première journée de travail et qu’il serait possible de leur proposer de faire un clip de l’une de leur chanson. C’est une idée qui me séduit, d’abord parce qu’elle implique de collaborer avec des jeunes qui pratiquent cette musique si particulière, agressive car exutoire, dont les paroles sont souvent politisées et témoignent du ressenti d’une génération; un son qui se veut avant tout témoignage. Ensuite parce que réaliser un clip en animation, même si on mêle le dessin à la prise de vue, est un nouvel exercice intéressant, qui pourrait faire varier nos formats.
Je le propose à Géraldine et Andrès et, à cet instant là, entre dans ce que j’appelle le puits infini des quiproquos bien intentionnés. A la fin de cette réunion nocturne, tout le monde se lève de sa chaise avec une idée différente de ce qui doit être fait, de comment ça doit être fait, et de qui doit le faire. Ce processus quasi-magique, car invisible et presque invincible une fois qu’il a pris de l’ampleur, se répand dans notre équipe sans qu’on s’en aperçoive. Dès le lendemain, alors qu’Andrès mène d’une main de maitre le début de l’atelier au sein de la classe de Maria et que Géraldine s’éclipse pour s’occuper du navire, je me retrouve perdue quant à ce que je suis censée apporter à cette résidence, ainsi que vis-à-vis de l’oeuvre même que nous tentons de produire. L’idée de clip est mise de côté, on reprend celle du scénario des élèves, demandant aux “FD9” de composer une chanson d’après ce scénario plutôt que de réaliser les images d’une de leur musique déjà existante. On aimerait malgré tout qu’il y est une danseuse, on en trouve une, elle vient avec nous le jour suivant sur Tierra Bomba et on la filme improviser des pas de Hip-Hop sur d’autres rythmes puisque nous n’avons pas encore celui de nos chanteurs. Des dessinateurs, élèves des Beaux-Arts ou professionnels, se mettent à peindre des poissons, des navires, des filets… Bien qu’on leur ait expliqué comment fonctionne l’animation, la plupart nous ramène des oeuvres, très belles, où les éléments ne sont pas séparés et donc inanimables. Valérie et Paul, qui sont également là pour le film, font bonne figure malgré le chaos manifeste de cette organisation de dernière minute, tirée dans tous les sens par diverses envies, diverses bonnes intentions, divers malentendus.
Un joyeux carnaval, qui nous fait perdre pied. En trois jours, les événements qui s’enchaînent sont si variés et si denses que nous avons la sensation d’être là depuis des semaines. J’en garde comme des flash, certains instants étant très clairs dans ma mémoire quand les autres semblent emmêlés les uns dans les autres. D’abord la vie extraordinaire de l’Ecole des Beaux Arts, une cour aux miracles où chaque banc, chaque recoin est habité par des groupes de jeunes gens pratiquant la contrebasse, la flûte, la peinture à huile sur un canevas appuyé au mur ou directement à plat sur le sol, la photographie argentique - ce “clic” de l’appareil reconnaissable entre tous -, le pastel gras ou le fusain, doigts noirs, le chant, tous en cercle et une demoiselle qui donne le La; et cette architecture de pierre inimitable, sans âge, qui transforme toute scène en un extrait de conte ou de roman.
Ensuite, le choc de Tierra Bomba : on prend une navette à moteur, longe la côte écrasée de tours d’immeubles de Carthagène - le nouveau centre ville pour les ceux qui veulent autre chose que des boutiques et des cafés -, traverse en quelques minutes et accoste une terre jonchée de détritus, où nous accueillent des enfants et quelques chiens. Diana et les autres membres de la Fondation Bahia mènent la visite. Maisons de parpaings, posées sur un sol de terre ou de sable. De grandes fresques, peintes par les élèves de Maria il y a quelques années pour sensibiliser la population à la beauté de la vie sous-marine, représentent des poissons, des étoiles de mer, des tortues. Un homme, éboueur le jour et chanteur la nuit, enregistre ses chansons dans un studio aménagé chez ses parents. Il nous fait entrer dans son alcôve, une pièce étroite, et, habillé en uniforme du service municipal, une ceinture de sacs plastiques attachée à la taille, balance sa dernière production musicale, le son à fond. Du Rap. Son habit parait un déguisement, une farce pour tromper les imbéciles, de même que la pauvreté du cadre dans lequel se place ce studio bien équipé. On applaudit et, entrainés par la musique, commençons à filmer notre danseuse, une jeune femme aux yeux allongés et noirs comme une chute, la taille fine et les gestes ronds, parfaitement fluides.
Paul la filme devant la mer, entre cette terre de misère et le faste outrageant de la rive d’en face. Des enfants ne cessent de lui demander ses appareils, il y passe une partie de sa pellicule. On monte en hauteur, vue sur l’océan, la ville et les déchets, et aperçoit de loin notre petite navette qui se remplit, tonne par tonne, des quelques détritus qu’elle pourra ramener de l’autre côté, pour les brûler ou les enterrer. On revient à côté de sacs de toile pleins à craquer, de ferraille, de tas non définis et, perdu là, un petit vélo rose, qui se dessine sur le paysage.
Un dernier soir. Après l’attente réglementaire sud-américaine, notre projection commence avec une heure de retard, mais un public. J’entends rire et applaudir, mais je ne participe pas : les Familia Delta 9 sont venus pour qu’on les enregistre. Quatre hommes, certains l’air plus jeune que d’autres, presqu’adolescents bien que l’un d’eux soit en vérité bientôt père de famille, la Colombie ayant sur ce point une horloge en avance sur celle française. Ils sont masqués de lunettes noires, parés de chemises à fleurs clinquantes, surprenantes, où a été cousu à la main l’insigne de leur bande, ce « FD9 » qui, comme tous les noms importants, a une explication à rallonge et parfois obscure. C’est un groupe dont on ne voit jamais le regard et qui pourtant parvient à faire flotter autour de lui une tranquillité, une énergie douce qui apaise. Si bien que même leur musique explose, on y perçoit tout de même des notes lyriques, des accents harmonieux.
Ils ont composé une chanson en une après-midi. Paul les filme, assis un peu en retrait, alors que je m’assois par terre, entre leurs pieds. Ils se penchent vers le micro. L’Alliance Française nous a prêté une salle de cours à l’acoustique malheureusement lamentable, et on fait ce qu’on peut. Ils se mettent à chanter et on enchaine les prises, retravaillant les fausses notes et tentant différents rythmes dans cette semi-improvisation nocturne, a capela. Lorsqu’ils auront fini, ils écriront sur un bout de papier une dédicace à un ami, Daniel, kidnappé un soir alors qu’il se rendait à un rendez- vous et retrouvé mort quelques jours plus tard à des kilomètres de là, près de la ville de Medellin. Ce chanteur avait écrit « un jour ma révolution ira jusqu’en France » et ses camarades ont vu dans notre projet l’occasion de rendre cette idée vraie. C’est comme ça qu’ils nous le présentent, ni plus ni moins : ils ont vu un signe dans notre arrivée et c’est en mémoire de cet ancien membre de leur bande qu’ils ont voulu nous connaitre et nous donner de leur temps.
Paul et moi écoutons ça et nous nous retrouvons soudain responsables de quelque chose qui nous dépasse. On sait déjà que ce film va être particulièrement dur à monter et je suis partagée entre la fierté et la panique. Voilà un défi qui ne va pas être facile à relever, sans parler du fait que la navigation entre Carthagène et Santiago de Cuba promet d’être une des plus sportives.
Andrès, Alejandro, Paul, Edgar et Géraldine embarquent le lendemain. Qui croirait cette demoiselle blonde est la capitaine d’un équipage si masculin ? On en plaisante en lui conseillant de se méfier des mutineries et des bouteilles de rhum cachées dans les fonds. Ils ont promis de tous se laisser pousser la moustache; notre chef de bord arrivera à Santiago avec deux fines bouclettes dessinées sous le nez, ce qui ne manquera pas de déstabiliser les douaniers cubains. Leur navigation va durer un peu moins d’une semaine, avec un vent fort qui les maintiendra plusieurs jours tribord amure, le côté le moins agréable de Tortuga et le plus dur à la barre. Géraldine, qui souffre de l’épaule, est mise hors quart pendant plus de 72 heures, le temps que le gouvernail soit de nouveau maniable. On les récupérera heureux de l’expérience, mais épuisés. Lors de leur départ, ils mentent sur l’horaire de leur sortie du port pour éviter les pirates qui attendent les navires de nuit. Ils larguent les amarres le dimanche matin aux premières lueurs, ne se rendant pas compte qu’il manque quelques objets à bord. Ils ne s’en apercevront qu’une fois au large : l’ordinateur, le porte-feuille et le carnet d’Andrès ont disparu, ainsi que le téléphone de secours de Tortuga, où Géraldine avait copié toutes nos cartes marines. Le navire était amarré dans une marina protégée, mais située malgré tout qu’à quelques mètres d’un bidonville. Une embarcation s’est glissée de nuit près du bateau, et quelqu’un est entré par la descente laissée ouverte. Il n’y a aucune chance pour que cet homme ne soit pas venu armé, certainement d’une machette comme c’est la mode ici, et nous sommes tous soulagés qu’aucun de nos compagnons ne se soit réveillé. Le voleur a pris ce qui était à portée de main, l’ordinateur posé dans le carré, le téléphone sur la table à carte, et est reparti aussi silencieusement.
Un événement peu réjouissant, mais qui aurait pu tourner en bien pire. Carthagène, entourée de murailles, est une ville intimement liée à l’histoire de la piraterie. Elle a subi tant d’assauts venus de la mer, que ce soit de navires clandestins que des flottes officielles espagnoles et françaises, que son rapport à l’océan est ancré dans un sentiment double de peur de l’étranger et d’amour de la liberté. La mer ici est toujours pleine de surprises. Parfois bonnes, et parfois mauvaises.
Sur la petite place de l’Alliance Française, sous les arbres en fleurs, Diana s’assoit à l’ombre. Sur ce banc qu’occupe Carmen, dans le livre de Gabo. Cet homme-là, elle l’a connu lorsqu’elle était petite. Elle voulait devenir écrivain et il lui faisait des dessins pour l’encourager, lorsqu’il venait diner chez ses parents. A quelques mètres, la rue de Florentino. Sa maison est d’un violet parme qui lui va bien.
Les touristes, amoureux des livres, cherchent Marquez dans les recoins. On vient ici pour flotter sur des mots et découvrir un fleuve, ce fleuve où Carmen et Florentino naviguent indéfiniment. Horizon littéraire, plus que maritime. Entre vrais marins et faux amants, surgit toujours une voile.