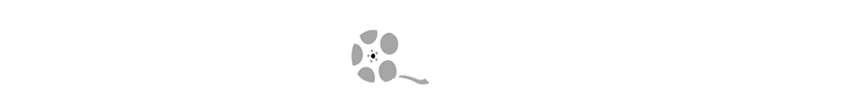À la table d’un café. Je voudrais dire, avec vue sur la mer. Ces montagnes. Découpées sur le ciel argentin, azur. Le sol gris des sentiers de pierre. Forêts, glaciers. Petits chemins entre d’anciennes frontières.
À la table d’un café, j’observe sept jeunes personnes écrire leurs mémoires. Des carnets comme des poches, bric-à-brac, tout ce qu’on peut y mettre. Le nez penché sur les pages. À retranscrire le quotidien; récits de voyage.
Je n’écris pas. Me passe la patience. Cette route qui est à tout le monde et toujours la même. Sans vue sur la mer. De montagne, en montagne.
Que dire encore? J’ai une page blanche.
Une jeune femme lève les yeux vers moi et m’offre un sourire tendre. Son carnet près d’elle. Stylo en main.
Des enfants. Inconscients, peut-être stupides, peut-être égoïstes, peut-être désespérés de trouver sur la route tout ce qu’on leur a promis. Venus par centaines dans les hauteurs, creuser la roche jusqu’à cette chaleur du monde qui leur fut vendue d’avance. Publicité commerciale d’un idéal, d’une paix. Une trêve.
Rêve du pas de côté. Je griffonne ça sur un angle. Souvenir d’une sensation désagréable.
Il n’y a pas d’aventure.
Paysages.
C’est un malheur qui me préoccupe et que je n’arrive pas à évacuer. J’y reviens sans cesse, à ce cercle, cette sensation insupportable d’être très précisément là où il fallait, où on voulait qu’on soit. Les destinations sont écrites en gras dans les terminaux de bus et nous y courons tous. Dans un laps de temps efficace et rapide. Économique. Un voyage magique, exceptionnel, sublime. Spécial. Inédit.
Je croise d’autres touristes et nous débattons des heures du prix des choses. Pas un mot sur l’amour de la route. Sûrement est-il implicite cet amour, et intime, c’est notre rêve à nous que personne ne comprend, ce désir de voguer au vent. D’être libre. On parle d’argent mais ce n’est que pour cacher aux autres la véritable essence de notre périple. Ce secret qu’on garde. Regénérescence. Épiphanie. On vantera le coût de l’hôtel le moins cher plutôt que le parfum des fleurs.
Il faut savoir lire entre les lignes. Les fibres; parcelles de l’uniformisation totale d’un rêve particulier. Celui qui veut vivre nomade, avance sur une autoroute barbelée.
Des enfants. Viennent chercher dans des cartes postales la carte au trésor d’un monde plus vif et plus vrai.
Le marché du tourisme reste pour moi le point central de tout un questionnement sur la possibilité à la fois d’un rapport à l’autre, d’une rencontre avec soi, et d’une découverte du monde.
Sa violence a le potentiel d’un triple meurtre.
*
À la table d’un café. Voilà six mois que Tortuga navigue. Six mois, ce 28 novembre 2017. Je me souviens encore de la force du soleil sur le ponton d’honneur de La Rochelle. De l’odeur des cheveux de ma mère. La dernière écluse.
Mon navire a disparu dans les lenteurs du vent. La date d’arrivée à Puerto Montt ne cesse de reculer, mon attente terrestre de s’allonger. Un mois va s’écouler depuis Punta Arenas. Un mois, au lieu de dix jours. J’attends avec impatience le récit de l’équipage. Pris au piège dans des eaux violentes, magnifiques et hostiles. Toujours entre les montagnes. De rives en rives. Les canaux.
Je prends des ferrys pour traverser les fjords de la Carretera Austral et guette du regard le petit voilier vert. Revenue au Chili, il faut m’imaginer un monde pour ne plus avoir le coeur en mer. Aujourd’hui je comprends de l’intérieur ce que voulait dire Géraldine lorsqu’elle prétendait pleurer chaque jour passé loin de l’océan. Il faut que la terre mette tout en oeuvre pour égaler le bleu vide d’une mer calme. Ce qui nous donne en miroir, infini.
Elle y arrive. S’agit de regarder de près, de louvoyer lentement sans dépasser jamais la vitesse de croisière. Cap au Nord, on vogue doucement de port en port, toujours entre les sommets, les vallées. Vue sur la mer, bien que les ferrys n’aient du bateau que le nom et le milieu. Un camtard, bruit de moteur, et pas même une vague.
Des voitures aussi. Le pouce levé, on se fait conduire par un bûcheron, un ingénieur, un chargé de maintenance de la chaussée qui s’arrête un instant dire quelques mots à ses ouvriers. Une jeune femme inspectrice de police, ongles manicurés, voix chantante, qui se réjouit de ne pas avoir trop de travail dans ce coin tranquille.
Qu’il fasse beau.
Jérémy s’assoit à l’avant et parle un espagnol brinquebalant avec les conducteurs. Je regarde le paysage défiler et partage les conversations, savoure ces instants d’intimité qui sont comme volés au temps, au planning bien planté d’une journée habituelle. Les héros sont ceux qui brisent la protection d’une capsule de ferraille pour accueillir deux inconnus. Vitres ouvertes. Tranquillement.
La Carretera Austral est un chemin d’asphalte qui serpente, grimpe, longe les lacs et l’océan. Il y a une force ici, particulière. Dans chaque ville on croise des panneaux indiquant par où courir lors des tsunamis. Où se réfugier. Le Chili, cette longue côte achevée à l’Est par les Andes, au Nord par le désert de sable, au Sud par la fin du monde. S’yrencontrent les vagues, les tremblements de terre. Est-ce qu’on peut s’y lever pareil, chaque matin, dans ce pays? Quand on se dit qu’il n’est pas si improbable que ce soit le dernier.
Et pourtant, une tranquillité paisible. Immobile, malgré tout ce qui pourrait faire trembler. Une montagne comme une campagne. Le bout du monde, comme à l’origine. Les pêcheurs aux bateaux jaunes et bleus. Les champs, les chevaux.
Des moutons.
*
À la table d’un café, j’écris une lettre. Espagnol médiocre, pour grandes phrases. Une demande. Il y a sur l’étagère quelques livres, presqu’inapercus. Je les feuilletai hier, en savourant un cappuccino après une journée de stop. Je précise, car on sous-estime le temps passé à rêver d’un bon café en voyage. Le confort d’une chaise. Le temps à lire les titres dans les librairies étrangères. On se réjouit de l’idée d’une histoire, une nouvelle parution, puis repose l’ouvrage qu’on ne comprendra pas. Ou alors on tente. Memorias de mi putas tristes de Gabriel G. Marquez. Apprentissage irrévérencieux d’une certaine langue. Mousse et supplément crème.
À la table d’un café. Ces livres sont édités dans une collection nommée Geopoeticas. Ça m’interpelle. Voilà un terme qui résume soudain tout ce qui n’est encore pour moi que tentative. Frôlement d’une certaine approche langagière du monde. Une façon de dire et de raconter le voyage, l’être à l’autre, l’être à soi. Une vie nomade qui se conte en assonances. Les lieux devraient naitre par différences d’intensité. De lumière. Comme une photographie, apparaitre blancs sur noir, par petites touches,ou diagonales.
Géopoétique, un mot comme une boulette de papier, bien serré dans la paume de la main, concentré, essentiel. Et des livres en format poche, reliés, épais. Discrets comme un murmure dans l’air du temps.
J’écris une lettre. Il y a un groupe ici qui se réclame du mouvement géopoétique fondé par Kenneth White en 1989 à Paris. Mouvement qui se définit comme une pensée transdisciplinaire qui place le rapport entre la Terre et l’homme au centre de ses réflexions, ses recherches. Le récit de voyage, et tout ce qui lie l’écriture, le nomadisme et l’appel du dehors, y ont une place particulière. L’idée phare est qu’il n’y a que la Terre, entendue comme lieu d’habitat commun de l’Homme, qui puisse nous rassembler et être le fondement de ce que White évoque comme une nouvelle culture, un progrès qui tendrait dans le bon sens.
Le monde est alors compris comme ce qui nait de ce rapport entre l’humain et son environnement, et tout ce qui nie ce rapport comme relevant de l’immonde. A la confluence, entre autres, de la géographie, de la littérature, de la philosophie et de la science, la géopoétique etablie ainsi, d’une maniere volontairement indirecte et secondaire, un constat politique qui fustige tout ce qui nous coupe de la Terre et nous éloigne d’une pensée de l’espace géographique comme univers commun, à la fois sur le plan réel et sur le plan imaginaire, culturel.
Tout cela, je le découvre à Puerto Aysen. De l’existence de l’Institut International de Géopoétique parisien à sa succursale, ici, dans le petit port du Sud de la Patagonie où nous sommes de passage. Des textes de Kenneth White à ceux, innombrales, qui le commentent et s’y réfèrent.
C’est une drôle de sensation. Il m‘apparait que rien ne touche d’aussi près une dimension complexe et ténue du Bato A Film et de mes textes. C’est une rencontre de coeur et de pensée que je continue d’explorer et sur laquelle je ne peux pas encore conclure. Car pour deux poignées de main, je fais un pas en arrière. Il y a quelque chose de profondement misanthrope et pessimiste dans l’approche de White. Sans compter que sa défiance envers la poésie lyrique, la philosophie théorique et toute référence au concept des énergies reduisent tant les approches valables de ce qui est pour lui la géopoétique que ce mouvement apparait parfois réservé aux seuls lecteurs qui suivraient l’avis du maitre. En cherchant à définir trop précisement la géopoétique, il la limite à un certain territoire, et exclue ainsi tout ce qui s’en approcherait sans lui appartenir.
Or je crois qu’il y a quelque chose de parfaitement insaisissable dans ces concepts de poésie et de Terre, de Géo pris au sens le plus large. Leur action sur le monde, et par là leur être au monde, nous échappe et nous transcende, malgré tous les mots et toutes les définitions qu’on voudrait leur appliquer.
En tout cas c’est ce que m’ont appris, à moi, le voyage et l’écriture. Qu’on ne connait pas les forces qui nous tiennent. Que c’est précisément dans cet espace de non-dit et de hasard, de fulgurance, que peut avoir lieu la rencontre et la naissance du monde.
Pourquoi vouloir restreindre les modalités de cette rencontre? Il arrive à White de citer un auteur, comme il le fait par exemple avec le philosophe Michel Serres, pour ridiculiser son lyrisme ou son emphasme et souligner à quel point celui-ci est loin de la vraie géopoétique. Comment se rallier à une telle methode?
Je reste persuadée que l’appel du dehors est bien souvent inexplicable et, plus encore, qu’il n’a pas à être justifié. Surtout si cette justification tombe obligatoirement dans un rejet et un mépris d’une fantasmagorie qu’on nommerait la vie quotidienne. J’ai vu des voyageurs plus empatés dans leurs habitudes qu’un employé de bureau. Le quotidien, et ce qu’on voudrait être sa répétition extreme, est dans le coeur de chacun. Je trouve le mien dans mes tasses de café noir et mes lectures. D’autres s’échappent en changeant simplement de rue, de quartier. Etranger sur le pas de notre porte. Le voyage est à bout de semelle. Un pas suffit.
Il me semble aussi que le sentiment comme l’effet littéraire poétiques sont impénetrables. Je les vois comme une flamme. Comme je vois la philosophie, non pas entendue comme système mais comme sentiment, comme rapport précisément poétique au concept, au terme. Une flamme, qui ne vit qu’un instant et éclaire soudain parfaitement une connaissance, une vision des choses qui était restée obscure, imprécise. Elle n’existe que dans le moment mais l’idée qu’elle fait naitre garde toute son intensité si on parvient à la revivre, à retrouver la sensation qu’elle nous a donné lorsque nous l’avons découverte. Cette sensation de symbiose entre soi et ce qui est en-dehors de soi, et qu’on regarde. Une poésie intime, et universelle.
Le vrai chaos.
*
A la table d’un café, j’écoute Cristián Arregui Berger, membre du cercle de géopoétique de Puerto Aysen. Il a bien voulu répondre à la lettre que je lui ai fait parvenir via la demoiselle qui lui sert son americano, dans ce petit établissement où j’ai croisé les livres de Geopoeticas. C’est un homme aux cheveux grisonnants, les manières simples. Il vient avec tout un tas d’ouvrages regroupant ses textes théoriques, ses poèmes, les peintures faites par un autre membre du groupe sur les pêcheurs artisanaux de la région et le pont suspendu de la ville, un des plus grands du Chili. Son désir de partager et de faire connaitre son travail est ennivrant. Curateur, éditeur et écrivain, il raconte comment il a senti germer en lui ce besoin de préserver et de mettre en valeur une facon de vivre qui lui semble encore proche de la Terre, en lien direct avec le sol et l’eau. Ici la pêche industrielle tue petit à petit les barques de bois. On sent que c’est un combat. Cristián et son équipe sont allés rencontrer des pêcheurs et des artisans qui travaillent encore à leur echelle, au jour le jour, en fonction de l’affluence du poisson et des commandes qu’on leur fait. Les charpentiers qui font et reparent les bateaux.
De ces rencontres ils tirent des interviews, mais surtout des poèmes. La croyance indéfectible de ces gens dans un Dieu qui les protège en mer, lorsqu’ils doivent longer les fjords de nuit sans radar pour espérer une bonne prise, est mise en scène, en rimes. Leurs mots sont retranscrits ou servent d’inspiration. Vit cette idée que seule une approche poétique peut vraiment frôler le coeur des choses.
Que dire? Tortuga vogue sur cette mer-la.
A la table d’un café. Je ne partage pas avec Cristián mes réserves sur Kenneth White et ses formules assassines. Il m’offre le dernier exemplaire de sa revue, éditée en collaboration avec l’université de Valparaiso sous le titre Provinciana : Mar, Campos, Cielo (Province: Mer, Champs, Ciel). C’est un ouvrage magnifique où se mêlent cartes, récits, analyses et peintures. Des paysages de toutes sortes en somme. Y sont cités plusieurs auteurs français, et je me dis que le Bato A Film aurait sûrement sa place dans un tel ensemble.
Je crois que cette idée de géopoétique répond simplement à quelque chose qui est dans l’air du temps. L’envie de dire le parfum des fleurs, stylo à la main, le nez penché sur des pages bric-a-brac ou levé au vent. De revenir à la Terre, quand la modernité et l’industrialisation nous font perdre pied.
Cristián dira que les peuples d’ici sont particulièrement sensibles à cette démarche du fait de leurs origines indigènes. La Terre-mère est peut-etre bien née dans les Andes. J’ai tout de même l’impression que cette mouvance est générale, et n’appartient ni à l’Occident ni aux Amériques indiennes. C’est la violence des médias et leur tendance à vehiculer des préjuges sur un continent qu’elle aime qui a poussé Géraldine à fonder un projet de cinéma basé sur une forme de documentaire poétique. C’est l’industrie de la pêche massive qui a suscité cette rebellion artistique chez les habitants de Puerto Aysen. Ce qui nous ramène à l’autre, au dehors – et ce qui est aussi à soi, dans le sens de ce qui nous appartient et de ce qui nous definit – est innombrable.
La couleur d’une montagne. Le calme de la mer. Le sourire tendre d’une étrangère.
Tout ce qui se fait voyage, ailleurs et chez soi.
Entre l’espace d’une porte, et celui de l’océan.
Dans l’air du temps.