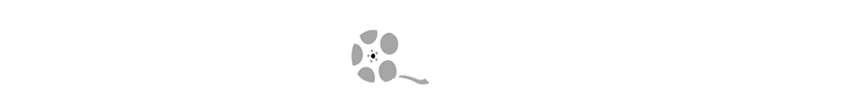Arica. Partagée entre sa rive marine et ses dunes de sable, une vraie ville du désert, ville des déserts. Y souffle une certaine joie. Peut-être est-ce le chant qui s’y tient lors de notre passage, peut-être est-ce un refrain naturel, habituel. Nous ne la connaîtrons qu’heureuse, pleine de musiques et de danses. Les parades célébrant La Fuerza del Sol durent trois jours pleins, débutant chaque après-midi pour ne prendre fin que le lendemain, bien après l’aube. Aux artistes chiliens se sont joints des groupes venus du Pérou, de la Bolivie et du Brésil, ainsi que de plusieurs communautés indigènes. Chacun ses pas, chacun ses symboles. Ce carnaval est si hétéroclyte qu’Arica a vu naître des ligues nationalistes dénonçant le manque de patriotisme de la manifestation, conçue en ribambelle de couleurs et de tons plutôt qu’en étendard. Qu’importe, la fête bat son plein. Visages venus du Nord des frontières, de l’Est des montagnes. On apprend à reconnaître les formes des robes, le rythme des danses. On s’habitue à l’omniprésence de ce qui brille, éclate, éclabousse de splendeur. Les masques d’or le jour, les costumes luminescents la nuit. Pas une heure sans lumière.
Autour des rues où se déroule le défilé, parcs et trottoirs accueillent les musiciens et les danseurs qui se préparent ou se reposent. C’est un spectacle étrange, tout ce monde tout en costume, allongés sur la pelouse ou pendus au téléphone malgré les jupes de velour trop chaudes, les nattes à pompons trop lourds, les souliers trop hauts. On ne saurait pas qu’il y a carnaval, on se croirait dans une cité fantomatique aux habitants bien coquets. Les coulisses d’un film, sur un chantier d’Hollywood, plus de figurants que de spectateurs et la sensation de faire tache en jean et t-shirt.
Pris par l’excitation, Jérémy, Julia et moi achetons des perruques et des fanfreluches pour mieux se mêler à la fête. Jérémy se coiffe d’un petit chapeau de clown, moi d’une chevelure rose. Julia choisie une perruque blanche à mèches bleues qui lui donne un air d’ange évanescent, le visage fin et les yeux sombres, profonds. Alors qu’elle passe devant la glace d’un restaurant, penchée vers son reflet comme sur une inconnue, Jérémy se détourne un instant de la scène extérieure et la photographie. Sous le charme, nous marchons près d’elle en ne remarquant pas tout de suite que nous sommes les seuls à être déguisés dans ces rues. Le carnaval sud-américain n’est pas un mardi gras et nous voilà soudain ridicules, pris dans nos clichés européens de ce que doit être une fête, alors qu’ici le costume est un art qui se fabrique d’une année pour l’autre, et ne s’improvise pas au détour d’un mauvais magasin.
On continue néanmoins d’avancer, ne choquant manifestement personne. On suit quelques temps les premiers groupes de danseurs, avant de commencer à faire des allers-retours à la capitainerie, chacun retirant tour à tour ses artefacts pour pouvoir se présenter décemment aux gardiens. Tortuga devrait arriver dans l’heure, on reste dans l’avenue en bord de mer pour guetter le passage du petit voilier entre les gros navires de pêche et ceux de l’armée. Bientôt vont émerger de cette étendue-là nos amis Olivier, Ségolène, Lorraine et Charline, menés à bon port par notre capitaine.
Alors que nous commençons à désespérer, l’heure s’étant transformer en attente indéterminée, ils apparaissent enfin. Ils ont l’air frais et ravis, malgré le décalage qu’il y a entre leur humeur marine et la folie joyeuse qui a déjà pris sur ce pan terrestre. Pas marins et lourds, incertains, sur un sol ferme qui vibre déjà de sons et de danses. La transition est dure. On essaye de ne pas les accabler de questions et d’embrassades, malgré notre plaisir de les retrouver.
Après nos premiers échanges, ils m’informent que Géraldine est déjà en train de faire les démarches administratives auprès des autorités maritimes. Je rentre dans l’institution avec ma perruque, et elle met quelques secondes à me reconnaitre. Je voudrais la prendre dans mes bras mais je me rends compte que ses yeux sont rougis, que sa voix tremble légèrement. Elle me sourit et se penche à nouveau sur le document qu’elle est en train de remplir, écrivant d’une main alors que l’autre reste posée sur la table, toute enrubannée, un pansement plaqué le long du pouce. “J’ai voulu arrêter un peu trop vite l’éolienne…”
La coupure est propre et les soins apportés par l’armée à son arrivée lui éviteront un passage par l’hôpital. Incapable de bouger les doigts pendant quelques temps, elle pourra néanmoins reprendre la mer sans avoir à se préoccuper de points de suture ni d’agrafes. La douleur et le choc de la blessure l’ont tout de même atteinte et je sais qu’elle s’en veut, une erreur aussi basique que mettre les doigts dans une hélice n’est pas digne de ma chef de bord. A la façon dont elle se tient, je la vois exprimer une certaine lassitude, une fatigue qui ne vient pas de sa dernière traversée ni de son équipage, mais de la sévérité de la mer elle-même, et l’intensité du voyage. Toujours en route, toujours en charge de nouveaux venus, artistes ou coéquipiers, accaparée par les réparations du navire et la préparation des étapes, rares sont les moments que notre capitaine passe seule avec elle-même, pour elle-même. Cette fois encore, Tortuga n’a pas pu s’amarrer à un ponton, Géraldine et son équipage se retrouvent à faire des aller-retours avec une navette, disponible seulement une fois le matin, une fois le soir. Toute une logistique à suivre, et aucun confort. Il n’y a ni douche ni salle de repos à leur disposition; on les emmène quémander l’accès aux salles de bain de notre auberge, faisant les yeux doux à la tenancière pour cinq jeunes marins qui viennent de toucher terre.
Ils sont accueillis et l’atmosphère se détend, chacun va pouvoir profiter de l’eau chaude et se reposer un moment, donner des nouvelles à leur famille, boire une bière ou un jus frais; bref, reprendre doucement pied dans ce monde qui a continué à tourner sans eux, à une autre vitesse, à une autre échelle. Comme attendu, leur traversée s’est très bien déroulée. Tous ont trouvé leur place et ont su saisir dans l’horizon ce qu’il avait à offrir. On me rapporte les débats fréquents, menés avec simplicité et respect des prises de parole de chacun, qui ont occupé les journées de ce groupe épris de grandes idées et de discussions. On me raconte aussi les fous rires, et le seul moment d’inquiétude lorsqu’un filet de pêcheur s’est retrouvé pris dans le safran du bateau alors que l’équipage se prenait en photo sur le pont. Déjà en maillot de bain, Géraldine est descendue dans l’eau froide et a libéré la tortue en tirant sur le cordage de la pointe des pieds, elle-même agrippée à la jupe du navire. Tortuga a pu reprendre sa route sous l’oeil suspicieux du pêcheur navigant un peu plus loin, et a rejoint la côte avec seulement un jour de retard malgré le peu de vent rencontré.
Assis ensemble dans cette auberge, nous faisons le point sur l’organisation de notre résidence à Arica. Le lieu est réservé, notre association étant accueillie par le centre culturel principal de la ville hybride, en bord de mer, un pied dans le désert, une salle de travail disponible et un écran pour projection. Ce qui manque, ce sont des participants locaux. Stéphane, en charge de la préparation de cette résidence, est parti voyager et n’a pas trouvé le temps ni les moyens de contacter suffisamment d’artistes pour que notre prochain film ne soit pas franco-français. Une telle perspective ne nous enthousiasme pas, mais il est trop tard maintenant pour rattraper le coup et j’en veux à cet ami de ne pas avoir su mieux déléguer ses missions pour qu’on puisse se répartir les demandes auprès des centres culturels et des écoles d’art. C’est un raté qui n’avait pas lieu d’être, mais qui tombe néanmoins à pic car l’annulation de notre résidence permettrait à Géraldine de prendre du repos et de vérifier l’état de Tortuga. Son moteur a recommencé à faire des siennes, s’arrêtant net à l’approche du port et laissant le navire à la dérive plusieurs minutes avant que Géraldine, au téléphone en urgence avec Gilou, parvienne à le remettre d’aplomb et à redémarrer.
Ainsi nous en arrivons à prendre la décision difficile d’annuler notre atelier artistique, sûrs que ça nous permettra d’être mieux préparés pour les suivants. Arica disparait de la carte de nos oeuvres filmiques. On se réconforte avec l’idée de pouvoir profiter pleinement du carnaval et, d’un pas certes déçu, mais enjoué, nous sortons fêter nos retrouvailles dans les rues illuminées de la ville-frontière.
Mes compagnons se frayent un chemin dans la foule. Ils se sont répartis en petits groupes, par affinité, par sujet de discussion. Chacun jette un coup d’oeil derrière, devant lui, voir où en sont les autres. Alors que la parade défile, cet équipage se délite, redevient un groupe d’amis en voyage, en vacances, terriens obligés de dormir encore quelques temps au bruit de la houle, en souvenir.
Je vois Julia et Jérémy qui marchent l’un derrière l’autre, les cheveux blancs ébouriffés par le vent, le chapeau de clown tenu d’une main. A quelques mètres d’eux, sur la chaussée transformée en scène, une compagnie péruvienne danse ce qu’on appelle le tinku, nom qui signifie littéralement “le lieu où toutes les différences sont une rencontre”. Les bras en arrière, le corps penché en avant, les danseurs piétinent au rythme des tambours avant de se mettre à tourner tous ensemble, dans un même mouvement, leur affrontement devenant une harmonie de gestes, de sons clamés en coeur à chaque changement de place. Une paix.
Au-dessus de leurs têtes flotte le drapeau de la nation chilienne, immense, planté sur la colline où s’est jouée la dernière bataille de la région lors de la Guerre du Pacifique, au mois de juin 1880. Le Pérou s’étendait alors jusqu’au Nord de Tocopilla, la cité de Jodorowsky étant à cette époque bolivienne, de même que la portion du désert d’Atacama situé entre cette ville et le Nord de Santiago. Le Chili beaucoup plus court. Pour la Bolivie, le désert constituait son accès à la mer. S’y trouvaient les mines de Calama, et ce qui n’était encore que le petit village de San Pedro. Ce n’est qu’après cette guerre que le territoire bolivien s’est vu confiné entre l’Amazonie et le désert de Uyuni, un bout du lac sacré Titicaca et la frontière argentino-brésilienne. Le Pérou a également vu son bras de côte se faire raccourcir jusqu’au coude, la ville de Tacna, en face d’Arica, devenant sa frontière, proche et pourtant séparée du désert d’Atacama. Le pan de terre aride, entre cette frontière nouvelle et la ville péruvienne la plus proche, ne portera plus de nom connu. Le Chili a mangé et l’argent des mines, et la réputation. Ça lui vaudra d’être attaqué en justice par la Bolivie, crevée de haine de ne plus avoir de voie vers l’océan, et d’être toujours en procès à l’heure actuelle, le tribunal international jugeant la requête de son ancien ennemi “recevable”.
Et pourtant. Les voilà qui dansent ensemble, chiliens et boliviens, péruviens et brésiliens. Dans ce lieu où toutes les différences sont une rencontre…
A les regarder faire, le visage magnifique de Julia aspiré par la musique, je me dis que malgré nos soucis il n’est pas possible de ne rien filmer ici. Une ville si visuelle, tenue en tenaille entre deux infinis alors que le carnaval explose, résonne sur l’horizon de sable, de sel. Une histoire si forte, qui réunie soudain malgré eux les trois pays frontaliers, et les nouent dans des pas de danses.
Le soir de ce premier jour de fête, je m’asseois avec Jérémy et Julia un peu à l’écart du groupe, et leur fait part de mon envie de raconter quelques minutes d’Arica. Ce qu’on peut faire, caméra à la main, en seulement trois jours. Jérémy, mieux renseigné que nous sur le passé historique de la ville, nous mentionne immédiatement l’épisode de la bataille du mois de juin 1880, et je commence à réfléchir à une narration fictive qui comprendrait à la fois ce passé guerrier et les festivités actuelles.
Mes camarades ne me suivent pas tout de suite, ils penchent plutôt pour un documentaire pur qui permettrait d’interviewer les participants au défilé et de raconter à travers eux les musiques, les volontés d’entente, ce que représente encore cette ville dans leur imaginaire. Il me semble que c’est un projet à trop grande échelle, et qui aurait du mal à s’imbriquer dans la série des contes du Bato A Film. Pour moi il s’agit avant tout de donner une place à ce lieu dans la constellation de nos films officiels et de nos étapes, en le racontant à travers la magie d’un récit qui soit en rapport avec son patrimoine, sa géographie. Qu’Arica retrouve sa place dans notre carte cinéphile.
Véridique ou non, on tisse un lien entre les souffrances de la Guerre du Pacifique et l’allégresse de ces trois jours de fête. Alors que les journaux étrangers titrent “retour douloureux de la Bolivie à Arica pour le carnaval” et que les ligues nationalistes de la ville enragent, La fuerza del Sol donne un exemple de vie et de convivialité qui rabaisse haines et rancoeurs à l’état d’ombres muettes. Le carnaval acquiert une intensité, une portée symbolique qui surpasse par la musique et la joie les inimitiés issues d’un conflit territorial datant de plus d’un siècle.
On se saisit de ces histoires, passées et présentes, et met en place un parallèle qui me donne une excuse pour filmer le regard de Julia. Notre scénario, écrit d’une traite autour d’un café, fait de notre ange la protagoniste. On la renomme BB, appuyant le côté très américain de cette beauté blanche, et l’utilise comme point d’accroche narratif, son parcours dans la géographie de la ville-déserts racontant une histoire guerrière, tout en douceur. Composé en tryptique, le court métrage montre ainsi la préparation de la guerre, le jour de la bataille et le lendemain de la victoire et de la défaite, uniquement avec des images du carnaval, utilisé comme métaphore mais surtout comme ouverture. Danses et musiques deviennent scènes de combat, l’essayage des costumes une préparation à la prise d’armes. Le passé sert à souligner le présent. Une victoire ancienne, à faire naître un lieu qui transcende les frontières. Une rencontre, pour ce qui aurait pu rester un différent.
Une des traditions principales de la manifestation est d’asperger des pieds à la tête les participants déguisés en arlequin avec de la neige artificielle. ça donne lieu à des scènes incongrues, où des enfants de dix ans se font attaquer par de plus grands, armés de bombones de mousse; où des adultes se font cernés par des gambins qui les poursuivent en hurlant. On jette Julia dans cette guerre blanche, et c’est ma caméra qui manque d’en ressortir vaincue, un des arlequins l’ayant littéralement recouverte de neige chimique alors que je filmais le combat. Un vrai carnage.
Jérémy au son et moi à l’image, on se démène pour capturer des instants du festival sans faire piquer nos micros avec les fanfares et le bruit constant du vent (presque impossible, on devra redoubler quasiment toutes les scènes), filmer sans que le point ne se perde à chaque changement de rythme, la mise au point placée au plus près des danseurs et les mains crispées sur l’objectif pour tenter de suivre le déplacement des groupes. Une vraie épreuve, qui met à mal notre côté amateur et nous demande d’être le plus prêt, le plus efficace possible. Chaque danse n’a lieu qu’une fois. La lumière change à vue d’oeil alors que le soleil passe du sable à la mer. Il faut aller vite, réussir à cadrer en quelques secondes et mettre en marche les micros en phase avec la caméra, alors que là où l’image est bonne n’est pas forcément là où la musique est la meilleure.
Un casse-tête qui nous ravit, Julia jouant pour la première fois l’actrice et apprenant par la même occasion à faire des prises de son, Jérémy dans son élément de mélomane et moi pour la première fois à l’image d’un film pensé entièrement en prises de vue réelles, sans animation. Géraldine a été claire sur ce point-là, et le reste de l’équipage aussi. La finition du court métrage de Valparaiso passe en priorité sur une oeuvre faite hors résidence, et si nous tenons à filmer quand même Arica, malgré l’absence d’artistes locaux, malgré la rapidité nécessaire de nos choix et l’aspect totalement improvisé de notre scénario et de notre tournage, il n’y aura pas d’aide de la part du reste de l’équipe, occupée à organiser la suite et à réparer le moteur de Tortuga.
Au lieu de prendre ces conditions avec malaise, notre petit trio en fait un défi supplémentaire. Ça tourne entre nous, après nos premières discussions de décapage nous nous sommes parfaitement accordés sur ce que nous voulions dire de cette ville, et comment. Julia et Jérémy m’ont laissée le rôle de réalisatrice et on parvient à s’aiguiller, chacun à notre façon, sur ce qui nous semble le plus adéquat, le plus en accord avec notre idée de départ. Je crois qu’on parvient à se sentir libre dans ce travail, et que malgré l’étrangeté d’un scénario un peu rocambolesque, nous en sommes satisfaits. Nous avons caméra et micros en main, et rien que ce plaisir vaut le temps d’un bon cadrage, une prise dix fois recommencée, un montage fait, défait et refait jusqu’à ce qu’enfin un sens émane de l’enchaînement des plans.
Pour la première fois depuis Buenos Aires, je retrouve le bonheur de filmer et de diriger une actrice selon une trame établie. Julia doit entrer dans la peau d’un personnage créé le matin même, et moi trouver la bonne composition de scène pour donner de la force à son jeu, ses expressions. Etrangement, malgré le plaisir que j’ai à la suivre et à faire naître ensemble cette histoire, je me rends compte que filmer peut aussi nous voler un lieu, nous sortir d’une ambiance. Nous étions venus ici pour fêter en musique le carnaval; nous voilà au travail, concentrés sur la signification de nos choix, la façon dont on peut ou non approcher ceux qui vont apparaitre sur nos images. Le scénario écrit, je n’arrive plus à percevoir les événements extérieurs autrement que sous l’angle que nous nous sommes nous-mêmes choisis. Le cadre du film s’impose à moi et m’empêche de profiter autrement du défilé, du temps qui nous était donné pour découvrir cette ville justement autrement que sous l’oeil de la caméra. Sacrifice étrange de la malléabilité de son propre point de vue, pour prendre celui d’un récit déjà composé.
Cependant, ce contexte de tournage nous réserve des surprises. Alors que je suis en train de faire une prise dans un parc où se changent des danseurs, l’un d’eux vient à ma rencontre et me demande de but en blanc de l’interviewer pour la télévision. J’essaye de le détromper mais il ne veut rien entendre; c’est presque s’il prend mon trépied et le cale devant lui, l’objectif de mon appareil bien en face de son sourire. Il va ensuite chercher un autre homme, également tout en costume, qu’il me présente comme le chef de sa compagnie. Debout devant ma caméra, il me regarde simplement, et attend mes questions. Coincée mais amusée par la situation, je finis par appuyer sur On et improvise un entretien avec ce grand brun à la peau mate, l’air jeune et doux malgré son costard serré et sa cravate. Il porte en guise de bas une large jupe de métal sertie de perles, et de grandes chaussures à talonnettes. Son masque, qu’il porte dans les bras, représente le visage grimaçant d’un noir qui fume la pipe. C’est une figure commune ici, qui symbolise l’esclave libéré qui profite de la vie et se rit de ses anciens oppresseurs. On la trouve en Argentine et au Brésil, où le commerce d’esclaves a longtemps fait rage.
L’homme que j’interviewe n’est pas chilien mais bolivien, il fait partie de ces groupes venus danser sur leur ancien territoire avec des camarades du Brésil et du Pérou qu’ils retrouvent de carnaval en carnaval, à travers tout le continent. Dans sa main, il tient un instrument improbable: une petite voiture à l’allure chic, taillée dans le bois, qui tourne autour d’un axe et produit un bruit sourd de criquet. Je lui demande quelle est la signification de cet objet et de son costume à cravate. Avec évidence, il me répond que c’est inspiré de l’époque de la mafia, qui est leur préférée et le thème choisi par la compagnie de danse cette année pour les représenter au festival.
Voilà qui me coupe pour ainsi dire le sifflet. J’enregistre ce témoignage imprévu et me mord les joues pour ne pas rire trop effrontément. Au moins n’aurais-je pas emporter ma caméra pour rien ce matin-là, film ou pas film, elle m’a permis une rencontre et c’est bien son premier et principal pouvoir.
Entre les interviewes imprévues et les mauvaises prises, le film s’invente. Rien d’extraordinaire, simplement une courte fable. BB qui traverse le désert, cherchant la mer un ballon à la main. Elle débouche en haut d’une colline, plein océan Pacifique, le regard en avant et le visage filmé en transparence de son ballon. Au loin apparaissent les collines ensablées d’Arica, recouvertes de maisons de pierre, de tôle. C’est tout ce qu’on voulait. Que cette ville apparaisse, et un écho de ses histoires.
Cette production devient le premier film officiel de l’association à ne pas comporter d’animation. Même notre tortue, qu’on cache toujours dans un coin d’image pour amuser le public, demandant au début de chaque projection de chercher la tortue dans chaque court métrage – même ce symbole-là, ne trouve pas sa place. On finira par choisir de ne pas le dessiner mais de l’écrire en énorme au beau milieu du générique, que le jeu continue d’une manière nouvelle.
Géraldine, qui nous a suivi le dernier jour du tournage et qui a été la première à regarder le montage final, est étrangement en accord avec cette absence de dessin. Lorsque nous nous étions retrouvés dans une situation similaire à Récife, nous avions inséré de petites animations dans les images réelles pour permettre au film de rester dans les objectifs assignés par la charte du Bato A Film. Mais ce court métrage-ci n’appelle aucun ajout, sur ce point nous sommes tous d’accord. On a beau se creuser la tête ensemble, on ne voit pas comment y placer des oeuvres graphiques. Aussi on finit par y renoncer simplement, et notre ligne éditoriale s’ouvre soudainement : les films en prises de vue réelle viennent d’entrer dans nos possibilités cinématographiques, bien que l’animation reste notre premier but et moyen de réalisation. Une force pour un projet qui se compose pas à pas, de film en film, et tire sa valeur avant tout de sa capacité à intégrer les apprentissages, les rencontres, les expériences. Je retrouve dans l’acceptation de Géraldine de cette oeuvre à laquelle elle n’a pas voulu participer, et qui n’est même pas dans les clous de son projet, la base de ce qui fait d’elle une bonne chef de bord: son sens de l’écoute, sa flexibilité et surtout son envie de partage, quoi qu’il en coûte.
Alors qu’Arica avait failli être effacée de notre horizon, la voilà qui emplit l’écran. L’échec de notre résidence a laissé place à quelque chose de nouveau, et c’est pour nous une réussite, malgré le dépit de signer une production franco-française pour la troisième fois depuis notre arrivée sur le continent. On fait ce qu’on peut avec le vent, qui tourne et qui baisse, les désistements de dernière minute et les méandres de notre propre organisation, équipe amphibienne qui est rarement sur terre, qui aurait dû partir avec tout un programme calé et se retrouve à lancer en permanence des bouteilles à la mer. Ça nage, mais ça flotte.
On se lance à plusieurs dans la préparation de l’atelier artistique de Lima, se jurant qu’il sera à la hauteur de nos attentes cette fois. Tortuga toutes voiles dehors, ça vogue, ça file. La capitale péruvienne va nous ouvrir ses portes et bientôt, il n’y aura plus qu’à écrire une nouvelle histoire, un nouveau conte du patrimoine, pour qu’un film puisse se faire. Sans inquiétude. A mains blanches, mains brunes.
On en est encore à rêver du Pérou.
Passer la frontière.
S’extraire, vent et chaleur, du Chili. On continue entre deux déserts, dans cet autre pays, nouveau rêve, nouvelle aventure.
La petite ville de Tacna, où pour moins cher vont manger les Chiliens, vont se faire soigner les dents. Puis Arequipa. On monte d’un coup, s’éloigne de la mer.
Plein Nord, plein Est. De l’autre côté d’une autre frontière.
Un autre nom, qui m’a fait hisser les voiles. Pour toucher terre, en haut des montagnes.
Le grand vert.
Saison des pluies.