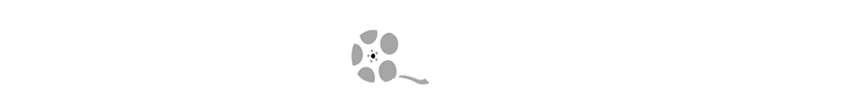D’un côté la mer, de l’autre la roche. Depuis Santiago a commencé cet autre type d’infini, chaud et sec, l’horizon sculpté de dunes et de pierres meubles. Un bus avale pour nous tout ce paysage, tout ce dédale de routes caillouteuses. L’asphalte couvert de poussière, d’embruns. Une route entre deux déserts.
Enfoncés dans nos sièges, le regard alourdi par les heures passées dans cet enclos à roulettes qui file plein Nord, Jérémy, Julia et moi admirons le Pacifique répondre à Atacama. Les méandres de sable laissent apparaître les vagues, la fraicheur. Un virage vers le solide, un autre plein liquide. On tomberait d’un côté ou de l’autre, que ce serait toujours dans le rien. Le Chili oublie la verte pampa, le mordoré de la steppe pour n’être plus que pierre et eau. Tout un tiers du pays passe sous nos roues, mais où aurions-nous pu faire escale ?
Nous avons pensé à San Pedro, la “ville blanche” d’Atacama, et y avons renoncé malgré l’envie de voir le ciel le plus limpide du monde. On se donnera quelques jours dans une vallée un peu en avant du désert, pour respirer une dernière fois le vert pétant des vignes à pisco avant de s’engager dans le sable. Vicuna est un petit paradis, pas encore blanche de touristes, plus douce, plus vraie que ce San Pedro que tout le monde va voir mais qui fait peur, n’existe pas.
J’y croise pour la première fois la culture andine. Cette lenteur qui vient des montagnes, le soleil de plein fouet et les petits fruits de cactus, adoucis au sucre. On croit aux étoiles, à la pachamama et à tous les onguents, toutes les plantes qui poussent au sol par volonté du ciel. Des OVNI, dit-on, traversent régulièrement les nuages, de nuit comme de jour, attirés par la forte proportion de minéraux dans les collines - ou par le pisco?
On passe Atacama. Une pensée pour Guzman et sa Nostalgie de la lumière. Le premier volet du Bouton de nacre fut ma toute première expérience du Chili, depuis un canapé parisien, et je ne pensais pas pouvoir traverser ce pays sans aller saluer ce souvenir. Il aurait fallu plus de temps, pour éviter San Pedro et prendre quelque chemin de traverse, moins touristique. Mais Tortuga file, côté Pacifique, et il nous faut manger le désert pour rejoindre la toute dernière ville, Arica la frontière, Arica dernier passage.
Ainsi j’aurais vu, depuis Puerto Williams, toute cette étendue de terre se dérouler sous nos pas, nos roues, nos voiles. Le Chili de bout en bout, va se finir dans la joie d’un carnaval. Février à l’approche, l’Amérique du Sud se met en liesse, les yeux tournés vers Rio de Janeiro et son défilé de maîtres. Arica offre, après la capitale brésilienne, le deuxième plus grand festival du continent, et nous avons hâte.
Mais encore quelques kilomètres. Tocopilla, éventrée par la route, s’ouvre devant nous. Nous sortons un instant de notre torpeur. Ce nom, inscrit sur les cartes comme une des principales villes du Nord malgré sa misère, malgré son visage de port industriel et laid, perdu en pleins déserts sans que personne ne désire y mettre pied, solitude des pétroliers et bateaux de pêche, solitude des maisons de terre bâties sur la roche, une femme qui passe et traverse un néant - ce nom-là, Tocopilla, nous a fait venir ici comme celui d’Atacama. Je scrute par la fenêtre alors que le bus avance et, le temps d’une seconde, aperçois le ponton où se terminent les derniers plans de La dansa de la realidad, le fils de Jodorowsky prenant le large dans une petite barque de couleur vers un nouvel avenir, loin de sa famille et de sa ville natale. Cette image nous a porté, Géraldine et moi, alors que Tortuga n’était encore qu’une coquille verte tachée de rouille. Rejoindre la ville du cinéaste, chantre de la poésie et de la vie intense, vie guerrière d’un art sans mesure ni compromis. Simplement pour voir ce ponton, qui a croisé tant de fois nos séances cinéphiles, de La dansa à Poesia sin Fin.
Je garde cette vision pour la raconter à ma capitaine, sûre qu’elle suit le dépassement de ce port depuis l’écran de bord, de son côté du monde.
En mettant derrière nous ces deux points géographiques, ces deux oeuvres de cinéma, l’infini vertical du ciel de Guzman et celui, horizontal, de la ville portuaire de Jodorowsky, c’est aussi un certain voyage qui s’achève. Ce voyage qui commence dans l’intimité de son salon ou l’espace partagé d’une salle de cinéma, lorsque l’écran donne soudai accès à un lieu, un monde, et que celui-ci apparaît là, si proche qu’il suffit de garder les yeux bien ouverts pour pouvoir y être.
Combien d’aventures sont nées au fond d’un canapé ? Les films sont moteurs d’une volonté de voir, de sentir par soi-même cet air qu’on nous montre. Ils pétrissent les rêves et l’imagination mieux que n’importe quel témoignage, parce qu’ils sont déjà récits, et que nous les vivons pleinement. On ne s’arrête pas à Tocopilla; on en connaît presque chaque rue. L’intérieur de la boutique du père de Jodorowsky, avec son comptoir de bois et ses étagères, ses deux chambres aux larges fenêtres. Combien de spectateurs connaissent et rêvent Paris mieux que ses habitants? New York? De bien des façons, le cinéma nous a donné l’Amérique Latine avant la mer. Atacama et Tocopilla étaient les capitales de ce voyage fantasmé à 24 images/seconde. Les voilà derrière nous et plus nous montons vers le Nord, plus me gagne le sentiment qu’un nouveau périple se prépare.
Car reposent enfin derrière nous nos premiers jalons, nos premiers buts. Valparaiso et le reste. Le Cap Horn. Beagle et Magellan.
En nous, à nouveau, l’inconnu peut frapper. Coeur ouvert. Yeux ouverts.
Et la proue en avant.