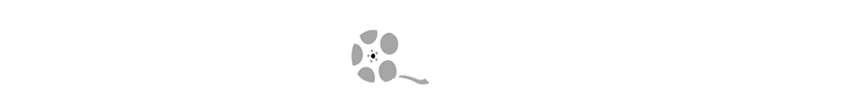Nous repoussons la terre de nos mains. Tortuga, ficelée d’un bout à l’autre de cette jetée qui nous détruit, frappe le béton à chaque vague, écrasée contre les tampons destinés aux cargos. Nous nous sommes amarrés là pour faire descendre nos amies, convoyées de Sao Vicente à Santo Antão. On pensait qu’il y aurait un ponton. C’est une route de pierre pour géants, nos douze tonnes bringuebalées comme une mouche dans la tempête. Laure, Charlotte et Clémence s’accrochent au caoutchouc fondu de ces parebattes plats et les escaladent. Trop lent. Le bois qui protège le pont du navire éclate dans un vacarme qui nous glace les entrailles. On passe les sacs à dos par-dessus bord à toute allure et, sans avoir le temps d’embrasser nos compagnes, sans tous les mots qu’on aurait voulu dire aux amies de toujours, on libère le voilier et s’écarte du danger en jouant des paumes. Un adieu franc, terrifiant.
Nos premiers instants en transatlantique.
Julie est avec nous. Nous avons voulu, Géraldine et moi, lui offrir un des plus beaux joyaux parmi nos traversées pour la remercier d’avoir suscité notre rencontre, il y a deux ans bientôt. Nous sommes là grâce à elle et nous lui rendons. C’est un cadeau que nous nous faisons également à nous-mêmes, d’emporter ce soleil, cette douceur.
Autour d’elle se crée une bulle qui nous englobe tous : Gé, moi, Gilles Masson alias Gilou, vieux loup de mer comme on fait plus, qui grimpe sur la bôme et épluche les patates douces accroupi sous la pluie. Il partage avec notre capitaine l’humour, le savoir. A trois avec Thibault, chef mécanicien embarqué depuis La Rochelle, ils mènent la barque avec assurance et rien ne nous inquiète.
Le temps s’étire en une seule et longue journée. La transatlantique sera la traversée la plus courte. Dix neuf jours, même pas vingt quatre heures. Un matin, une nuit. Une myriade de couchers de soleil. Et le scintillement de la mer.
Seuls quelques rares évènements nous font lever la tête du paysage commun. Debout sur le pont, notre capitaine observe la mer avec l’acuité dont elle est seule capable, repérant les navires aux teintes que prennent les bouts de nuit les plus lointains, les cargos au changement de vibrations du vent. La voir se tendre nous apporte un silence. Ce jour-là, elle crie baleine, et on a tout de même une seconde d’hésitation.
Une seconde, et nous sommes rivés au point qu’elle montre. Rien, et d’un coup, un petit cachalot noir qui sort à moitié de l’eau, se laisse retomber dans le sel et l’écume sans aucun bruit, parfait mirage, à peine une vision que déjà un souvenir. Disparu.
On rentre et se rassoit. Le travail reprend. Depuis que Julie et moi nous nous sommes habituées au roulis, au tangage, à la gîte, à la frappe, au près, au mauvais grand largue, au fichu travers, l’équipe en son entier a des horaires de bureau. Du réveil jusqu’au soir, se relayant pour les quarts et sortant par tranche de quinze minutes faire la veille sur le pont, ne faisant une vraie pause que pour le déjeuner sous le cagnard, le dîner dans le vent frais, nous travaillons au montage de nos films. Chacun son ordinateur, chacun sa mission de détourage, de coloriage, réajustage, montages son et image, animation.
Julie plaque son dos dans des coussins, jambes tendues, la main crispée sur la souris et l’autre prête à rattraper l’ordinateur au cas d’un mauvais coup de gîte. Je reste à côté, jambes en lotus, essayant de respirer et de me concentrer sur l’écran pour oublier le roulis. Ça ne fonctionne pas. Nous avons commencé au grand largue, paisible, et nous finirons au travers, vivable. Entre les deux, il y a plus d’une semaine de près, Tortuga le nez vers le vent, toutes voiles tendues et la cabine avant qui devient un sautoir où on se retrouve en apesanteur avant de s’écraser lamentablement sur la bannette, si ce n’est sur le copain d’à côté.
Julie et moi, on prend la fuite. On dort dans le carré. Gilou nous traitera de petites natures en allant s’y installer, puis reviendra en disant que même en marin aguerri, il a rarement été aussi secoué. Il y reste quand même, et nous permet de nous reposer au cœur du bateau, battement le plus stable, le plus maitrisé. Ça nous sauve en partie, mais le manque de sommeil et la chaleur atroce qui a envahi l’habitacle depuis que la mer est trop forte pour qu’on puisse ouvrir les hublots a raison de ma santé. Julie tient le coup, quand je commence à vomir tous les jours et à m’affaiblir. Bientôt je n’arriverai plus à manger, passant plus d’une heure à chaque repas à me débattre avec un fond de bol. Mes habits se détendent, et Géraldine commence à compter les jours jusqu’à notre arrivée.
Cette découverte intensifie encore mon dégoût de la pêche. Chaque soir au crépuscule, nous lançons sur plusieurs dizaines de mètres une ligne fine accrochée avec une pince à linge sur le pont. Si la pince se détache, c’est que quelque chose vient de tendre la ligne. En dix neuf jours de mer, nous attraperons ainsi plusieurs dorades, un thon et même un barracuda, qui nous vaudra de chanter du Claude François pendant toute une journée.
C’est le thon qui a raison de mon pragmatisme. Gilou le ramène dans le cockpit en le soulevant par le crochet qu’il a dans la gueule. Une lame au-dessus des yeux, et il s’éteint. Sa peau change de couleur. Le vert et bleu fondent en un gris pâle. Julie reste un moment assise sur le côté, immobile, avant de rentrer dans l’habitacle. Il y a du sang jusque sur les filières, projeté par les mouvements brusques de l’animal qui essaye, même la tête tranchée, de se dégager.
Ouvert en deux, la vie ne le quitte pas encore. Aidée par Gilou, je tire un filet blanc de son ventre, et sens entre mes doigts ses veines frémir, le sang frapper dans un rythme régulier et sûr la chaire qu’il n’irrigue plus. A côté de moi, Géraldine a retiré le cœur et le tient posé dans sa paume. Il bat. Rouge, minuscule. Vif. « J’ai le cœur sur le main » dit-elle peut-être en riant. La peur et la honte me font rentrer dans une lenteur bizarre. Suivant la voix de Gilou, je prends le couteau de chasse et commence à détacher la viande des arêtes, malgré les tressautements. Il faut glisser les doigts entre la chaire et la peau pour la détacher, la lame coupe trop net. Cette sensation de déshabiller un mort. De pénétrer, ongles en avant, dans une intimité profonde et sacrée. Ça me vaudra des rêves noirs, jusqu’à ce qu’on touche terre et que la pêche ne soit plus obligée.
Comme les autres, je mangerai ces animaux avec délice. La fraicheur est un luxe au milieu du désert. On cuisine leur viande matin, midi et soir. Puis on remet la ligne.
La ligne.
On sait que ça va arriver ce matin-là. Réveillés aux aurores par notre propre excitation. Plus qu’une petite heure. Géraldine et Thibault font des messes basses, Gilou, Julie et moi restons à distance pour ne rien deviner d’avance. Plus que quelques miles. On la voit se rapprocher à l’écran. Bientôt Tortuga va piquer du nez et voguer à l’envers.
On sort un seau et le plonge dans l’eau, voir si le goût change entre deux hémisphères. Elle n’existait pas, avant, cette ligne. Un nom seulement. Un caprice de géographe. Je la traçais sur mes cahiers d’écolière sans savoir à quoi elle servait. Je ne pensais pas qu’un jour je la passerai à 5 nœuds, dans les bras de ma capitaine, émue aux larmes d’une cérémonie qui se termine sur un discours et des embrassades de l’équipage.
Ça restera secret, ce qui s’est fait et dit là. Une striure sur notre bulle, qui ne l’éclate pas mais la ressert. Voilà que les jours passent. L’Equateur est notre nouveau repère, et le Brésil est tout prêt. On se met à guetter. Une lueur ou un son, une odeur. Comme les eucalyptus qui nous avaient envahis à notre approche de l’Espagne.
Une nuit enfin, on croit percevoir un feu rougeoyant au loin. Peut-être est-ce un nuage. Sur le livre de bord, à chaque changement de quart, on crie TERRE ! en papier faute de pouvoir le hurler et réveiller les autres.
Puis le matin vient.
Récife.