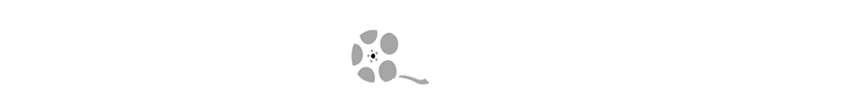Je le vois lui prendre le pied, et souffler dessus la fumée de sa pipe. Elle me dira plus tard que ça l’a aidée. A le regarder faire, dans cette pénombre brisée seulement par le rougeoiement près de sa bouche, au rythme de son souffle, j’ai envie de rire. Elle tremble encore : il répand sur ses membres les volutes du tabac naturel et chante à voix basse, avant de se remettre à vomir.
“Demande de l’aide à la plante” répète-t-il encore. Il avait pourtant assuré qu’il suffirait de l’appeler lui, si quelque chose tournait mal. Elle s’est mise à pleurer mais il reste cette fois à distance. Il mène son rituel sans changement de rythme, sans angoisse, sûr du chemin qu’il ouvre par sa voix, sa respiration.
Je la vois perdre de plus en plus contenance. Elle dit qu’elle a peur. Je m’approche d’elle et lui prend la main, l’entoure de mes épaules et embrasse son front, lui murmure à l’oreille. “Callate” (tais-toi) fuse dans l’espace noir. J’ai de plus en plus envie de rire, alors que ma colère monte.
Je garde sa main dans la mienne, et m’allonge près d’elle. En face de moi, posé sur une petite table basse, se trouve le portrait de la Vierge Marie. A chaque éclat de lumière, j’aperçois son visage qui nous observe. Il nous a fallu plus de sept heures de voyage, entre jeeps et pirogues, pour rejoindre le bout de terre où on se trouve. Et qu’est-ce qui nous attendait ? Cette auréole. Une pureté que nous connaissons très bien. Dont on se désintéresse et qui se retrouve plantée-là, pleine bravade, au coeur de la forêt amazonienne comme sur un coin de cheminée.
Jusqu’où est allé le syncrétisme? Cette image me fait mal rien qu’à la regarder. Tout ce qui a été fait, pour qu’elle puisse être affichée ici, dans le poumon du monde, la dernière vibration de ce qui était intouchable. La voilà qui prend place entre les griffes de jaguar et les poteries de terre peintes. Comment entendre ceux qui parlent encore de la forêt comme d’un être à part, pleinement vivant, plus mystérieux que la magie même ? Leurs discours sont mêlés de nos propres mots. On voudrait nous guérir des vices de l’alcool, du sexe, du Mal qui essaye encore et toujours de vaincre le Bien par des biais détournés. La purge à laquelle on s’adonne en ce moment même est pensée selon ces codes. Certains viennent ici parce qu’ils cherchent à guérir d’une vie immorale, coupable, et que dans la plante, dans cet organisme qu’on ose dire plus puissant que Dieu parce que l’illumination qu’il apporte est impartiale, se trouve des réponses. D’autres viennent pour des maladies du corps, mais tout passe toujours par l’esprit.
On dit que les conquistadores ont ramené très peu d’or, mais que ce qu’ils ont pris est incalculable. Ce qu’ils ont laissé aussi.
Elle allonge ses jambes vers l’avant, pose ses mains sur ses genoux et commence à se balancer doucement d’avant en arrière. Elle ne parle plus, mais je sais que tout un monde prend place en elle. Je laisse ma main à ses côtés, lui serre les doigts quand elle me les donne. Complètement extérieure à son voyage, je sens pourtant ce qu’elle vit et quel est mon rôle dans son lâcher prise. Je sers de point d’ancrage, je joue cet être à qui elle demande de l’aide et malgré tout le détachement, toute l’incompréhension que je ressens cette nuit-là face au spectacle qui m’entoure, je ne peux pas nier que je savais, sur le moment et avant même de venir, que cette place-là serait la mienne.
Les autres se convulsent, vomissent, murmurent parfois des choses inintelligibles. J’aimerais dire que je ressens de la compassion pour ce qu’ils traversent, mais ce qui me tient à cet instant-là est plus proche d’une sorte de rage. Pourquoi suis-je venue ici? Quelle est ce mensonge, cette farce, que nous avons choisi de vivre? La violence que je ressens me rend extraordinairement calme.
Seul le fou rire est difficile à contrôler.
Nous avons emprunté une route surnommée la Transocéanique parce qu’elle relie l’océan Pacifique et l’océan Atlantique en traversant de bout en bout le Pérou, le Brésil, et ce pays à part qu’est l’Amazonie. Une forêt aussi grande que l’Australie, qui a donné plus de fils à retordre aux explorateurs que toutes les mers, tous les déserts du monde. Aujourd’hui encore, il y a des plantes et des animaux que nous n’avons pas découvert sur ce territoire. Des organismes vivants dont nous ne soupçonnons ni l’existence ni les propriétés. Voilà qui fait concurrence avec Mars, ou les abysses.
J’étais déjà fascinée par ce territoire sacré entre tous avant de mettre les voiles, mais l’expérience de la mer a changé irrémédiablement mes sensations de la terre et de ce qui y vit. J’aimais les forêts. Aujourd’hui je les respecte plus encore. L’océan m’a permis de regarder la jungle avec des yeux neufs et je ressens plus profondément ses changements de sons, l’ampleur de son espace, la hauteur de ses arbres qui vous font lever le nez et vous obligent à un horizon vertical. Regards vers le ciel. Le sentiment d’être membre de plus grand que soi, ici, est permanent. Il y a une unité dans cette différence, du sable à la terre, de l’eau aux nuages, qui nous dépasse. On se le rappelle à chaque fois qu’une racine craque. Une racine, comme une vague. Un bruit comme un tonnerre, qui s’entend à peine et pourtant résonne, résonne…
A ma gauche se tient un homme, un Péruvien, venu comme nous pour la première fois dans une communauté indigène pour soigner un mal particulier, une malédiction qu’on lui a lancé il y a des années et qu’il ne parvient pas à fuir. C’est une chose qui se pratique ici, quand quelqu’un vous déplaît vous lui lancer la poisse, quand il vous ravit, vous le bénissez de chance. Il n’y a pas besoin de trop en faire pour qu’un sort vous suive : votre voisin peut faire appel à un sorcier et régler le problème.
L’odeur de sa pipe accrochée au corps, il lui dira qu’il l’a vue, celle qui l’a aidée la première à conjurer le sort, alors que lui vomissait ce qu’il avait encore à perdre, recroquevillé sur le sol. Elle lui a confié qu’il y était presque, qu’il ne lui manquait que ça, ces “10%” qu’il symbolise avec son pouce et son index côte à côte, presque collés.
Une cérémonie encore, et la jauge repart à zéro.
Des singes sautent sur le toit et rendent les chiens fous. Je m’inquiète que leurs hurlements achèvent de plonger ma camarade dans un délire sombre, mais elle ne semble pas les entendre. Impossible de dire combien d’heures s’écoulent comme ça, elle assise, moi allongée, les autres installés comme nous sur des matelas élimés posés à même le sol.
Elle se couche à son tour, blottie contre moi, ses cheveux contre mes joues. Je sens, emmêlées dans ses mèches, les feuilles humides dont nous nous sommes recouverts le corps avant de commencer. On nous a donné un bac d’eau à partager, où flottaient des petits bouts de feuilles déchirées à la main. Nous avons pris des gobelets et nous nous sommes aspergées la tête, les bras, les jambes, la poitrine. Il a fallu se rhabiller comme ça, sans rien essuyer, trempés et couverts de verdure, et j’ai commencé à sourire.
“Si la plante te choisit, tu sécheras très vite”. J’aurai froid toute la nuit.
Sur le chemin vers la région amazonienne Madre de Dios, le Péruvien a posé beaucoup de questions à la demoiselle apprentie sur la zone que nous traversons. Ça m’a surprise. On parle toujours du tourisme étranger, en oubliant celui des habitants du pays. Nous sommes les seules “gringas” de notre petit groupe de cinq, les deux autres viennent de la côte et la jeune femme qui nous guide est indigène, comme celui qui nous attend. Il est difficile de savoir si elle vient comme une aide pour lui, ou comme une patiente. Elle dit avoir eu tout un temps de débauches, dont se débarrasser.
A expier?
Aux questions qu’il pose, elle répond que les communautés de Madre de Dios luttent contre la détérioration des patrimoines indigènes et l’exploitation minière. Elle dit que les peuples qui vivent dans la forêt ne peuvent gagner de l’argent sans quitter leur habitat qu’en travaillant dans les mines. Sinon, il faut aller à la ville, et perdre la forêt. Mais les mines sont le cancer de la jungle, avec le caoutchouc, l’or et le commerce du bois. Alors c’est un cercle, dont on ne se remet pas.
Son souffle est devenu plus lent. Elle me dit qu’elle se sent bien. Je voudrais lui parler mais je comprends qu’elle n’est pas encore revenue. Juste passée d’un meilleur côté, où j’espère que rien ne viendra la chercher pour faire demi-tour.
L’odeur de l’herbe empli l’air. Ils sont deux à fumer, lui la pipe, elle une cigarette blanche, presque phosphorescente. Tout du naturel, disent-ils, mais ils crachent tous les deux leurs poumons et font sur le sol de petites mares de salives où j’aurais l’horreur de mettre les pieds en voulant sortir à tâtons, un peu plus tard.
Des bassines de plastique ont été disposées devant chacun d’entre nous, pour qu’on puisse vomir notre égo, notre passé, nos erreurs. Alors que tout le monde vide ses tripes, mon amie reste impassible, et j’en ressens une fierté incompréhensible.
Il dira, lui, qu’il a vomi surtout pour elle, et que ça lui a fait mal. Ça je veux bien le croire, qu’il ait eu mal. On ne peut pas passer une nuit entière à vomir autant sans souffrir, c’est le marin qui le dit. Mon idée du bon sens me fait penser qu’il y a quelque chose de fondamentalement faux dans cette démarche de purge totale, qui est censé blesser le corps pour guérir l’esprit. Qui peut vouloir un tel traitement, et croire en son résultat?
Après s’être engagée sur le fleuve, notre embarcation a suivi le bras central avant de bifurquer sur un cour d’eau étroit, pris entre les plages de sable brun et les hautes herbes. On vogue là quelques temps, puis s’arrête sur une des rives. Il nous faut encore monter une pente ardue et enfin, nous arrivons dans un village de seulement trois maisonnées où il nous attend avec sa famille. Une petite fille joueuse me donnera un fruit dur et suave, le regard déjà plein de charisme et de courage.
Il s’est assis dans le cercle, près de la petite table basse, et a sorti une bouteille de Coca-cola en plastique. Dedans se trouvait le breuvage, et cette fois je n’ai pas ri. Peut-être ne faut-il pas donner d’importance aux contours; peut-être tout est-il déjà perdu. Autour de son cou, une longue griffe.
Il a servi le liquide vert noir dans une tasse de terre décorée, et l’un après l’autre, nous avons bu, un genou à terre devant lui, la tête en arrière. J’ai été étonnée par ce goût, beaucoup plus supportable que ce que j’aurais cru, presque bon. Un mélange d’amers, très acide.
Alors que ma compagne s’apprête à être submergée par cette rencontre, je reste sur le rivage. Immédiatement, mon corps rejette cette substance. Je vomis l’intégralité de la boisson avant même que tous les présents aient pu y goûter.
Je vis cette réaction comme une victoire, qui m’emplit de joie. Quelques minutes avant que la bougie ne fonde et que ça ne commence, plongé dans le noir, mon amie m’a dit en plaisantant qu’il y aurait un avant et un après cette expérience. Cela a formé en moi, au niveau du ventre, une boule plus ferme et plus solide qu’un bouclier. Mon rejet, physique et mental, devient total. Que ferai-je d’un après, moi qui ai eu tellement de mal à construire ce maintenant que j’aime? Je suis ici à cause de films, à cause de livres, à cause de ma croyance qu’il y a dans l’esprit humain des portes de conscience inaccessibles à l’état d’éveil et que j’ai la curiosité de me demander ce que cachent les miennes. Mais ma vie actuelle me convient; plus, elle me ravit. Que ferai-je d’une vie nouvelle ? Que je n’aurais pas choisi, qui me serait venue là, en une nuit, avec une bouteille de Coca et sous le regard apitoyé de la Sainte Vierge.
Je ferme les yeux et demande à mon corps de toutes mes forces de faire barrière. Je bois quand même, et la réaction physique qui ne tarde pas à suivre me plante définitivement bien dans mes baskets. Hauts les coeurs, on verra plus tard pour les illuminations et les enseignements magico-sylvestres: on a une barque à mener et ce n’est déjà pas une mince affaire.
Il y a un temps pour tout.
Il y a des arbres dans cette région qui cherchent le soleil en se créant des pattes. Ils ont un tronc, et sur le côté de ce tronc ils font pousser des racines épaisses comme le début de petits arbres, et quand celles-ci touchent terre alors ils basculent tout leur poids, leur tronc principal et leur feuillage, sur ces nouvelles jambes. Que le soleil n’apparaisse plus que de l’autre versant, caché maintenant par la coupole d’un arbre devenu trop grand, et ils referont l’opération de bout en bout pour retrouver la chaleur le plus rapidement possible. On les appelle les arbres impatients.
Mais je n’en vois pas sur ce bout de terre.
Pas sur ce bout de terre.
Elle dit que j’ai tord. Qu’elle l’a senti vomir pour elle et que ça l’a soulagée. Elle n’a pas guéri parce qu’elle n’avait rien à soigner, mais un enseignement lui a été transmis à travers le dialogue qu’elle a tenu avec la plante. Ce qu’elle a compris ou découvert, sur elle et sur le monde, je n’en saurai rien. Ça ne regarde qu’elle. Ça ne se regarde, en fait, qu’à travers soi.
Je parle pour ce “peuple” fantasmé des Européens, à cause de cette Vierge qui vient directement des racines de ma société, et de ce “gringa”. Ça ne les choque pas, d’avoir un mot pour désigner un autre type, l’Etranger blanc, d’où qu’il vienne. Ils me disent de ne pas m’en vexer; je ne sais pas quoi répondre.
Je ne dis rien - c’est ce peuple fantasmé des “Européens” qui parle en moi. Je m’étais nourrie avant de venir de textes et d’images, et j’étais sûre d’être prête à vivre ce qui allait peut-être s’offrir à moi dans cette contrée. Je désirais cette rencontre, mais elle m’échappe, me vole mon sérieux.
Je suis en désaccord, sans pouvoir mettre le doigt précisément sur ce qui provoque mon malaise. Je découvre en moi une part de culture, ancrée au tréfonds, et pourtant qui me semble aussi inconnue que celle à laquelle elle se confronte soudain. C’est ce face-à-face qui la fait naître. Mon voyage se passe sans expédient mais il m’emmène loin. On dit qu’on n’est pas le maître chez soi; me voilà en présence d’un occupant orgueilleux, cartésien et pris de fou rire.
Il va falloir apprendre à se connaître. Que la cohabitation ouvre plus grandes ses portes, laisse venir ceux qui sont de passage, ceux qu’on croise sans le vouloir et ceux qui restent.
Est-ce que c’est le manque de sécurité qui me fait devenir épines ? Le manque de repères, peut-être. La peur.
Le désert s’arrête là où commencent les arbres. Le rien et le silence n’ont pas leur place dans cette vie foisonnante, tonitruante, qui vous emplit les oreilles plus fort qu’une ville, qu’un orage. Yeux fermés ou ouverts, fermés plus qu’ouverts, on sent chaque centimètre de cet espace habité. Peut-être le silence n’est-il en fait qu’humain. Quels sont ces espaces silencieux dont nous parle Pascal ? Ni la mer, ni le désert, ni la forêt. Le vent est toujours présent. Peut-être cette idée n’existe-t-elle qu’entre des murs ? Ou sur une bande sonore, passée à vide.
Au cinéma.
Qu’est-ce que l’exotisme ?
Ce décalage avec soi-même que nous offre la confrontation à l’inhabituel, “l’inhabitude” : est-ce le seul espoir de la pensée de se voir, et de se construire ?
Ce n’est pas seulement la peur. C’est quelque chose de plus profond et de moins superficiel. Qui agit normalement dans les tréfonds, par en-dessous, et qui se retrouve soudain jeté en avant, sur scène. Quelque chose qui nous fait agir d’habitude sans qu’on ait besoin de le dire. Notre coutume d’être.
Je reste allongée sous les étoiles. Je ne les vois pas à travers le toit de paille, mais je les imagine comme si j’étais à bord de Tortuga. Elles doivent être magnifiques, du coeur de la jungle. Je sortirai s’il n’y avait pas les singes, les chiens et les molards.
J’ignore où est le navire à présent. Nous avons quitté Arica avant que Géraldine ne largue les amarres et je n’ai même pas eu le temps de saluer son équipage. Stéphane est revenu de voyage pour effectuer cette dernière navigation avant de prendre un vol pour Paris et de quitter notre aventure jusqu’aux retrouvailles de La Rochelle. Nico, un ami d’Alejandro, a traversé en avion la distance qui sépare sa ville portuaire de la ville du désert pour entrer au Pérou avec notre Tortue. C’est un type aux manières déconcertantes, toujours à la lisière de la provocation, mais au coeur tendre. Un déjeuner avec lui suffira à me le faire sentir.
Avec eux se trouve un homme dont le nom remarquable, Édouard Renard, me le rend d’avance sympathique. C’est le cousin de notre capitaine, et un autre bon navigateur dans la famille Marin. Il est venu exprès pour la traversée, sans vraiment se soucier des résidences, alléguant qu’il n’a pas la fibre artistique. Il nous sauve la mise, car nous avons encore eu des désistements de dernière minute, et le navire a failli partir avec seulement trois membres d’équipage. Je pars avant qu’il n’atterisse au Chili, mais je sais que notre capitaine est maintenant entourée de bons matelots. Peut-être aura-t-elle le temps de se reposer enfin en mer, et de perfectionner le montage du film de Valparaiso puisqu’il n’y a pas eu de projection où le dévoiler à Arica.
Elle me dit qu’il n’y a pas eu ce saut, avant après, seulement un apport, une nouvelle marche qui prend bien la place d’un escalier tant elle est grande. Elle reste pensive. Commencera à écrire.
Ce n’est pas seulement la peur. C’est quelque chose de plus profond et de moins superficiel. Qui agit normalement dans les tréfonds, par en-dessous, et qui se retrouve soudain jeté en avant, sur scène. Quelque chose qui nous fait agir d’habitude sans qu’on ait besoin de le dire. Notre coutume d’être.
Il s’est mis à chanter lentement pour nous. Un à un, il nous libère de l’emprise de cette plante divine qui libère du passé, des malédictions, des maladies, de soi-même. Il chante pour elle et elle s’endort enfin. Je l’entends vomir une fois de plus et me demande si les maux transpercent les rêves, et s’il combat encore.
Il chante pour moi aussi. Je regarde la bassine en plastique devant moi. Elle me dira que c’est la plante qui a choisi, qui m’a gardé éveillée pour que je l’accompagne dans son voyage. Je ne peux pas la contredire.
Mais je me sens libre.
Tortuga est au large. Stéphane travaille au montage assis de guingois sur le petit siège dur de la table à carte. Il fait chaud maintenant, et peut-être ne porte-t-il qu’un maillot de bain et une paire de tongs.
Nico est sur le pont, il plonge le seau dans la mer et se douche ainsi complètement nu, près à se laisser sécher tranquillement au soleil.
Dans le cockpit, Édouard s’est assis sur le banc de bois après avoir rangé les écoutes autour des winchs. Il tient sur ses genoux un petit carnet de feuilles à carreaux, sur lequel il a déjà écrit son titre. C’est un marin qui découvre le temps passé au large. S’étire. S’écoule, indifférent, différemment. Il note ses sensations, regarde la mer et ce nouveau visage.
Qui de nous est le plus libre, le plus perdu ? On nous laisserait ici au petit matin qu’il n’y aurait rien à faire pour retrouver le chemin du retour. Au grand large des arbres. Dans un plein, qui ressemblerait à du vide.
Une période, nos voyages divergent, elle, eux et moi. On se retrouvera d’autant mieux.
Je vois ma capitaine endormie. Au fond de l’antre de sa cabine, elle se laisse bercer par les vagues.
Le bruit des singes.
De la pluie qui commence.