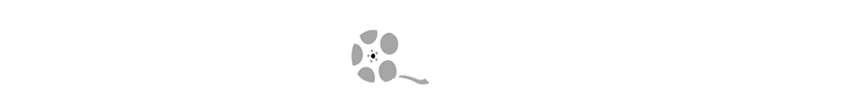Il a une couverture de cuir noir, épaisse et lisse, qui lui fait transpirer les mains et laisse sur le livre des traces de doigts, d’empreintes. Il le tient à bout de bras; elle a les coudes repliées et on sent qu’il lui pèse, lui impose son poids malgré ce protège-livre de plastique fin, bleu ciel, fleurs blanches. Les mots enrobés d’un papier-peint de maisonnée. Pavillon de feuilles, plus lourde qu’une brique, passe de main en main et raconte une vieille histoire, notre histoire, ce conte qui aime autant que nous les images, les effigies. Le Christ traverse le fleuve depuis des décennies. Son récit prend racine entre les arbres.
Est-ce qu’on les coupe, ces arbres, pour imprimer la Bible ? Une brique à l’odeur sauvage. J’aimerai la sentir, ils sont à peine trop loin. Son hamac frôle le mien dans ce mouvement de balancier que le moteur impose à la centaine de lits de tissus, suspendus comme autant d’arc-en-ciels au plafond des étages. Un navire-dortoir, qui avance au rythme lent d’une forêt qui défile. J’ai la sensation étrange d’être au coeur tremblant du monde : immobile. C’est le paysage qui vient à nous. Allongés dans nos couleurs, un pied en dehors, le bras nonchalament sous la nuque. Il suffit de voir. Rester éveillé est le plus difficile. Parquée sur les berges, la jungle nous submerge par sa chaleur, son humidité épaisse. Plus présente les yeux fermés, mais on voudrait continuer à sentir de tous les sens : contempler du toucher la douceur des nénuphares, goûter le son des oiseaux qui s’envolent à notre passage. Respirer le souffre des explosions de coucher de soleil. Ces dauphins gris pâle.
Ils sont trois à lire, eux deux et leur voisine. Chacun plongé dans un verset, un sermon d’apôtre. Je penserai que c’est une exception, mais bientôt viendra le dimanche matin et son prêche au mégaphone. Debout entre les arc-en-ciels, un homme tient la machine en porte-voix et invective – qui ça ? – le péché des hommes en rappelant les souffrances du Christ.
Sans se lever, toujours allongés dans les lits de tissus, comme si nous étions nés là, on écoute cette voix qui se mêle au son des oiseaux, à la musique de la radio des jeunes du dernier étage. Assis sur le toit, ils observent le timonier bouger lentement la roue qui dirige cette grande carcasse de fer rouillé. De là-haut on peut voir le fleuve, la jungle, de tous côtés. Un toit-dortoir, qui sert de mirador. Petits bancs de bois posés près de la cabine du capitaine. On regarde la forêt passer, et les usines. Le nettoyage du pétrole est au bord des rives. Le prêche flotte au-dessus des citernes, entrecoupé d’applaudissements qui font fuir les oiseaux, de voix qui approuvent, sortent de la radio. Jésus et l’or noir, d’un bord à l’autre, entre cet oscillement du sommeil suspendu. Mon hamac est un vaisseau autonome. Il faut s’en extraire pour prendre à nouveau part au reste. Quand il serait facile de vivre endormie au long cours, sans conséquence. Entre deux noeuds de corde. Spectateur en apesanteur, un toit de fer pour mieux voir les arbres. En haut d’une vague.
Chaque jour, à heure fixe, un homme passe dans les rangs et il faut pourtant descendre. Nous faisons la file indienne jusqu’à la salle des machines. Dans le tonnerre des moteurs, on nous sert de petites gamelles de soupe, du café au lait. Couleur eau. Parquées contre un angle, des poules picorent la coque. Je les compte à chaque fois, de moins en moins, et on finit par manger du riz, des carottes. Les fruits de goyave. La tige dure s’ouvre sous l’ongle et laisse naître une rangée de petits noyaux emmaillotés de chaire blanche. On les suce comme des bonbons, les crache par-dessus bord. Avec eux passent boites de polyester, sacs en plastique, fourchettes, serviettes. Les gens du fleuve ne s’inquiètent pas du fleuve. Ne voient pas le fleuve, de cette façon-là. Une pluie sale tombe presque en permanence des étages. Solide. On ne peut se pencher que depuis le toit-mirador, au risque de recevoir les restes d’un déjeuner, le fond d’une bouteille.
Au-dessus des moteurs, une plateforme où s’entasse le chargement du navire. Frigos, voitures, canapés, bananes, mangues. Le poissonneur de billet endormi dans la cahute d’un mototaxi, parfum de lila. Le véhiculetient au bout de la langue, plate et large, de ce vieux bazar flottant. On aperçoit deux chaussures dépasser du rebord de fenêtre de cette calèche moderne, un regard assoupi posé sur l’extérieur. Perdu en grande forêt, comme nous tous. Ici on ne connait pas d’habitude. Dans l’autre monde, nous sommes tous étrangers, tous invités. Respect et fascination sont une mouvance générale. Si quelqu’un sait, il fait semblant de découvrir. Parce qu’il découvrira, forcément, encore un jour.
Tout autour, l’industrie du pétrole souille l’air, blesse la terre, assainie les villages. Deux directeurs français, dit-on, ont imposé le ramassage des ordures. Imagine-t-on un centre de recyclage parmi les fougères ? Une philosophie. Près des rives, on ramasse les poubelles et les charge à bord. Aux escales se déversent petit à petit nos marchandises sur les places de patelins, le long des terrains de foot volés à une nature moins joueuse. En échange, la langue se remplit de détritus. On transporte des monticules, sous plastique, sans odeur. Alors que les boites en polyester pleuvent des étages, la plateforme est un parterre de sacs fermés en noeuds papillons. Habits d’une bonne conscience encore anachronique. Peut-être y-a-t-il un centre de recyclage, parmi les fougères. Entre les autres usines.
Une nuit passe.
Dans les ténèbres, des ténèbres plus sombres encore. Les ombres formidables. Du fond du hamac, dans la torpeur, se vit toute l’ampleur d’un être qui ne s’éteint jamais. Qui vibre de tous ses membres, toujours, imperceptiblement. La distance s’abolie alors, dans ce noir du total, où tout devient présent et absolu. La chaleur, l’humidité : une vague d’odeurs chaudes imprègne les fibres des tissus, des corps, et il n’y a plus qu’une mélodie. En mer comme en jungle, la nuit est l’instant de la rencontre. Déshabillées par la fin du jour, nous voilà à nue. Il n’y a plus même à tendre la main. L’ouvrir seulement.
Je regarde les étoiles. Debout devant ces fenêtres taillées à même le métal, grandes ouvertures d’air, j’aspire les bruits suaves qui s’élèvent de cet étrange univers que nous formons ensemble. Dehors la forêt; ici à peine plus que les ronflements de ceux qui sont devenus mes camarades. On se fait la conversation lorsque le jour s’allonge, en suçant des fruits de goyave. J’en ai encore un dans la bouche. Sous mes pieds le métal froid vibre également au ronflement du bateau; le sommeil communique. A nouveau je vis l’absence de silence. Je pense au cinéma, et à tous les discours qu’il a pu tenir sur cette jungle que je suis venue voir. Malgré la distance, géographique et technique, cet art y a mis pied et y a tracé son chemin. La première projection a lieu sur les murs de fer de la maison Eiffel, dessinée en France par l’architecte et acheminée morceau par morceau jusqu’au coeur de la ville d’Iquitos, accessible uniquement par le fleuve. C’est un cinématographe signé Edison qui tourne, en cette toute première année du XXème siècle. Le cinéma dit amazonien commence à naître et la soeur brésilienne d’Iquitos, Manaus, n’a qu’à bien se tenir avec son opéra. La forêt devient lyrique. Les yeux de ceux qui rêvent déjà en image se posent sur ce nouveau continent cinématographique et cinéphile. Georges Méliès envoie à sa capitale les pellicules de ses films, qu’on imagine projetées parfois à même les arbres. Il y a une photo, que je ne retrouve pas, où on voit les spectateurs assis dans des canots amarrés aux berges, le visage tourné vers une toile tendue à terre. Du fond de Tortuga, c’est une métaphore qui nous parle. Qui va dans le bon sens.
On se met à filmer. Dans la forêt il n’y a pas d’étoiles, titre Armando Godoy, cinéaste péruvien, en 1966. Peut-être est-ce vrai de sous les arbres. Avant lui, en 1936, Sous le soleil de Loreto d’Antonio Wong Rengifo, pionnier du cinéma en Amazonie. Ensuite, en 72, Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog. Une nouvelle décennie et Fitzcarraldo, qui m’amène ici parce que c’est dans cette région, la région d’Iquitos, que le réalisateur allemand a fait porter un navire de bois d’un bras à l’autre du fleuve, traversant la terre pour un fantasme qui transperce, annihile le réel. Il y en a eu d’autres, qui ont montré une forêt salvatrice, une forêt indomptable. Une forêt en noir et blanc qui se dessine en teintes et en courbes dans l’imaginaire du monde. Les représentations de l’Amazonie ont paré ce lieu de tant de décors.
On filme tant que quelques années plus tard, en 1992, Iquitos fonde une Bibliothèque Amazonienne qui collecte toutes les oeuvres, écrites, photographiques et filmiques qui concernent le pays de “Selvak”, tel que l’a renommé Godoy. Manaus est à nouveau concurrencée. Les villes jumelles irradient leur territoire commun d’un désir d’art et de souvenir. Elles protègent une mémoire qui les dépassera toujours. Eternels spectateurs de cet écran végétal, cette muraille verte comme l’appelle encore Godoy, que nous ne pénétrerons jamais. Aussi impossible que de passer de l’autre côté d’une toile.
Jusqu’à ce qu’en 2015, une coproduction colombienne, argentine et vénézuélienne orchestrée par Ciro Guerra offre un point d’entrée, d’un autre genre. L’étreinte du serpent ouvre une brèche : du noir et blanc à la couleur, du Christ à la mystique de la terre, entre ce qui se nourrit de violence à ce qui transcende l’absolue innocence du monde, qui, déjà, a vraiment navigué sur le fleuve ? Il n’y a jamais de regard qui ne puisse être recommencé. Ce monde est à découvrir, à dire.
La forêt est vierge.