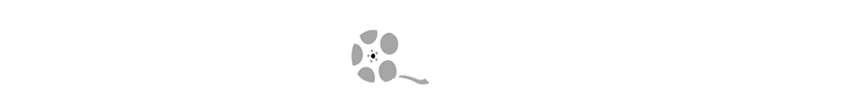On part de nuit. Le pont des Amériques sous une lune blanche, les grues illuminées de haut en bas. Les feux des navires. Le soleil se lève doucement et avec lui, la chaleur. J’ai le temps de filmer un équipage d’ombres. Géraldine m’a donné le droit d’être hors quart le temps de cette navigation : caméra en main, mon poste est de prendre des images, ainsi que quelques sons au Tascam. Ceux-ci sont extraordinaires, presque plus étranges et fantômatiques que les visions qu’ils habillent : bruits de câble qui sonnent comme des clochettes, la ferraille qui grince, les moteurs en tout sens, symphonie de machines lourdes ou subtiles, l’eau qui s’écoule, qui gicle, s’évapore sous des poids hors norme. Un pilote est monté à bord de Tortuga pour la guider dans cette traversée ; des voix ne cessent de surgir de sa radio, grésillement mécanique de phrases incomprises. Le temps d’une petite heure, nous voguons en vaisseau de l’espace, cernés de navettes, entre les plateformes. L’atterrissage vient avec l’apparition du soleil. On redescend, poussés par la lumière crue d’un nouveau jour. Autour de nous, quatre tankers déposent à terre leurs cargaisons, rechargent leurs cuves de pétrole, attendent. Encore quelques mètres et nous y sommes : le pont et la marina disparaissent. On entre dans le Canal. Nouvelle géographie.
Le pilote qui nous assiste, M. Edwin Davidson, est un homme enjoué et sympathique. Nous avions peur de tomber sur quelqu’un de désagréable et de pénible. Les pilotes sont ceux qui estiment la fiabilité du bateau, s’ils trouvent qu’on ne respecte pas les règles de sécurité ou que l’accueil de l’équipage n’est pas à la hauteur, il peut garder la caution de neuf cents dollars que nous avons donnée au Canal et décider de débarquer, ce qui stopperait net notre traversée et nous demanderait de repayer le tout. Aussi sommes-nous aux petits soins. À peine levée, Géraldine se met à préparer un gâteau au chocolat; je me réveille avec le bruit du fouet dans le saladier. On met du Coca au frais, on inscrit son nom sur une bouteille d’eau, prépare le taud pour protéger le cockpit du soleil. Il arrive à l’heure, homme grand et mince bien tenu dans une chemise à carreaux, un jean et des baskets. On commence les manoeuvres. Il dit à Géraldine de ralentir le moteur – “despacito”. Ils se regardent, sourient et, avec un mouvement de hanche, chantent ensemble le refrain du hit du moment “despacito” devant les visages médusés du reste de l’équipage. Eclat de rire général. Ça promet d’être un bonne journée.
On continue d’avancer dans le Canal, Géraldine à la barre, Jérémy et Polo aux amarres arrière, Edgar et Paul à celles de l’avant. Tout le monde reste à son poste jusqu’à ce que la première écluse apparaisse devant nous. Les docks laissent place petit à petit à des berges où respire une végétation qui rappelle la forêt : grandes herbes, fougères, des arbres épais et immenses clairsemés au bord de l’eau ou regroupés en grappes. Un crocodile nage à fleur d’eau, ses narines et ses yeux visibles, le bout de sa queue ondulant à la surface. L’eau brune rappelle celle du fleuve. Elle vient du lac Gatùn, situé entre les trois premières et les trois dernières écluses, qui a permis de relier chacun des tirets du Canal par cette ligne liquide d’eau douce. Six mois après la fin de sa construction, il ne pleuvait toujours pas et les ouvriers, ceux vivants et ceux, les 25 000, morts pour le faire exister, attendaient impatiemment de savoir si leur temps de souffrances n’avait servi qu’à creuser une tranchée de terre sèche. Puis la pluie est venue, le lac a coulé et les Amériques, au bruit d’une vague, se sont séparées.
Commencent les pointillés qui vont nous mener au prochain chapitre. On passe les portes à la suite d’un “panamax”, Tortuga terrifiée de s’approcher si près d’un énorme. On l’amarre à un remorqueur, un bateau à la coque molletonnée comme un pneu qui sert soit à ravitailler les gros, soit à les retenir avec des câbles si leurs moteurs lâchent. Edwin nous raconte que les ferrys de croisière les ont en horreur parce que leurs bourrelets laissent des traces noires sur leur coque impeccable. Nous nous collons à lui, boudin contre carapace. Edgar tient parfaitement son poste de Second et, entre ses mains, celles du pilote et celles de notre capitaine, la Tortue se tient tranquille. Polo, Jérémy et Paul suivent les ordres tout en essayant de ne rien perdre de la beauté du Canal. De chaque côté de nous, un paysage incongru de gare de train. De courts wagons métalliques suivent les cargos en avançant posés sur des rails, de longs câbles accrochés sur leurs flancs pour les amarrer le temps que l’eau monte. On les entend parfois geindre, et ça nous coupe le souffle.
Nous sommes si proches que lorsque les portes s’ouvrent de l’autre côté et que le monstre rallume ses moteurs, notre bateau est pris dans un tourbillon qui le flanque de plein fouet contre le remorqueur et son faux coussin. ça ne loupe pas : notre liston en bois éclate s’enfonce pratiquement à angle droit, un peu en arrière de l’étrave. Géraldine et Polo ont tenu la barre à quatre mains pour maintenir le cap mais ils n’ont rien pu faire contre la force du courant. Cette cassure rejoint celles faites Cap Vert et à Punta Arenas, la première étant à l’arrière, le deuxième au milieu et cette dernière, bien en ordre, à l’avant. Rien de dramatique, on en rigole presque – manifestement un liston en bois n’a rien à faire sur un bateau en acier. Edwin décroche la radio et demande au gros de devant de mettre moins de gaz la prochaine fois.
On passe trois écluses, trois grandes marches vers le haut, avant de se mettre en route pour le lac. Sur notre droite se profile le “sommet d’or”, une petite colline qui ne paye pas de mine aujourd’hui mais qui était auparavant une fière montagne. Les Français l’ont taillée jusqu’à en faire un petit tas de terre. On raconte que pour faire venir de la main-d’oeuvre, ils y enterraient des pépites d’or et faisaient courir le bruit qu’une mine entière s’y trouvait. Beaucoup venaient alors demander à être engagés comme ouvriers pour avoir le droit de creuser là. Ils travaillaient sous la chaleur infernale, sous les orages, dans ce climat inhumain qui profite à la malaria et au typhus. Malgré les rancoeurs et les injustices, les meurtres étaient peu courants : la chaleur, plus lourde qu’une grille de prison, annihilait toute vélléité de mouvement, toute pensée de révolte. On travaillait pour un dollar par jour, on économisait et parvenait à partir, ou bien on mourrait dans un délire de fièvre, brûlé sous la cagnard ou noyé dans une flaque. Avant d’être un trait d’union entre deux mers, le Canal était une parenthèse posée sur l’enfer, sans lumière et sans rédemption.
Face à la colline, à notre gauche, les “neos” traversent le second Canal : on les voit avancer derrière une ligne de fougères et d’arbustes, comme s’ils se déplaçaient sur terre avec leur milliers de containers, certains vert sur vert. On semble se déplacer plus vite et plus facilement qu’eux, et pourtant ils nous dépassent toujours. On s’invente qu’on fait la course, la Tortue contre le lièvre, mais sans toucher à la manette du moteur. Puis notre pilote reçoit un appel : un de ces “neos” arrive en sens inverse, il transporte des marchandises dangereuses et n’a pas l’autorisation de croiser qui que ce soit dans le Canal. On ne pourra pas finir le périple aujourd’hui. C’est un petit choc, nous sentons la Colombie continuer à nous filer entre les doigts, mais aussi une joie de pouvoir faire durer cette expérience un jour de plus. Rester entre les wagons et les arbres, sur de l’eau douce.
On s’amarre tant bien que mal à une grosse bouée jaune en mousse, notre babord faisant face à l’arrière d’un petit ferry en transit qui s’est retrouvé dans le même cas que nous. Edwin débarque, le prochain pilote arrivera le lendemain matin à neuf heures. On croise les doigts pour qu’il soit d’aussi bonne pâte que le premier et réfléchit à la recette d’un nouveau gâteau. Nous avons quitté le décor de gare pour retrouver celui d’un port, un chantier. Un crocodile patauge à quelques mètres – peut-être est-ce toujours le même, amoureux. On remonte l’échelle et renonce à se baigner, ne serait-ce qu’un orteil. Pas un baiser.
Nous repartons le lendemain matin à l’aube. Cette fois pas de flottement dans l’espace : il fait jour. Un de ces temps gris qui brûle le blanc à la caméra et rend difficile de filmer le ciel. J’essaye de faire des inserts, les mains de Polo sur le winch, les doigts de Géraldine enserrant la barre. “Passer du paysage au détail…” Mais bientôt ce paysage s’ouvre complètement et nous nous retrouvons dans la petite mer intérieure qu’est le lac tenu en tenailles entre les deux mondes. Le vent monte et on se retrouve même avec quelques moutons à la crête des vagues d’eau douce. Je pose la caméra, c’est relâche pour l’équipage hormi Edgar et Géraldine, seuls autorisés à se relayer à la barre devant notre nouveau pilote, M. Victor Herrera, un gros monsieur heureusement aussi agréable que le premier.
On navigue au moteur pendant plusieurs heures, les voiles étant interdites dans le Canal. À nouveau c’est le souvenir du fleuve : l’eau brune, la forêt, les îlots de végétation qui habitent de temps en temps la surface. Seule différence de taille, le nombre de cargots qu’on croise dans un sens comme dans l’autre, Tortuga parfois rattrapée et dépassée, parfois visée au loin puis évitée de ce qui nous semble n’être que quelques mètres. Alors que je sors la tête de la cuisine pour prendre l’air, je tombe nez à nez avec un navire de l’armée américaine qui nous longe de si près que je peux compter ses fenêtres et détailler ses traces de rouille. Il nous dépasse lentement, toujours dans ce silence impossible qui est la signature des plus lourds, et nous ne le retrouverons que quelques heures plus tard, à l’entrée de la nouvelle série d’écluses.
Il n’est pas devant nous mais à côté, dans l’autre Canal. Cette fois il n’y a pas de remorqueur à qui nous accrocher pour passer les portes : quatre hommes se sont postés à terre autour de Tortuga, deux sur chaque bord, et nous ont lancé des cordes lestées par d’épaisses boules, des pommes de Touline, qui rebondissent sur le pont. On y attache nos amarres et ils les reprennent, le navire se retrouve tenu par les quatre coins tel un moucheron pris dans une toile. Ça me rappelle un autre canal, tout là-bas dans le Sud, lorsque nos bouts enserraient des branches ou des rochers et que Tortuga flottait ficelée à la terre. Avant que les portes, lourds pans de bronze, ne se ferment derrière nous, un tanker nous rejoint et s’arrête à quelques mètres derrière nous. On admire la ligne fine de son étrave, coupante comme une lame, puissante comme une massue. La Tortue ne moufte pas, Géraldine ordonne à tous les équipiers de rester à poste et de surveiller les amarres. Il ne s’agit pas de se mettre en vrac devant un tel mastodonte, on reste attentif.
Je m’imagine le capitaine d’un tel navire, plus grand qu’un homme, maniant une roue plus large que notre mât, quand une petite voix perce à la radio de Victor. Je le regarde et, sûre d’avoir mal entendue, lui demande s’il lui arrive souvent de croiser des femmes capitaines dans son métier. Géraldine et moi nous attendons à la réponse habituelle, déjà un sourire en coin, quand il hausse les épaules et nous dit que oui, bien sûr, il y a beaucoup de femmes pilotes au Panama. Il lève sa radio et confirme : l’immeuble derrière nous est conduit par une dame. Voilà qui fait notre journée.
On passe une, deux écluses. L’eau descend cette fois. Lorsqu’elle atteint le bas et que Tortuga traverse le bassin, les amarres sont si basses par rapport aux rives que nos quatres équipiers doivent les tenir à bout de bras pour permettre aux hommes qui nous tiennent d’avancer en même temps que le bateau. Ils suivent notre route en trotinnant sur les berges, le long des rails qui vont servir au tanker qui nous suit, entre les petites maisons blanches qui ressemblent à des stations de train, des bureaux de chefs de gare. Le nom des écluses et leur date de finition sont inscrits sur chacune d’elle. Elles surplombent chaque marche, ouvrant la voie sur un escalier si droit qu’il tient plus d’un toboggan. Nos compagnons de quai doivent y courir, un oeil sur les marches, un autre sur le navire. C’est un système simple, qui nous surprend pour une aussi grosse machine que le Canal de Panama, mais il fonctionne. On parvient à prendre un rythme et, bientôt, le niveau de la deuxième écluse commence à descendre.
À la barre, Géraldine ne voit pas l’Atlantique. Nous l’admirons très bien à l’avant : cette marche est énorme, nous sommes à bien trente pieds au-dessus de l’océan. On l’observe comme du haut d’une tour. Vue sur l’horizon et le pont inachevé qui le traverse à l’embouchure du Canal, symbole peut-être involontaire de deux mains qui se tendent, se frôlent, ne se touchent pas.
Je vais à l’arrière et décris à ma capitaine cette vision. Alors que notre vieil océan est réapparu devant moi, la sensation que j’avais de retour et d’achèvement s’est évanouie. C’est toute une aventure qui commence. Un nouveau voyage va prendre place et la fin est encore loin. J’ai l’impression de repartir. On doit se tenir devant notre pilote mais je sens le corps de mon amie vibrer, le coeur à toute allure, la main sur la poitrine. La Rochelle est tout au bout là-bas, presque visible, presque déjà là. À portée de main.
Se frôlent.
Mais ne se touchent pas.