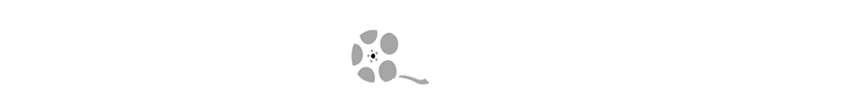Buenos Aires, jeudi 21 septembre. Comme si les bulles de mer qui nous transportent d’un temps à l’autre, d’un espace à l’autre, venaient de se propager. On quitte l’hiver, sans y être jamais arrivés. Le printemps, quand c’est l’automne. Le meilleur côté de l’équinoxe.
L’équipage est rentré fatigué. Une navigation difficile. C’est la première fois depuis le convoyage, de Bretagne à La Rochelle, que Tortuga subit un force 7. Du bon vent, sur une longue durée, qu’on raconte avec entrain car la barre a été dure à tenir, les quarts sportifs et parfois compliqués. La manille de l’enrouleur du génois a lâché, laissant la voile se déployer au milieu d’une survente. La grand’voile s’est coincée dans son propre taquet, 28 m2 de toile tendus à bloc en plein affalage. Hercule le regul’ a failli partir par le fond, les membres disloqués par les vagues. Géraldine l’a sauvé in extremis et depuis il fait grève. L’équipage a dû renoncer à ne regarder que les étoiles pour diriger à nouveau la tortue à la force des mains. La capitaine n’a pas fait une seule nuit complète, toujours à régler les voiles, assurer la navigation, tenir le cap.
Cap Buenos Aires, atteint depuis Rio de Janeiro en 12 journées.
Équipage essentiellement féminin. Donatien perdu en salon de beauté, plein océan, les culottes qui sèchent et les conversations à cœur ouvert sur le pont, de nuit, de jour. Maria parle portugais avec Roberta qui parle portugais et français, comme Emelyne, comme Géraldine, qui a appris cette langue et traduit en français à Donatien qui parle anglais avec Maria, qui rit beaucoup, comme les autres, dans toutes les langues, un équipage qui s’aime, comme les autres équipages, dans toutes les langues, d’Emelyne à Roberta, de Géraldine à Dona, Maria, Maria les cheveux bruns, cheveux noirs, et blonds. Peut-être Donatien ne voit-il pas la terre arriver cette fois-ci. Peut-être rêve-t-il encore de cette baleine immense, qui s’est jetée hors de l’eau alors qu’ils se baignaient, à quelques mètres du bateau, extirpée des flots jusqu’à la queue; un atterrissage comme un volcan. La lune est bleue et sans cratère.
On me dit encore les phoques qui font la planche et se laissent dériver sur le dos, tranquilles. Une patte sur le ventre, l’air hagard; heureux. J’imagine Tortuga qui traverse un cirque aquatique, ballons rouges sur l’écume, le type sur une seule roue qui pédale à l’horizon et les éléphants à aileron.
J’imagine puisque je ne suis pas là. J’ai laissé Géraldine et Tortuga partir sans moi, après près de 4 mois de vie commune. Ça sera deux semaines de séparation où je me réconcilierai avec la terre. Le corps soulagé de ne pas retourner à la gîte. La senteur des arbres du parc national d’Ibera, forêt plus humide que la mer, terre noire, marécage. Le vacarme des chutes d’Iguazu.
Je voyage avec Jérémy, compagnon venu participer à la prochaine traversée et, d’aventuriers, de voyageurs, de cinéastes, nous devenons touristes. C’est un habit assez inconfortable, dont on ne sait vraiment que faire. On suit le flot qui va vers les plus hautes chutes du monde, coincées entre trois frontières, et fuit ensuite dans la pampa argentine. Iguazu ; Ibéra. Il aurait fallu venir plus tôt et y rester. Il n’y a rien, que les rongeurs et les caïmans. Un rêve d’Amazonie au sud du Brésil. Les quelques gardiens du lieu se réchauffent au maté et attendent les amoureux de la faune pour leur proposer des tours en bateau et à cheval. Je monte dans une barque sur cette fausse mer, et pense au petit navire vert qui essuie sa deuxième tempête.
Tortuga. Elle s’appelait Prosper. Née en 1981 des plans de Bernard Veys, elle est pensée le ventre large, spacieux, comme le bateau de voyage au long cours qu’elle sera toujours. Erwan Touze, un de ses anciens propriétaires nous écrira de la laisser filer, elle connaît la route. Déjà trois transatlantiques, un tour des Caraïbes, et les berges du Saint-Laurent.
Fin 2013, elle est rachetée par Robin Lordon et trois de ses amis. Ils allaient mettre à l’eau, quand ils découvrent que la coque est rouillée. Huit mois de travaux commencent: ce sera Tortuga telle que nous la connaissons, renommée et aménagée, les coffres blancs taillés dans les sièges et les pots d’épices cloués au plafond.
En octobre 2015, c’est Thomas et sa compagne qui acquièrent le navire. Ils installent des filières sur tous les balcons et chandeliers, font du rafiot un panier. Protéger leur petit de deux ans, qu’il soit bercer dans un cocon qui nous rassure. On dira ensuite que ces filets sont les limites de nos vies. Qu’on passe par-dessus bord, c’est un aller sans retour, quelques secondes avant de découvrir le grand bleu et d’y rester.
Un jour que Thomas passe devant un chantier nautique, il aperçoit des pare-battes peints du même vert que la carapace. Il fait un détour et négocie; ces petits boudins verts sont encore notre joie et notre fierté. Certains ont disparu dans les vagues, maintenant on les attache mieux que nos gilets, nœud de cabestan et demi-clés en série. La tortue est prête à reprendre la mer, mais cette fois elle restera au port: le couple se sépare, largue d’autres amarres.
Géraldine Marin, Stéphane de Châtillon, Fanny Dufresne et Thibault Peigney l’achèteront le 15 août 2016 après avoir visité huit autres embarcations dans six villes françaises. Tous membres du Bato À Film, ils cherchent en urgence un navire qui puisse convenir à l’expédition autour du continent sud-américain, prévue en mai 2017. Tortuga sera choisie malgré son moteur déficient et sa petite taille. 10m75, pour faire une fois la circonférence de la Terre, 21 000 miles nautiques comme 39 000 km, une longue étreinte, un baiser serti d’écumes.
Au début, le bateau qui devait nous porter était un Sancerre. Créé par l’architecte Philippe Herlé, ami des vignobles, auteur des Muscadets, Sangrias, Cognacs, Armagnacs et autres liqueurs faites coques et mâts, petits bouchons flottants et bien taillés aux courbes douces et élégantes, ce Sancerre-là n’était que faussement à vendre. Sa propriétaire, Fabienne, l’avait hérité de sa famille et y possédait tous ses souvenirs d’enfance. Mariée à un homme comme elle, marin, amoureux de son propre navire, que son père avait construit de ses mains, une boite à souvenirs semblable à la sienne, semblable à ce que deviendra Tortuga pour nous, elle avait dû débattre avec son époux de ce qu’ils allaient faire de ces deux bateaux qui se partageaient un seul amour. La décision douloureuse de vendre les deux madeleines fut prise; le mari s’acquitta de la mission et elle attendit, incapable de couper le bout, qu’on vienne lui voler son bien à coup de récits d’aventure et de rêves lointains.
C’est ce qu’elle demanda à Géraldine et c’est ce que Géraldine fit. De capitaine à capitaine, elle lui raconta le nouveau destin qu’elle voulait offrir à ce fin bouchon de première qualité. Un tour de continent, des films, des images, des souvenirs à ranger encore dans la boite, devenue boite noire pourrait-on dire.
On décida que le bateau ne serait pas vendu mais prêté. Le couple se débarrasse d’un navire et se trouve enfin libre d’en acheter un neuf, tout frais pour l’amour, une nouvelle histoire, et en échange nous nous saoûlons une année durant du luxe improbable de naviguer sur un navire de première cuvée.
Ce fut presque signé. Géraldine rencontre aux Glénans un autre moniteur, Yannick Masson. Il possède une goélette, belle et spacieuse, qui n’a navigué que pour se rendre de chantier en chantier, et qui attend l’aventure. Il lui propose d’être son skipper et de prendre en charge toute la partie navigation du projet, de sorte à ce qu’elle puisse se consacrer entièrement à la production des films.
Géraldine rompt le contrat de prêt du Sancerre, et embarque sur Nora. Nous ne nous connaissons pas encore à l’époque et je ne verrais que des photos de la goélette. Un tel bateau, deux mâts, un pont de bois sculpté, une roue à la place de la barre: un rafiot de pirates que nous aurions aimé. Lorsque je signe pour le voyage, j’attends par-dessus tout de pouvoir monter à bord de ce bout de film sorti d’un écran pour nous faire chavirer.
On coule avant. Pas le rafiot mais l’amitié, et le contrat. Yannick envoie quelques phrases par email, un adieu sans cérémonie, sans raison, un prélude de Nelly Andreo qui nous fait froid dans le dos et nous douche à sec.
Nous sommes quelques jours avant l’été 2016. Une navigation est prévue avec l’équipe au mois d’août, et le grand voyage doit se faire cette fois l’année suivante, car il a déjà été repoussé et même les grandes aventures ne tiennent pas l’usure du temps et ses désillusions insidieuses. Il faut qu’on embarque.
Cet été-là, je signe pour une saison en tant que marin d’eau douce sur la Seine, ce qui fera beaucoup rire ma capitaine. Matelot chez Batobus, la compagnie parisienne concurrente des Bateaux-Mouches, je passe tous les jours devant La Boudeuse de Patrice Franceschi et l’impatience monte, monte doucement.
Géraldine consacre tout son temps libre à la recherche de ce qu’elle ne sait pas encore être Tortuga. A défaut de pouvoir être en mer, elle vient jouer de la guitare à mes passagers, de nuit entre Olympiades et Concorde, au pied de la Tour Eiffel illuminée. Le Bato A Film devient une légende pour les employés de Batobus. Sur la rivière de Paris, on ne parle plus que de l’Atlantique et des côtes chiliennes. On commence notre voyage sur une péniche à deux coques, un toit en verrière, pour ciel la ville lumière. Rêve d’estuaire.
Lorsque Tortuga est achetée, Géraldine nous envoie une photo et soudain, l’Amérique Latine fait un pas vers nous. Nos quatre amis viennent de vider leurs économies et de s’endetter pour que notre expédition puisse avoir lieu. Il ne sera plus possible de reculer. 15 août 2016 : Le Bato A Film est né, et ne fera plus qu’avancer, sans plus regarder en arrière. Tortuga devient notre monde. De nouveaux travaux commencent. Stéphane, Géraldine et Thibault se relayent au chantier de Paimpol des mois durant, aidés par les amis des Glénans et les camarades croisés en chemin, nouveaux amoureux du projet, adjuvants essentiels d’une aventure qui se construit toujours en commun, toujours par coups de main, coups de miracles.
Je passe l’année qui suit à enchaîner différents emplois pour faire grandir le pactole qui va me permettre de vivre quinze mois durant sans travailler. De matelot à Batobus je passe vendeuse à Décathlon – rayon marine, encore une grande blague dont se réjouit ma capitaine -, puis vendeuse de DVD et accessoires de mode au MK2 Quai de Loire. Je croiserai parfois dans le magasin de ce cinéma des cinéphiles invétérés qui me mettront à l’épreuve, me demandant de leur trouver des éditions épuisées d’œuvres oubliées et improbables, s’amusant parfois à cacher le titre d’un DVD pris au hasard pour me faire deviner le film à l’affiche, allant même jusqu’à venir me voir l’air débonnaire, les mains croisés dans le dos tels des professeurs d’école, et me faire réciter le nom des acteurs présents dans tel ou tel premier court-métrage de David Lynch ou Martin Scorsese, comme si c’était la leçon que j’étais censée apprendre la veille et qu’ils venaient me faire réciter.
Je me repose de ces exercices en regardant passer le petit Zéro de conduite entre le MK2 Quai de Loire et son reflet de l’autre côte du canal de l’Ourcq, MK2 Quai de Seine, également ancien entrepôt reconverti en complexe dédié au 7ème art. Sur leurs façades, des néons clignotent des cœurs, Sinéma, les anges sont avec toi inscrit en lumières fades, j’aime cet endroit et c’est avec un pincement que je démissionnerai pour prendre une autre barque, un peu mieux notée en conduite, apprendre un nouveau métier, un nouveau monde.
Entre ces emplois, du mois de mai 2016 à celui de 2017 qui nous verra partir, j’ai l’occasion de participer trois fois aux séances de la commission Aide aux Cinémas du Monde du Centre National du Cinéma et de l’Image animée, dit CNC. Institution publique, le CNC est ce qui permet au cinéma français d’être un des plus prolifiques au monde, avec ceux d’Hollywood aux USA et de Bollywood en Inde, et surtout de défendre une diversité d’œuvres inégalée en soutenant les nouveaux auteurs, les nouveaux styles, les défis et les tentatives parfois les plus improbables, les plus anonymes. A condition, entre autres, longue liste qui mêle finances et matériel, qualité d’écriture du scénario et preuves de talent pour l’image, expérience des acteurs et rigueur du cinéaste ; à condition, que l’exigence soit là, et qu’on y croit.
Le Centre recouvre les taxes imposées au secteur de l’image et redistribue aux producteurs l’argent récupéré par exemple sur les places de cinéma que nous achetons en tant que public, de sorte à ce que l’amour des films serve à produire de nouveaux films, un cercle complexe et bien pensé qui assure une nouveauté continuelle dans ce paysage, discours de sons et d’images sur un rapport au monde qui se renouvelle toujours, se raconte encore, s’affine, peut-être.
Je suis recrutée en tant que lectrice de scénarios pour la commission Aide aux Cinémas du Monde, anciennement Fonds Sud cinéma, que je nomme d’après le titre du livre qui lui a été dédié, Au Sud du Cinéma. Cette délégation, créée communément par le CNC et l’Institut Français, est vouée à promouvoir la production de films étrangers qui ont une co-production française. Ainsi passent sous nos yeux, à nous lecteurs, cinéphiles et professionnels rendus anonymes sur les fiches de synthèse que nous rédigeons pour chaque œuvre, des scénarios signés de la main de cinéastes venus du monde entier, du Mali au Japon, de l’Indonésie au Mexique, de Roumanie, d’Ethiopie, d’Iran et Madagascar… C’est une entrée dans un imaginaire multiple et mondial, commun et si particulier, qui transforme les après-midi de lectures en tours du monde faits d’encre et de désir d’images.
J’apprends à écrire du cinéma en lisant les histoires des autres, et débute ici une relation qui se révélera être de longue durée avec les services de la diplomatie d’influence française, l’Institut et les Alliances. D’abord, l’équipe du Bato A Film est réticente à l’idée de s’adresser à ces institutions pour diffuser notre travail en Amérique Latine. Il y a des Alliances dans toutes les grandes villes du continent, et notre projet est en phase avec leur démarche interculturelle: une aubaine, que pourtant nous hésitons à saisir. Les modalités de la rencontre ont leur importance, surtout dans un espace qui ressent encore tout le poids de son passé colonial, et pour qui le terme d’Européen est souvent synonyme d’ennemi ou de danger. Commencer le dialogue à travers une Alliance nous semble maladroit, presque injurieux. Nous voudrions entrer directement dans des lieux culturels locaux, latino-américano-américain, et faire un pied de nez à nos compatriotes, devenus marginaux.
C’est une erreur. Les Alliances sont créées par et pour les locaux, sur des initiatives françaises qui ne visent qu’un dialogue, une embrassade. Des cartes dans les couloirs, des salles de classe et de cinéma, projections gratuites, échanges, un possible comme un futur sans guerre, où on se connait, s’écoute.
Dès Recife, c’est elles qui viennent nous chercher. On nous offre une salle le soir même, sans temps pour communiquer, on va larguer les amarres dans la foulée pour la prochaine traversée et il n’y a le temps que de prévenir les collègues. Ce sera un petit comité franco-brésilien, composé de membres du Consulat et de l’Alliance qui nous accueille. Une soirée à parler de la vie loin de Paname, loin du bon vin, dans la saveur des rues belles et dangereuses d’une ville du Nord d’un autre monde. On déplore le foutoir ambiant, et s’y love. Comme si c’était trop difficile de dire sincèrement qu’on aime ce qui ne marche pas, ce qui est plus lent et plus risqué, ce qui passe inaperçu des cartes postales et des récits de voyage manichéens. On vient ici parce qu’il n’est pas possible de vivre ailleurs, sans les cris du marché des avenues trop chaudes, et les batucadas africaines toute la semaine.
A Rio de Janeiro, Thomas Brégeon, directeur, nous organise une séance qui met définitivement fin à nos doutes sur la bienséance de collaborer ou non avec ces institutions. Annoncée la veille pour le lendemain, avec une unique publication sur le site de l’Alliance concernée, notre projection amène une vingtaine de personnes que nous ne connaissons pas, qui viennent pour nous, pour le projet, sans copinage ni autre intérêt. C’est notre plus belle réussite. Dans une salle de cinéma avec fauteuils rouges et grand écran. On s’y croit pour de vrai. Le public est majoritairement brésilien; j’entends une remarque des deux dames derrière moi sur le fait que la musique d’O Beijo soit en espagnol et non en portugais, on y avait pensé, hésité, mais le rythme nous a plu, on a fermé les yeux, pas elles.
La séance se termine sur un échange avec le public. Assis sur scène, on nous apporte même une petite bouteille d’eau fermée, discrètement, comme je l’ai souvent vu faire lors des rencontres organisées par les ciné-clubs avec les réalisateurs et les équipes de tournage. Nous sommes fiers, ça se sent sur les planches, les fauteuils craquent sous nos plumes de coqs et on essaye de contenir notre joie pour ne pas sourire bêtement. On se prendrait presque pour des professionnels, toutes ces attentions. Thomas Brégeon anime le débat, le public est timide, peut-être à cause de la langue, peut-être parce qu’il n’y a pas à dire, on raconte le voyage et les résidences, raconte la mer, le Cap Vert. Une petite main se lève et demande, seulement: comment est-ce qu’on va faire, après tout ça, pour pouvoir revenir?
Bonne question. Je réponds en entourloupe qu’on ne revient pas, puisqu’on est cinéma, et que le cinéma est partout. On continuera à vivre dans les films, et à en faire.
Et la mer? Les embruns? La solitude des nuits froides et des étoiles, l’amarrage au port nouveau?
Bonne question.

Thomas Brégeon, directeur de l’Alliance Française de Rio de Janeiro, Géraldine Marin, Charlotte Billard (moi) et Donatien Burkard lors d’un échange avec le public après la projection
De ma participation à la Commission Aide aux Cinémas du Monde, me restera en particulier le détail minutieux de l’écriture de Fellipe Barbosa pour le film Gabriel et la Montagne, sélectionné à Cannes et sorti en salle en septembre 2017. Je le défends auprès de Charles Tesson, président de la commission, parce qu’il place au cœur de son questionnement cette position intenable qui est celle du touriste blanc en pays non-européen. Gabriel Buchmann était un étudiant brésilien idéaliste, et ami personnel de Fellipe Barbosa. En 2009, alors qu’il s’apprête à terminer un tour du monde d’un an par un séjour au Malawi, il est porté disparu puis retrouvé mort sur le mont Sapitwa, nom qui se traduit par « N’y va pas ». A l’époque la presse s’émeut de cette mort étrange, le corps d’un jeune homme issu d’une famille aisée brésilienne dans la terre du Malawi, mangé de froid, mangé de faim. Gabriel a renvoyé son guide pendant la dernière phase d’ascension, et s’est perdu dans la montagne. Je défends ce film c’est vrai, parce que je ressens une empathie simple pour ce personnage dont j’ai partagé la naïveté dangereuse lors de mes propres voyages, me perdant moi-même en forêt indonésien par dédain des guides, risquant une avalanche en montagne au mépris des avertissements des gardes forestiers, jouant au poker avec une mafia cambodgienne qui finira par me détrousser et m’abandonner dans un centre commercial, dans une banlieue de Phnom Penh.
J’étais alors avec le cinéaste franco-cambodgien Davy Chou, encore peu connu malgré la qualité de son documentaire sur l’histoire de l’annihilation du cinéma national par les Khmers rouges lors de la révolution communiste. Le Cambodge était jusqu’à cette époque une terre cinéphile, aux auteurs prolifiques et au public averti et passionné. Norodom Sihanouk, monarque puis chef d’Etat du pays, était lui-même cinéaste, et abreuvait son peuple de mélodrames où était mis en scène sa femme et leur amour.
Les Khmers rouges ont détruit méthodiquement chaque pellicule, chaque salle de projection. Le cinéma est devenu passé, et les vieux parlent des acteurs qu’ils aimaient sans pouvoir montrer leur visage aux jeunes qui les écoutent. Seules certaines bandes sons ont survécu, enregistrées sur d’autres pellicules et devenues aujourd’hui les hits des karaokés où les citadins vont chanter le soir, en bonne compagnie ou entre amis.
Rithy Panh, documentariste et cinéaste de renommée internationale, a créé dans la capitale un Centre entièrement dédié à la recherche et à la restauration des films antérieurs à cette catastrophe dans l’histoire mondiale du 7ème art. Autour de lui et de son institut, nommé Centre Bophana, se sont regroupés les cinéphiles de la nouvelle génération cambodgienne, de sorte qu’on voit depuis plusieurs années émerger une sorte de Nouvelle Vague dans ce pays.
Davy Chou est sans aucun doute la figure de proue de ce groupe grandissant, remarqué pour son documentaire Le Sommeil d’or et assis définitivement comme un des cinéastes contemporains les plus prometteurs avec Diamond Island, sorti en 2016.
Aussi étais-je assez mal à l’aise lorsque, après cinq heures d’attente hagarde dans la cafétéria de mon centre commercial, je dû me résoudre à l’appeler et lui demander de l’aide.
Nous passâmes la journée du lendemain, lui assis à l’arrière d’un taxi-moto et moi du scooter que conduisait sa femme Kanitha, à la recherche de la maison où j’avais été assez stupide pour jouer une petite fortune aux cartes, et perdre ainsi une bonne part du budget alloué au voyage que je désirais faire en Asie. Nous ne la retrouvâmes jamais, et c’est surtout mieux ainsi car je me demande ce que nous aurions fait dans le cas contraire, nous trois face aux caïds, penauds devant ceux qui nieraient tout en bloc et plus petits encore devant ceux qui hocheraient la tête d’un air entendu.
Ainsi je me sentais proche de Gabriel, et le mépris que je ressentis pour lui à la lecture du scénario de Barbosa me rappela le profond mal à l’aise que j’avais eu l’occasion de ressentir de nombreuses fois pendant ces onze mois passés entre l’Inde et l’Asie du Sud-Est. Gabriel essaye désespérément d’être l’un de ceux qu’il visite, de se mêler à la foule et d’être, plutôt qu’inaperçu, flagrant de vérité, parfait décor, harmonie. Il est souvent parasite, parfois touchant, presque toujours déconcertant. On a de la pitié pour lui parce qu’il ne peut rien faire contre sa condition. Touriste, il est forcément riche, forcément étranger, et ses tentatives de voyager au plus proche des gens une sorte de pantomime, dont on ne sait quoi penser.
Que dire pourtant ? Qu’il faudrait rester chez soi ? En vérité la question du tourisme est celle des modalités possibles d’une rencontre, d’un surpassement idéal des frontières géographiques et économiques. On tente de distinguer les touristes des voyageurs, les voyageurs des aventuriers, et tous ont leurs écueils, tous sont limités. Le fait même de faire des catégories place une nouvelle barrière qui ternit encore un peu le monde, réduit les possibilités d’entente et de compréhension. Il y a là un centre névralgique de la pensée moderne, du vivre au monde actuel, que je trouve par trop passé sous silence, comme si le tourisme était devenu une évidence alors qu’il reste dans bien des cas un problème et une question.
Aussi Le Bato A Film tente, autant que possible, de prendre en compte cette position et de s’en éloigner autant que possible. Nous venons pour une rencontre, et depuis que cette rencontre est désorganisée par le départ de la coordinatrice chilienne Nelly Andreo c’est tout notre rapport aux autres qu’il faut reconstruire.
On y arrive. Nous croisons sur ce chemin entre mer et terre des perles qui nous sautent au cou et nous aiment. Nous n’avons pas assez de bras pour le leur rendre, pas assez de bouches pour les remercier. Ils font notre route, plus sûrement que le vent et l’écume. Bob Lima au Cap Vert. Les Sin Mapas à Rio. Dietlind et Anouk à Buenos Aires. Nous sommes portés par d’autres, qui nous disent sans broncher qu’ils veulent nous donner le meilleur de chez eux car nous sommes venus de loin. On tend la main, et croule sous les présents du temps, des regards, les sourires. Il y a une rencontre possible, et pour nous elle se fait sur les rives d’un océan éternel, à coups de crayon, en touches d’aquarelles.
Tortuga est arrivé dans un nouveau yacht club. C’est un lieu discret et somptueux, au nord du port officiel. Une bâtisse ancienne, bois verni et grandes pierres blanches. On avance là à tâtons ; toujours trop brusquement. On nous reprend pour les baskets laissés sous les sièges, les miettes de pain le matin, les verres de café et tout ce tintamarre de nos rires et discussions. Nomades lovés dans un palais d’or, on profite du confort, savoure la chaleur des salles d’eau et des sofas de soie. Tortuga devient un rêve qu’on regarde depuis la fenêtre, de loin, comme si c’était hier et non demain. Il y a une bizarrerie à vivre dans le seul lieu interdit aux habitants de la capitale: on vient raconter une ville qui nous accueille dans un secret, un château gardé que seuls peuvent se payer les privilégiés amateurs de marine.
Pour remercier les participants à notre résidence, on les invitera ici, voir Tortuga mais surtout ce bout de leur ville qui leur est inconnu, refoulé. D’un cadeau à l’autre, Buenos Aires apparait, morcelée peut-être, mais offerte, et sans arrière-pensée.
Géraldine repartie en France le temps d’un mariage, d’un impératif, la tortue a cru pouvoir entrer en hibernation, poser la quille et détendre un temps les bastaques. C’était sans compter sur l’arrivée joyeuse de Stéphane, vice-président de l’association, second de la capitaine pour les navigations à venir, et co-propriétaire de la bestiole. La tortue est de nouveau sous les vis et les coups de peinture, jamais tranquille, le nez bien en l’air et les ongles des pattes bien limés.
Celui qu’on surnomme Petit Poucet parce qu’il sème toujours ses affaires est en charge du navire pendant que je tiens tant bien que mal les rennes de notre première résidence argentine. Géraldine me laisse l’honneur d’être réalisatrice de ce court-métrage, et j’en profite pour y glisser des plans en prise de vue réelle, filmer Buenos Aires sous toutes les coutures, temps gris et pollution, grand soleil et pelouses, les tours jusqu’au ciel et le rase-motte des infinies avenues. Une sacré ville, qui ne nous plait pas mais nous divertit, nous agresse et nous amuse. Les milongas où vit encore le tango, les marchés où tout s’achète, les quartiers chics qui évoquent Paris par leur architecture haussmannienne et la favela qui encercle la gare de Retiro. Je la traverse un soir, ce n’est pas l’Asie, ce n’est pas Rio, on ne me remarque pas et j’aimerais pouvoir m’asseoir-là, je ne sais pourquoi.
Buenos Aires est une ville de théâtre. Ce n’est pas évident car la vie commence tard, bien après la nuit, et joue sur des scènes impromptues faites des planchers de maisons anonymes. Ce qu’on nomme les variétés réunissent comme à l’improviste clowns, musiciens, chanteurs, pour un spectacle accompagné de pizzas dans la cour ou le sous-sol d’une demeure. Accents italiens et portugais pour ce pays d’immigrants qui appelle les croissants des medialunas et vend de la mozzarella à tous les angles.

Devant le Teatro Colon, le plus grand opéra du monde, ceux qui n’ont pas pu entrer regardent la Traviata projetée en simultané sur un écran extérieur. Chaises de plastique et coupes à maté
On ira Place de Mai. On nous racontera l’histoire. Aujourd’hui, et depuis août, sur tous les murs, des affiches cherchent Santiago Maldonado. Cet artisan de 28 ans a disparu alors qu’il participait à une manifestation de la communauté des Mapuches en Patagonie, revendiquant la propriété de terres ancestrales à l’entreprise italienne Benetton. Le peuple refuse d’oublier. Encore un disparu, ça ne se dit pas. Un disparu. Les réseaux sociaux questionnent en boucle, en échos aux façades, aux trottoirs, aux terrasses : Donde esta Santiago Maldonado ?
L’association des Mères et des Grand-mères de la place de Mai s’est associée aux recherches. C’est comme si l’histoire n’était pas tout à fait finie ici. On nous conseille, avec un drôle de naturel, de ne jamais avoir affaire avec la police. Souvent, nous dit-on, les trafics commencent et finissent au même endroit.
On reste à l’écart.
Dans les fauteuils molletonnés du yacht club, les coins sombres des milongas.
Entre la mer et le tango. Cette terre et le nouveau départ.
Le sud bientôt.
A voix basse, ça commence. Entre deux phrases. On prononce.
Ce Sud-là.
Cap Horn.