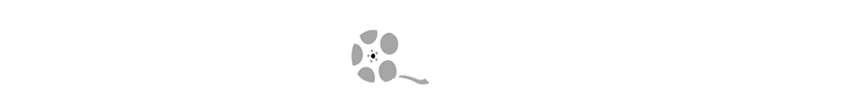Rio. La chance. Elle parsème notre balade de bout en bout. Le Christ les bras ouverts au premier regard, grand large. Nous enlace.
Le port d’abord. On se fait refouler par le yacht club d’Urca d’une façon doucereuse et violente. On aura le droit de parler avec le directeur le lendemain, quémander d’être membre, partenaire, ami. Une place pour Tortuga dans un océan de richesse et de bonnes manières. Piscine privée. Petit polo sur les épaules dans le restaurant aux murs blancs, couverts en argent. On est en claquettes. On a faim. On nous demande de patienter en restant cloitrer dans notre rafiot, pas même un verre d’eau. Vingt quatre heures d’attente pour devenir dignes. Revenus a bord, nous sommes déboussolés par cette pétole imprévue qui met un frein a notre entrain de toucher terre après 13 jours de navigation.
Arnaud tente un radeau de secours a coups de pompes dans l’annexe, qu’on puisse s’échapper par la plage qui est a proximité. A tribord, un couple passe au moteur. On les hèle comme si Tortuga allait par le fond, toutes mains dehors et la voix forte. Ils s’approchent étonnés, nous lance un bout. Notre capitaine leur explique que nous sommes exclus du continent jusqu’au lendemain et que les négociations s’annoncent mal. Ils rient et embarquent la capitaine d’un air entendu, une solution déjà dans leur besace et pas d’inquiétude.
L’équipage reste penaud sur le pont, plus perdu que jamais. Tortuga semble soudain si exiguë qu’on ne sait plus où s’asseoir. Géraldine débarque sur un autre navire, non loin, et discute avec un groupe d’hommes. Bientôt on vient aussi nous chercher, et nous nous retrouvons tous sur le San Antonio, un bateau-plateforme qui fait office de capitainerie pour le port informel qui s’est créé au revers du yacht club. Accueil des exclus du parterre de marbre et des verres de champagne.
On boit de la bière en dévorant des saucisses. Le San Antonio à côté des voiliers Idéfix et Tutatis. On se dit qu’ils sont fous ces cariocas, et qu’on a bien notre place ici. Une heure plus tard, Tortuga est amarrée à une bouée et nous attablés devant une grillade qui nous coupe la parole pour ne laisser place qu’à de grandes exclamations de plaisir. Rio commence.
ça s’enchaine. L’école de communication qui devait accueillir notre résidence ne répond plus à nos emails. A la rue encore une fois. Notre date de début repoussée jusqu’en milieu de semaine. J’embarque mon ordinateur dans un sac étanche et rejoint la rive pour m’installer dans un bar, écrire et commencer d’une façon ou d’une autre notre nouveau film. Je marche dans les rues d’Urca en m’agrippant à mon baluchon de plastique dur, peu sereine de sortir ainsi au grand air un de nos principaux outils alors que Bernardo semble si inquiet de consulter son téléphone sans s’être d’abord refugié dans une boutique, un coin sombre.
Je passe sous un pont, juste derrière notre petite plage, et croise les portes de l’Institut européen du Design. C’est un bâtiment fait de grands espaces, au parterre de bois et aux vitres immenses. Vue sur la plage. Une petite cafétéria où je rencontre Alexandre. Le directeur de l’Institut a les cheveux longs et les yeux noirs. Une vraie lumière. A peine un échange, et il nous donne une salle pour six jours. On arrivera chaque matin à la rame, les pieds mouillés, les mollets couverts de sable. Travailler les orteils dans l’eau, vers la mer, pour la mer. Tortuga depuis la fenêtre, se balance au gré des remous des petits bateaux à moteur qui la dépassent. Nos affaires dans de grands sacs bien fermés pour la traversée, aquarelles et pastels, crayons et ordinateurs, papier. On s’installe là comme dans un palais. Onctueusement.
ça continue. Bernardo et moi découvrons les rues de notre quartier. Urca serpente au pied d’une colline, un morro qui est la première étape pour accéder au Paõ de Azucar, mont emblématique de Rio avec celui qui supporte le Christ. Cette géographie limitée en fait une des zones les plus sûres de la ville: une seule entrée, une seule sortie, et un fort militaire au bout du chemin. Le yacht club y côtoie une enclave maritime qui sert de garages aux bateaux de pêcheurs. C’est une ribambelle de petits jouets de bois aux couleurs vives. On s’arrête là, et aperçoit le bus de Sin Mapas qui se détache sur le gris des bâtiments, coloré comme un bateau, couvert de chaussettes comme Tortuga après une tempête.
Je les renifle deux jours avant d’oser l’abordage. Ce n’est qu’en nombre, avec mon équipage, qu’on s’approche finalement de ce fantasme de voyage, bus multicolore rempli de couchettes et de notes de musique, pour leur dire qu’on les aime, qu’on les veut, qu’ils viennent sur Tortuga le soir même. La carapace tiendra le choc, onze Argentins et cinq Français prennent l’apéro, quelques bières, trois guitares. Les voix d’Astrid Groth et de Josefina Cañazares, qui signera Josefina del Norte le générique de O Beijo après avoir sauvé le film avec la douceur d’une de ses chansons. En el norte de Brasil…
C’est l’hiver. C’est l’été. Notre résidence, qui devait se faire à six, s’organise à quinze. Les Argentins en balade font une pause, fusains et peintures pleins les doigts, le matte jamais loin. Nous faisons ensemble le storyboard d’un film qui dit une ville encore inconnue. Quatre Brésiliens nous accompagnent et nous guident. On échange sur nos premières impressions, se concentrent sur les courbes qui parcourent Rio et les Brésiliennes, collines, hanches et montagnes. Oscar Niemeyer, architecte réputé du pays, dira qu’il n’y a pas d’angle ici. On imagine une géante qui s’allonge sur le sol et laisse la ville la prendre, la couvrir.
Le bordel des favelas le long d’un sein. Les danses de Lapa en battements de cœur. Tijuca respire, des arbres fous des hauteurs jusqu’à la plage. On visite le jardin botanique et le trouve moins impressionnant que la végétation des avenues. Partout, les nuances de vert rejoignent les teintes de bleu, azur et marine. Le béton terne est orné de sable jaune, de terre fraîche. Rio ville totale. Rio ville animal, câlin et hargneux, tendre et dangereux. On nous met en garde. Les tueries sont fréquentes et la criminalité fait concurrence à celle de Mexico. Depuis le début de l’année, plus de cent policiers ont été tués dans des rixes et des règlements de compte. On prend le taxi – non, le Uber – pour dépasser chaque ruelle, mettre derrière soi toute possibilité de mauvais souvenir, de point final. La nuit arrive comme dans un film, la sortie des bêtes, les pas qui s’accélèrent pour rentrer plus vite. Et pourtant. C’est l’hiver, c’est l’été. Les noix de coco sur la plage d’Ipanema. Les rues piétonnes le dimanche et les balades dans les communautés, favelas oubliées, pacifiées, prêtes à exploser mais calmes, encore. On ne voit rien; ne nous arrive rien, plutôt. L’ennemi qui nous menace est dans les mots qui nous racontent. C’est comme marcher sur des aiguilles dans une botte de foin, on est sur la pointe mais ça reste doux.
On nous dit aussi la crise financière, débutée en 2008 et aggravée par la fin des Jeux Olympiques. Les professeurs ne sont plus payés, d’abord ceux de banlieues et puis ceux des écoles centrales de Rio. Les centres culturels ouvrent, ferment et rouvrent, referment en fonction du budget possible et de la continuité des programmes présidentiels. Une politique par dirigeant, aucune vue commune, aucun suivi mais des annulations, confrontations, oublis, mises à la trappe. La corruption.
Les favelas, créées à la fin de l’esclavage par une population libre et désœuvrée, alimentées par les soldats retraités des anciennes guerres, se nourrissent maintenant du chômage et de la misère. Des maisons de briques et de tôles roses. Les escaliers qui serpentent, montent, montent et montent encore. Tous les dessins. Rio est amoureux de ses favelas. Il les craint et les admire avec la même force, la même persistance. Partout on les voit orner les collines, partout on les regarde donner à la ville son souffle terrible. On traverse Vidigal et Santa Marta, les plus tranquilles, dit-on, on ne voit rien mais la vue des hauteurs est sublime. Copacabana est un tapis aux pieds des dealers. Les cariocas, une chanson à deux temps, cent instruments, été, hiver, un même instant.

En 2008, le photographe français JR vient vivre à Providencia, la première favela de Rio (et donc du Brésil, et du monde) pour réaliser avec ses habitants un projet artistique participatif. L’initiative arrive à un moment où la communauté est en deuil, trois des adolescents de la favela ayant été kidnappés par des policiers, vendus à un gang adverse et assassinés. Le projet artistique permettra de redonner un autre visage à cette communauté dans les médias, et à apaiser la tristesse.
Tortuga amoureuse quitte pourtant Rio. Ma capitaine prend la mer et je reste à terre. Roberta, brésilienne, Maria, argentine, Emelyne, Donatien et Géraldine s’en vont pour Buenos Aires. La météo est mauvaise, pétoles et surventes vont s’enchaîner et les bringuebaler, peut-être. L’océan est imprévisible. Ils vont très vite s’éloigner des côtes pour le rejoindre. Qui sait quelle baleine, quel arc-en-ciel va les emmener plus vite, les ralentir. Je ne jalouse pas leur départ. J’ai enlacé un arbre le long d’une falaise, savoure l’écorce, le parfum des branches. Terre.
Terre.